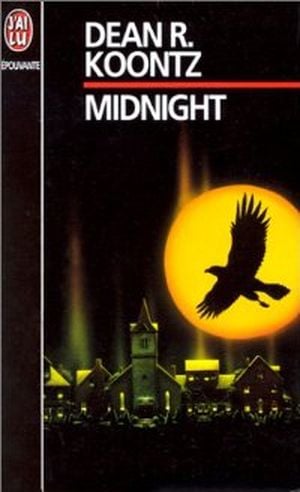Le principal problème de Dean Koontz, c’est qu’il vit en même temps que Stephen King, et qu’il est de la même génération que le maître de Bangor. Du coup, malgré ses indéniables qualités, Koontz reste le n°2, et c’est bien dommage.
Prenons par exemple ce roman, remarquable à de nombreux points de vue. Malgré sa longueur (640 pages), Midnight se déroule uniquement sur deux jours et deux nuits dans une petite ville de Californie envahie par la brume. Sam Brooke est un agent du FBI qui arrive incognito afin d’enquêter sur des morts aussi violentes que suspectes et surtout, beaucoup trop nombreuses pour une aussi petite ville. Dès les premières pages, nous assistons à une de ses morts, celle d’une femme faisant son jogging et rattrapée par des bestioles ni-humaines ni-prédateurs.
La première qualité du roman est de ne pas nous laisser une seule seconde de temps libre et ce, une fois de plus, malgré sa longueur plutôt conséquente. Nous sommes d’emblée plongés dans cette histoire, que l’on croit d’abord très balisée (des monstres qui hantent les rues d’une ville ; tellement balisée, d’ailleurs, qu’au début je me suis demandé ce qu’il allait bien pouvoir raconter en tant de pages) avant de découvrir, au fil des révélations qui vont s’égrener à intervalles réguliers, une intrigue bien plus ambitieuse. Suspense, horreur, énigmes et réflexions vont se mêler, le roman est remarquablement bien structuré, et tout cela fonctionne très bien.
A partir de maintenant, que des spoils !
Ce qui m’a surpris, alors que les ressorts de l’intrigue se dévoilaient, c’est le caractère politique de ce qui se déroule ici. Si je suis plutôt habitué à trouver de la politique chez King, c’est moins évident pour Koontz, et pourtant ici c’est flagrant dès que l’on commence à parler d’une « Nouvelle Race » humaine, débarrassée des affects et émotions qui empêchent le développement de l’humanité et entièrement sous le contrôle d’un homme-prophète-dictateur tout puissant. Un projet de « Nouvelle Race » qui, selon Shaddack, pourrait durer des millénaires et élever les hommes vers un niveau de contrôle de soi, de connaissance et de puissance sans égal. Mais un projet qui, finalement, ne fait que donner libre cours aux pires bassesses, à la pire sauvagerie, et ramener l’homme à ses instincts les plus barbares. Shaddack essaie bien de se convaincre que les monstres « régressifs » ne sont que des exceptions qui ne remettent pas en cause son projet, mais sur le terrain, le policier Loman Watkins se rend bien compte que c’est l’ensemble du projet de « Nouvelle Race » qui est vicié.
Le projet de Shaddack, c’est donc d’exercer un contrôle absolu sur une humanité qui est laissée à sa merci, et dont il a éliminé toute émotion, sauf la peur. On n’est alors pas très loin d’une vision symbolique d’un Etat totalitaire.
L’autre réflexion, très intéressante, qui se développe dans le dernier tiers du roman, concerne notre rapport à l’informatique et à ce que, en 1989 (date de parution du roman), on n’appelait pas encore « le monde numérique ». Plusieurs des « régressifs » en viennent à fusionner avec leurs écrans, au point de ne faire qu’un avec la machine. Là aussi, avec cette faculté à créer des images fortes, Koontz nous parle, déjà, du danger de dépendance aux écrans et aux outils informatiques, sans pour autant en faire une diabolisation non plus : c’est par un réseau d’ordinateurs que Sam parvient à comprendre ce qui se passe dans la ville, et c’est de la même façon qu’il tente de contacter des aides extérieures. Mais Koontz nous met en garde sur la potentielle dépendance à l’outil informatique, qui risque de nous déshumaniser.
Et, en creux, l’auteur dresse le portrait de ce qui, selon lui, constitue l’humanité : éprouver des émotions, même si elles paraissent négatives, et avoir le sens des responsabilités.