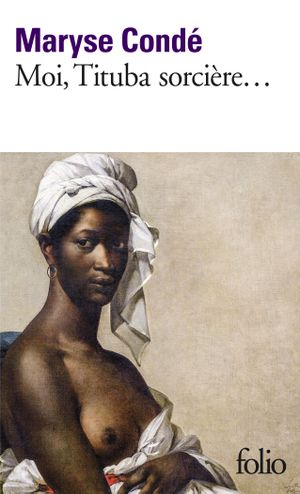Maryse Condé nous offre ici bien plus qu’un roman historique : une voix retrouvée, un souffle d’humanité et un acte de réparation symbolique.
Elle redonne chair et âme à Tituba, esclave née à la Barbade, accusée de sorcellerie lors des procès de Salem au XVIIᵉ siècle. Fille du viol et de la servitude, Tituba apprend très jeune, auprès de Man Yaya, les secrets des plantes et des esprits. Ces savoirs, hérités d’Afrique, la relient à ses racines, mais deviennent aussi son fardeau dans un monde où les hommes blancs dominent et où la différence est un danger.
Condé retrace son destin : l’amour, la trahison, la prison, l’humiliation, mais aussi la résistance et la fidélité à soi. Tituba, incomprise, marginalisée, blessée, reste pourtant d’une force intérieure bouleversante. Elle doute, souffre, aime, guérit, et incarne cette dignité farouche que ni les chaînes ni les dogmes ne peuvent étouffer.
À travers ce personnage, Maryse Condé dénonce l’esclavage, le racisme, le sexisme, et l’hypocrisie religieuse d’un puritanisme obsédé par le Mal. Elle montre combien les “sorcières” sont avant tout des femmes libres, des guérisseuses, des passeuses de savoirs que la peur et l’ignorance ont voulu brûler. La question reste en suspens : Tituba est-elle une sorcière ? Non, sinon au sens où la liberté d’une femme est toujours une forme de magie.
La plume de Condé, somptueuse et rugueuse à la fois, mêle le souffle du conte, la sensualité des Caraïbes et la violence de l’Histoire. Sa narration à la première personne rend Tituba terriblement vivante : on entend sa voix, son ironie, sa douleur, sa révolte. Comme Toni Morrison dans Beloved, Condé tisse la mémoire de l’esclavage avec le fil rouge de la féminité et de la résistance.
C’est un roman d’une intensité rare, où la beauté naît de la cruauté même du monde qu’il dénonce. Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem est à la fois un cri et une caresse, une œuvre engagée et poétique, une méditation sur la liberté, la foi, la mémoire et le droit d’exister.