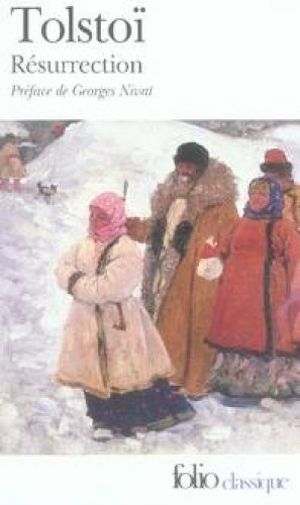Je me suis toujours méfiée de Tolstoï, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Peut-être que mon admiration profonde pour Dostoïevski occupait déjà tout l’espace. Les adaptations cinématographiques sirupeuses de ses romans, vues trop tôt et avant même d’avoir lu ses textes, n’ont pas arrangé les choses.
Profitant de l’été et d’un peu plus de disponibilité intellectuelle, j’ai pourtant décidé de me plonger dans Résurrection, son dernier roman, peut-être la somme de son œuvre.
On sent le souffle puissant d’un écrivain accompli, talentueux, animé par une ardente volonté de transmettre sa vision du monde. Le romanesque ne tombe pas dans la caricature : le récit d’apprentissage domine. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, malgré la longueur du texte. Le style, dans la mesure où la traduction lui rend justice, est d’une réelle élégance.
Je ne regrette donc pas cette lecture : elle m’a enrichie, mais peut-être davantage par les défauts que j’y ai perçus que par ses qualités intrinsèques.
L’intrigue, celle d’un prince, Dmitri Nekhlioudov, qui cherche la rédemption après avoir abusé d’une jeune femme du peuple, puis tente de réparer ses fautes en renonçant à ses privilèges, en la suivant jusqu’en Sibérie et en lui proposant le mariage, m’a frappée par sa naïveté. Il croit, sincèrement, que cette “tache morale” a mené la jeune femme à la prostitution, et qu’il peut la racheter par une forme de sacrifice personnel.
Comme Tolstoï lui-même, ce qu’on lui a souvent reproché, et qu’il finit d’ailleurs par reconnaître dans le roman, il est plus facile d’embrasser les idées généreuses du socialisme naissant que de vivre, au quotidien, dans la saleté, la déchéance, l’abjection. Abandonner ses terres à ses paysans, renier ses privilèges, cracher sur l’héritage de ses ancêtres et spolier sa descendance de son héritage : tout cela part d’un idéal sincère, mais ne transforme pas le monde.
Dénoncer les injustices du pouvoir, de la justice, de la bureaucratie, des représentants de la religion ou des castes est évidemment salutaire. Mais écrire, par exemple :
« Quant à l’éternelle question de la conduite à tenir avec les criminels, elle ne le troublait plus désormais. Fallait-il donc les laisser impunis ? L’interrogation aurait eu un sens s’il avait été prouvé que le châtiment diminue la criminalité et amende les criminels. Mais lorsque le contraire est démontré, lorsqu'il apparaît clairement qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme d'en amender un autre, alors, la seule attitude raisonnable est de renoncer à quelque chose d’inutile, de nuisible même, d’immoral et de cruel enfin »(citation tirée de l’édition Folio, p. 697) c’est là une position typique de ceux qui vivent dans l’abstraction, protégés par leur milieu et leur confort, et qui n’ont jamais eu à croiser, chaque jour, le regard de celui qui, ivre et drogué, a tué leur enfant ou habite dans la peur à côté de son agresseur resté impuni...On éduque les enfants en les punissant quand ils enfreignent la loi, agir différemment avec les coupables est un rêve dangereux pour la société.
Le prince, lecteur enthousiaste des nouvelles philosophies occidentales, rencontre sur sa route des anarchistes, dont il partage peu à peu la vision du monde. Les passages censurés à l’époque par le pouvoir impérial sont d’ailleurs très intéressants, tant pour leur contenu que pour le fait même qu’ils aient été interdits.
Le grand intérêt du roman réside aussi dans sa façon de montrer la proximité entre le christianisme et les idéaux socialistes. Tolstoï déploie, avec brio, les notions d’égalité, de partage, d’aide aux plus faibles, de pardon. Le texte se clôt même sur une très belle lecture des Évangiles.
Mais il omet une vérité essentielle : les hommes ne sont pas des anges. L’avidité, la jalousie, la violence, l’envie, l’exploitation des plus faibles, tout cela fait partie de la nature humaine. L’éducation peut en corriger certains aspects, jamais les éradiquer. Changer les structures sociales, aussi nécessaires que cela puisse être, ne suffira pas à changer l’homme. Et tendre l’autre joue, parfois, c’est s’exposer à se faire massacrer.
L’histoire de la Russie qui suivra le montre tragiquement : ce rêve d’égalité, poussé à son extrême, se soldera par un massacre. Au nom de cette pureté sociale, on lapidera des enfants dans des puits. Les enfants de Nicolas II, exécutés sans pitié, seront les victimes de cette soif d’absolu, comme tant d’autres, parmi les plus innocents, les plus humbles.