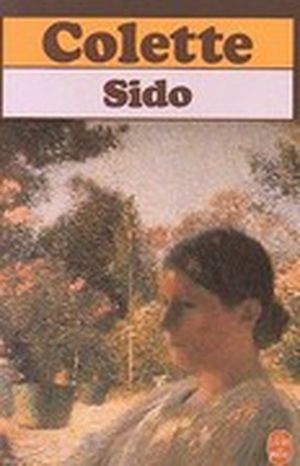Publié en 1929, Sido est un texte écrit par une Colette alors âgée de 56-57 ans, qui s’adresse à l’enfant qu’elle fut, autour de ses dix ans. Ce décalage entre le regard mûri par le temps et la mémoire poétique de l’enfance accentue l’écart entre ce qui a été vécu et ce que l’on souhaite croire.
Le livre est avant tout un hommage à la mère, figure tutélaire et enracinante. Sido incarne la nature, la maison, la liberté, une force intuitive presque mythifiée. Autour d’elle gravitent des portraits secondaires : le père, discret et rigide, capitaine marqué par l’amputation d’une jambe lors des guerres d’Italie sous le Second Empire, dont l’infirmité semble avoir façonné le caractère, à qui Colette rend malgré tout un hommage attendri. Les frères et la sœur, esquissés en arrière-plan, constituent un décor plus qu’un véritable contrepoint, mais nécessaire à cette fresque intime.
La grande force du texte est son écriture sensorielle : parfums, lumières, textures, gestes… Colette excelle à recréer un univers sensible, fragmenté en vignettes libres et évocatrices. Mais ce lyrisme, parfois trop appuyé, tend aussi à saturer la lecture. Le raffinement du style devient pesant, et le flot de métaphores, au lieu de séduire, finit par lasser.
Cette célébration est par ailleurs trompeuse. Les souvenirs, magnifiés, relèvent davantage de l’embellissement que du témoignage. La mère est idéalisée, presque sanctifiée, quand les autres figures paraissent reléguées dans l’ombre. Le texte fige un passé sublimé, loin des contradictions et de la complexité du réel. On a le sentiment que Colette écrit avant tout pour elle-même, davantage dans l’exercice d’une mémoire intime que dans un dialogue véritable avec le lecteur.
Un texte qui séduira les amateurs de descriptions champêtres et de prose poétique, une rêverie douce et nostalgique sur l’enfance. Mais derrière cet onirisme élégant, j’ai peiné à trouver un véritable souffle narratif, restant assez hermétique à cette évocation trop lyrique et trop magnifiée.