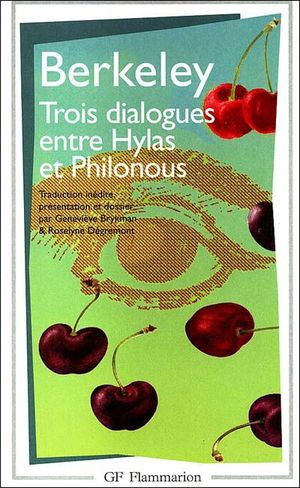Qu'il est pénible, ce Berkeley ! Il arrive avec ses trois dialogues doux et faciles à lire à nous paralyser l'esprit avec l'une des thèses les plus marquantes et les plus puissantes de la philosophie !
Trois dialogues entre Hylas et Philonous est en effet un ouvrage écrit par Berkeley pour présenter sa thèse idéaliste. Berkeley veut montrer qu'absolument rien ne nous permet d'affirmer l'existence de la matière en-dehors de notre esprit. Ou, pour le dire autrement, il veut démontrer que nous n'avons jamais affaire qu'à notre esprit et que, par conséquent, rien ne nous permet d'affirmer qu'en-dehors de notre esprit il existe quoi que ce soit. La thèse paraît farfelue. D'où la nécessité de vulgariser par l'intermédiaire de ses dialogues.
Hylas représente alors la thèse communément admise, une sorte de dualisme cartésien selon lequel il existerait l'esprit (la conscience, l'intelligence, les passions, les idées, les souvenirs, les images...) et la matière (le reste : ce qui prend de la place, ce qui est dur quand on cogne dessus, ce qui a de la couleur... La table, mon chien, l'arbre, le citron...). Hylas défend l'existence de cette matière, d'où son nom : Hulé, en grec ancien, c'est la matière.
Philonous, lui, défend l'intelligence au détriment de l'évidence communément admise. D'où son nom : Philo, c'est l'amour, et Nous, l'intelligence.
Et, au cours de ces trois dialogues, Philonous va montrer à Hylas que jamais ce dernier ne pourra montrer avec certitude et nécessité que la table, mon chien, l'arbre ou le citron n'existent en-dehors des images qu'il s'en fait. La table est dure, mais elle l'est pour moi qui me cogne dedans. J'en ressens sa dureté par l'image de ma perception que mon esprit traite. Mon chien existe, je le vois par mes yeux, c'est-à-dire une image de ma perception que mon esprit traite. Le citron est acide, etc. Et c'est fait avec une telle douceur, une telle humilité, et une telle pédagogie qu'on ne peut qu'attester.
Mais alors quoi ? Qu'apporte cette théorie ? En pratique et dans notre vie quotidienne, pas grand chose. Mais au sein des polémiques philosophiques millénaires, ce tour d'adresse est très fort.
Il propose déjà une porte de sortie élégante et difficilement attaquable à l'embarras de Descartes : comment concilier l'esprit et la matière ? Comment expliquer que mon corps (matériel), puisse communiquer sa douleur à l'esprit ; et comment expliquer que mon esprit puisse commander mon corps ? Réponse de Berkeley : parce que tu t'embarrasses avec deux substances alors qu'il n'y en a qu'une.
Il propose en outre une avancée originale concernant l'existence de Dieu. Comment expliquer, si la matière n'existe que pour nous, qu'on parvienne tant à se mettre d'accord sur elle ? Comment expliquer que le citron est acide pour tout le monde, s'il n'est d'abord acide que pour moi ? Parce qu'il y a un esprit plus puissant que les autres qui fait exister ces idées presque indépendamment de nous. C'est Dieu.
Enfin, il coince par avance Kant et sa distinction foireuse entre le phénomène et le noumène, l'image et la chose en soi. Qu'un auteur qui fasse reposer l'intégralité du savoir sur l'expérience sensible fasse reposer l'intégralité de sa philosophie pratique sur le noumène par définition impossible à expérimenter m'a toujours dépassé. Ici au moins, Berkeley rabaisse ses prétentions. Et c'est assez plaisant.