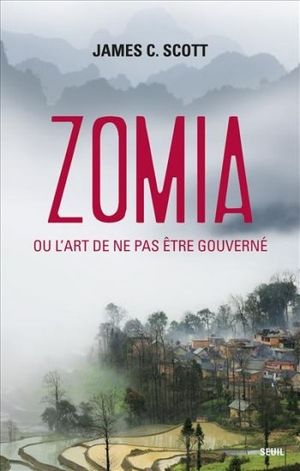LA ZOMIA.
.
Un pays qui n'existe pas - ou plutôt, une région du monde qui n'est pas inscrite sur les cartes officielles.
Pourtant pas une de ces géographies imaginaires qui réenchantent le monde : une zone bien réelle de l'Asie du Sud-Est.
Des géographes lui ont forgé un nom parce qu'elle n'en avait pas, et parce qu'ils avaient besoin de la nommer pour en parler.
Parce qu'ils avaient des choses à en dire - des choses à nous dire.
.
Pour ne pas piocher dans la nomenclature occidentale, ils sont partis de "zomi" qui, en tibéto-birman, signifie "les hautes terres".
.
Sur 2,5 millions de kilomètres carrés peuplés par environ 100 millions de personnes, une centaine d’ethnies, pratiquant des langues empruntées à 5 grandes familles linguistiques distinctes, la Zomia est une vaste zone de montagnes et collines qui s'étend du Vietnam jusqu'au Nord-Est de l'Inde, en traversant - mais le bon terme serait plutôt "chevauchant" - le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Chine et la Birmanie.
.
On peut comprendre que ces pays ne l'aient jamais nommée : elle est transnationale, lui reconnaître une identité affaiblirait les frontières.
.
Mais de toute manière, la Zomia n'est pas un ensemble humain cohérent qui pourrait risquer de revendiquer une identité globale :
elle est exactement l'inverse.
C'est un capharnaüm de peuples, d'ethnies, de langues, de cultures, de modes de vie - l'équivalent en terme de bio-diversité culturelle humaine d'un de ces hot spots de faune et de flore ou le moindre mètre carré compte plus de bio-diversité que des milliers de kilomètres-carrés ailleurs.
Alors pourquoi l'étudier globalement ?
.
Parce que certains chercheurs y ont remarqué des constantes si fortes ( dans ce bazar, justement ) qu'elles ne pouvaient pas être des coïncidences, et que ces constantes remarquables nous parlent de ce que sont :
- Les ETATS - comment ils se forment et comment ils fonctionnent.
- La CIVILISATION et la BARBARIE, et comment elles s'entredéfinissent.
- Les concepts de TRIBUS et d' ETHNIES, et comment elles forgent leur Histoire, l'écrivent et la réécrivent au gré des besoins.
- Les MODES DE VIE, ( nomadisme, cueillette et chasse, agriculture, villages, villes ) envisagés non plus comme les séquences rigides d'une frise, mais comme des choix dynamiques - des stratégies et l'expression de volontés collectives.
- Une forte tendance à EVITER d'être intégrés à des états centralisateurs et administrateurs ( au moins, à éviter d'y être intégrés concrètement et efficacement ). C'est cet "évitement de l'état", constant sur une si vaste zone, parmi des populations si diverses et sur une période allant de l'Antiquité à nos jours, qui a attiré l'attention des chercheurs, et qui justifie le sous-titre du livre :
"Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné"
...en passant on découvre la notion asiatique de CRU vs CUIT appliquée aux divers degrés de "civilisation".
J'avoue tout de suite que je n'éprouve pas énormément d'intérêt pour les pays cités plus haut: je ne suis spécialiste d'aucun de ces endroits, et pas passionné par la Géo en général; mais j'ai dévoré ce livre, à cause de ce qu'il nous apprend, en regardant l'Humanité sous un angle différent.
La suite tente de résumer grosso-modo le livre de James C. Scott; si vous voulez le lire avec fraîcheur, n'allez donc pas plus loin dans cette critique.
Scott n'est pas le premier ni le dernier à écrire sur la Zomia;
il fait partie d'un ensemble de chercheurs et d'auteurs qui se sont penchés sur l'ensemble ( ou sur des morceaux ) de cette région, répertoriant les peuples, décortiquant leurs cultures et leurs modes de vie;
tâche immense, vu ce capharnaüm ( capharnaüm sans cesse changeant ), et tâche qui ne rencontre pas toujours la bonne volonté des états plus ou moins sympas qui y règnent.
Scott prévient donc d'emblée qu'il ne s'aventurera pas à faire l'histoire de cette mosaïque de peuples, ethnies, tribus, parfois réduits à de simples unités familiales indépendantes les unes des autres, et qu'il ne tentera pas non plus d'en faire une description exhaustive figée à un instant t :
il va faire simplement l'histoire et l'étude de leur rapport à la notion d'Etat.
Pour cela, passé la présentation, il montre que les états centralisateurs et "civilisateurs" ( c'est à dire qui tendent à faire adopter à leurs populations un mode de vie standard ) se répandent facilement et très efficacement en terrain plat, mais ont beaucoup plus de mal à s'imposer en altitude - on pense tout de suite aux régions montagneuses, mais Scott montre que ce principe vaut aussi pour les régions de collines.
Il propose une image simple et claire :
si on comparait cette facilité à conquérir et gouverner efficacement les zones peu accidentées à de l'eau inondant la région, là où l'eau s'étendrait et couvrirait tout, on aurait une bonne représentation des zones que peut facilement contrôler un Etat;
les reliefs qui dépassent, qui émergent encore, correspondraient eux aux zones qui ont toujours eu tendance à échapper au contrôle étatique.
La raison semble, à première vue, liée à la vitesse de déplacement d'une troupe : les zones "plissées" ralentissent considérablement la progression militaire, mais aussi les communications et transports en général, donc le fonctionnement de la "civilisation" centralisée; elles créent des éloignements, des lointains et des zones de cachette, de refuge, d'échappatoires et d'évitement;
Mais à côté de cette raison évidente et universelle, il y en a deux autres :
L'AGRICULTURE et la POPULATION.
Scott montre que les états ont besoin de concentrer une population nombreuse dans un espace réduit; Depuis toujours, ils doivent, pour contrôler efficacement, bénéficier d'une forte densité immédiatement située autour de leur centre dirigeant ( capitale, palais, cour...); cette population nombreuse, dense et serrée, proche du centre de contrôle ( ou des centres ) doit être atteignable rapidement; et pour ça, un ingrédient quasi indispensable est l'agriculture sédentaire en monoculture intensive; et, particulièrement, LA CEREALE.
parenthèse : On sait maintenant, suite aux recherches sur nomadisme et sédentarisme, chasse-pèche-cueillette et agriculture, que l'adoption de l'agriculture céréalière n'a pas forcément bénéficié au bien être de l'humanité : ce mode de vie a permis d'augmenter considérablement le nombre des humains, mais pas leur qualité de vie - au contraire, nous disent les chercheurs; il s'en est ensuivi une baisse de la santé et du bien-être, via les épidémies, les famines plus fréquentes en mono-culture intensive qu'en chasse-pèche-cueillette-microagricultures diversifiées, et des pathologies liées à ce nouveau mode de vie, et des contraintes plus fortes;
Alors qu'est ce qui nous a pris d'évoluer dans ce sens ?
( la question est tellement sérieuse que certains ont redéfini cette transition ainsi : techniquement, rationnellement, on devrait dire que ce sont les céréales qui nous ont domestiqués, et pas l'inverse, puisque cette évolution leur a été plus bénéfique qu'à nous ! mais là, je sors du livre de Scott )
Scott propose un élément de réponse : faire adopter la monoagriculture céréalière intensive aux populations nomades de chasseurs-cueilleurs est une condition indispensable à la survie d'un Etat; et il montre que ces états, toujours et partout dans le monde, ont consacré des efforts intenses à éradiquer nomadisme et diversité des modes de subsistance et des modes de vie, pour amener des quantités toujours plus grandes de main d'oeuvre à pratiquer l'agriculture céréalière intensive ( la riziculture irriguée, dans la majorité des plaines de l'Asie du Sud-Est ).
Il ne s'agissait pas uniquement de nourrir; il s'agissait de concentrer de fortes quantités de population autour du centre de contrôle; d'obtenir une démographie toujours croissante; une main d'oeuvre moins mobile, moins susceptible de s'éloigner, facile à soumettre à des travaux et corvées, et à enrégimenter militairement;
...et surtout, facile à TAXER.
Accaparer des richesses ( donc du pouvoir ) au sein de petites "élites" dirigeantes est une constante de ces Etats céréaliers. Or la céréale - le riz par exemple - est idéale à taxer : quand on a sous la main une population nombreuse, au mode de vie relativement unifié, à peu de distance des mouvements de troupes, il est facile de recenser cette population et d'évaluer quand les récoltes seront prêtes et en quelles quantités. Et les céréales, le riz par exemple, se stockent et se conservent assez bien ( comparez aux fruits et légumes ! ).
La monoculture céréalière intensive impose la concentration d'une main d'oeuvre importante à portée de main des dirigeants, forcément sédentaire, facile à recenser, à enregistrer, à taxer, à soumettre à divers travaux et à enrégimenter militairement.
On comprend mieux le succès de cette agriculture : c'est pratiquement la condition nécessaire et suffisante pour constituer un état centralisateur accaparant une partie importante des richesses pour les convertir en toujours plus de pouvoir entre les mains des élites dirigeantes.
Mais il y a un hic : ce type d'agriculture est idéal en plaine, en terrain plat; beaucoup moins en terrain accidenté, collines ou montagnes. ( bien sûr, on peut y parvenir au prix de gros efforts, donc à un coût qui en diminue la rentabilité ).
Cette technique de constitution des états, et de leur développement, a donc mangé très vite les plaines et relativement délaissé les terres accidentées, qui s'y prêtaient moins;
...et à côté des difficultés technique d'installer une monoculture céréalière intensive en terrain accidenté, il y a l'allongement des distances dû au terrain plissé: plus long et difficile de recenser, contrôler, soumettre les habitants des collines et montagnes que ceux des plaines; ratio efforts/gains moins avantageux, nombreuses possibilités de se soustraire au contrôle, entraînant des coûts trop élevés, etc.
Les Etats centralisateurs ont donc envahi les plaines ( comme l'inondation de la métaphore ), délaissant les hautes terres ;
La tendance à unifier les coutumes et les modes de vie pour construire un peuple homogène a suivi les mêmes chemins, envahi les mêmes espaces;
et les hautes terres sont donc restées des îlots non unifiés, non contrôlés, non recensés, non soumis à l'impôt et difficiles à enrégimenter, conservant des modes de vie et de subsistance moins liés à la monoagriculture céréalière intensive des basses terres, plus diversifiés, avec la pratique de la chasse-pèche cueillette, des microcultures souvent sur brûlis-abattis, et un mélange de nomadismes et de sédentarités - mais toujours prêtes à déménager vite pour échapper aux tentatives de contrôle.
Pour constituer et maintenir d'importantes quantités de population dans leurs zones de contrôle, les états ont eu recours à la séduction, aux attraits de la civilisation, à la déconsidération des "barbares" ( à base de préjugés caricaturaux très violents ), mais aussi énormément à la force: l'ESCLAVAGE a joué un rôle très important dans la constitution des états, que ce soit lors de guerres, captifs ramenés, raids esclavagistes, déportations de communautés entières - mais aussi achats d'esclaves à certaines communautés des hautes terres spécialisées dans ce commerce - on n'est pas du tout chez les bisounours.
Pour éviter que de trop grandes quantités de population fuient leurs territoires, leurs guerres, leurs épidémies, leurs impôts, leurs corvées, leur unification culturelle, les états ont du surveiller en permanence leurs populations ( parfois tatouées de force pour rester éternellement repérables, comme du bétail ), créer des situations de servage interdisant les départs, interdisant l'abandon de la riziculture irriguée et le retour au brulis-abattis, et, quand la situation leur échappait, lancer des guerres ou des raids pour capturer assez de main d'oeuvre en remplacement des fuites.
Déjà, à ce stade, la démonstration de Scott est foudroyante, limpide, et propose une description de ce qu'est un état ( antique ou moderne ) assez différente de ce que j'imaginais jusqu'ici.
Scott montre ensuite que les populations des hautes terres, incroyablement bigarrées et difficiles à répertorier, décrire et classifier ( d'autant qu'elles changent sans cesse, bien plus fluides que l'ethnologie et l'anthropologie ne l'imaginaient ), ont des modes de vie et des cultures qui semblent entièrement consacrés à l'EVITEMENT DE L'ETAT - à la fois à éviter d'être absorbées et contrôlées par les états de la région, mais aussi bien souvent à éviter que des formes étatiques ne naissent en leur sein !
Il s'appuie pour ça sur les travaux de nombreux chercheurs, toujours précisés dans l'appareil de notes très important en fin de livre ( ces notes occupent 120 pages sur les 750 du livre, et elles sont si intéressantes que, pour la première fois, j'ai lu avec 2 marque-pages, un dans le corps du livre et l'autre dans les notes ).
"Zomia ou l'art de ne pas être gouverné" montre aussi qu'il y a toujours eu circulation entre ces états des basses terres et les populations des hautes terres, dans les deux sens : sans cesse des habitants des "tribus" des hautes terres viennent se fondre dans la population des états, et sans cesse des parties de la population des basses terres quittent les états pour venir vivre à l'abri des hautes terres;
aucun de ces groupes n'est réellement distinct, ni génétiquement, ni culturellement; Ce n'est pas leur essence qui les distingue, mais leur attitude, leur choix de vie; et leurs "identités" ont souvent été crées artificiellement par les états centralisateurs, comme des étiquettes dont ils avaient absolument besoin pour gérer les relations.
Parce que ces deux façons de vivre ne sont pas étanches : les hautes terres entretiennent en permanence des relations ( commerciales, militaires, culturelles... ) avec les états des basses-terres, et réciproquement.
Ce livre peut par moment paraître répétitif parce que Scott s'impose beaucoup de clarté, de démonstration appuyée sur des sources, et examine les situations de nombreuses aires étatiques et culturelles ( Chine, Birmanie, Thaïlande, Vietnam etc... ), montrant scrupuleusement que des points assez comparables s'y retrouvent à chaque fois, ou presque;
il laisse quand même leur place aux exceptions ou aux nuances locales;
il étudie le cas des hautes terres ET le cas des basses terres, parce qu'il considère ce couple comme un mécanisme global interdépendant : les états ont toujours eu besoin des tribus barbares - commercialement, comme une source de biens n'existant pas dans les basses terres, mais aussi pour y trouver des renforts de population à attirer ou capturer, et aussi culturellement pour se définir comme civilisés par oppostion - et les habitants des hautes terres ont toujours entretenu un commerce fructueux avec les basses terres, et leur ont emprunté souvent des traits culturels, mais se sont également souvent défini culturellement par opposition.
Scott passe aussi très méthodiquement en revue chaque sujet, chaque angle :
démographie, religions, zones sèches et zones humides, la nourriture, la façon de nommer et qualifier les peuples des hautes terres, l'économie, guerres razzias et asservissement, processus d'intégration sociale dans les états, surpopulation santé et écologie, revendications identitaires, révoltes, mobilité, habitat, nourriture et choix des espèces à cultiver, structures sociales et structures familiales, langues, rapport à l'écrit et à l'oral, généalogies, égalitarisme et hiérarchie sociale, etc.
On s'aperçoit que la colonisation occidentale s'est heurtée aux mêmes problèmes que les états de l'Antiquité, s'est arraché les cheveux en tentant obsessionnellement de classifier les "races" de ces régions, a usé d'une extrême brutalité pour tenter de les faire rentrer dans le rang, et a, globalement, échoué comme ses prédécesseurs;
On y découvre que les concepts d'ethnie et de tribu sont surtout des constructions intellectuelles des civilisations centralisatrices, qui les ont utilisés et imposés pour faire rentrer de force des communautés inclassables dans des petites boites bien carrées, hors desquelles les administrations étatiques ne pouvaient administrer;
Le livre de Scott fourmille de détails surprenants, parfois marrants - on y apprend par exemple que les chinois classent les peuples en "cuits" ( = civilisés ) et "crus" ( non civilisés );
Beaucoup moins marrant, on y apprend aussi que la fin du XXème siècle et le début du XXIème marquent la fin de cette "possibilité d'un évitement de l'état", parce que les technologies modernes permettent maintenant à la Chine, au Vietnam, à la Birmanie et à tous les états concernés de prendre enfin le contrôle effectif des hautes terres et de détruire en la "normalisant" cette mosaïque jusqu'ici irréductible :
Pour les crus, c'est cuit.