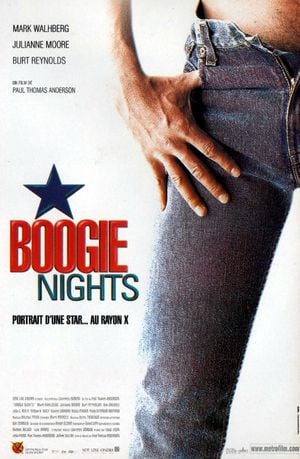Qui est le film ?
Deuxième long-métrage de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights (1997) s’inscrit au moment où le cinéaste impose déjà sa signature : un cinéma ample, romanesque, obsédé par les communautés éphémères et les structures de pouvoir qui les traversent. Après Hard Eight, huis clos sec autour du jeu et de la dette, Anderson déploie une fresque : la scène pornographique californienne entre 1977 et 1983. En surface, le film promet un récit d’ascension et de chute, un “rise and fall” classique, à la Scorsese. Mais derrière ce canevas familier, l’ambition est plus vaste : raconter, à travers une industrie marginale, le basculement d’une Amérique hédoniste vers une économie néolibérale où les corps deviennent monnaie, et où le passage du film à la vidéo redessine l’éthique du regard.
Que cherche-t-il à dire ?
Le projet d’Anderson n’est pas de moraliser sur le sexe, ni d’exploiter le décor “sulfureux”. Il veut montrer comment une famille se fabrique à l’intérieur d’un système objectivant, et comment cette famille éclate quand change le support, donc la chaîne de valeur. La tension centrale est double : d’un côté, l’utopie fragile d’une communauté qui se protège par la chaleur, le soin, la croyance dans “l’art” du porno ; de l’autre, l’implacable logique économique qui transforme la jouissance en marchandise standardisée. L’ambition est à la fois matérialiste et affective : radiographier une industrie tout en donnant à ses personnages une densité qui échappe au simple jugement moral.
Par quels moyens ?
Dès le plan-séquence d’ouverture, Anderson embrasse son monde. Le Steadicam glisse des trottoirs au club, de Jack Horner à Eddie Adams, comme une main qui accueille. La caméra “adopte” ses personnages avant que le récit ne les juge. Ce geste inaugural scelle le contrat : le film regardera ses créatures avec curiosité, sans cynisme.
Dirk Diggler n’existe d’abord que par un phallus dont la mise en scène diffère sans cesse la révélation. Objet invisible, mais moteur symbolique, il structure la croyance collective. Quand il est enfin montré, c’est moins un choc qu’une vacuité : tout aura tourné autour d’un signe vide. Le fétiche est dégonflé, et l’identité qui s’y accrochait se révèle fragile.
Jack et Amber organisent un foyer de substitution où le care et la capture s’entrelacent. Autour de la piscine, chacun trouve chaleur et reconnaissance, mais aussi dépendance économique. Le film refuse de trancher : cette “famille” protège en exploitant. La scène finale autour de la table rejoue un rituel domestique, tendre et artificiel, comme si survivre valait mieux que briller.
Dirk incarne une starisation construite comme réponse à la honte sociale. Jack se pense patriarche éclairé, persuadé de “faire de l’art” : idéologie qui apaise ses propres contradictions. Et Scotty J., figure queer marginalisée, vit une scène de voiture déchirante : le système hétéronormé le rejette même dans un milieu prétendument “libre”.
Amber perd la garde de son enfant : l’État condamne ce que l’industrie tolère. Rollergirl, éternelle adolescente à roulettes, incarne la dépendance au fantasme masculin. La séquence d’humiliation en voiture révèle la porosité entre performance et violence réelle. Le film dévoile que la liberté sexuelle affichée masque une division brutale des risques et du travail.
Le basculement du film vers la vidéo n’est pas un détail technique : il fracture l’écosystème. Jack rêve que les spectateurs restent “pour l’histoire”, mais le VHS impose la vitesse, la quantité, l’obsolescence. Avec le changement de support disparaît la possibilité d’un cinéma du geste. L’utopie collective se défait, remplacée par une logique industrielle de flux.
Montée sur Sister Christian et Jessie’s Girl, la scène accumule tension, bruit et absurdité jusqu’au chaos. Le porno, qui jouait à mimer le danger, est remplacé par un vrai risque de mort. Anderson fait ici toucher la limite : l’économie du spectacle finit toujours par croiser celle de la violence. L’excès comique tourne au tragique, révélant l’envers du système.
Où me situer ?
Je suis fasciné par la manière dont Anderson filme sans cynisme un milieu pourtant souvent réduit à l’exploitation. Sa caméra donne une dignité aux figures qui l’habitent, même quand elles s’effondrent. Le film est pour moi admirable dans sa richesse thématique et sa précision technique, mais cette abondance se fait au détriment de la narration, moins tenue dans son dernier tiers. C’est là la limite et la beauté du projet : vouloir tout embrasser, quitte à perdre la ligne.
Quelle lecture en tirer ?
Boogie Nights ne parle pas seulement du porno, ni même du cinéma. Il observe comment une communauté se fonde autour d’un mythe fragile, comment une économie reconfigure la valeur des corps, et comment, dans la ruine, il reste des micro-rituels de dignité. La dernière image (Dirk répétant “I am a star” devant son miroir) sonne à la fois creuse et nécessaire. Creuse, parce que la starisation n’a plus d’assise. Nécessaire, parce que l’autosuggestion est une condition de survie. Anderson ne moralise pas. Il laisse voir comment des individus bricolent encore une croyance, même bancale, pour tenir debout.