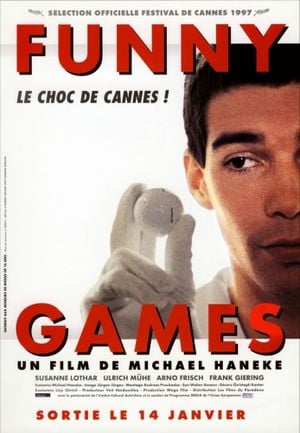Michael Haneke prétend, avec Funny Games, faire une dénonciation lucide et dérangeante de la violence médiatique et de notre voyeurisme collectif. Mais le résultat, loin d’une réflexion profonde, s’apparente à une démonstration stérile, cruelle et moralement douteuse. Sous couvert de critique du spectacle, Haneke livre précisément ce qu’il prétend condamner : une mise en scène minutieuse du sadisme, de l’humiliation et de la mort, dépourvue de toute issue, de tout sens, et surtout de toute empathie.
Le film se présente comme un miroir tendu au spectateur, censé le confronter à sa propre fascination pour la violence. Pourtant, il ne fait que l’exploiter. Haneke filme la souffrance des victimes avec un détachement glacial, presque pervers, et multiplie les clins d’œil méta-cinématographiques qui ne font qu’ajouter une couche de cynisme à un dispositif déjà suffocant. L’effet n’est pas de susciter la réflexion, mais une forme d’impuissance et de dégoût, non pas face à la violence du monde, mais face à la manipulation du réalisateur lui-même.
Le plus grave, peut-être, est que Funny Games ne propose aucune alternative, aucune ouverture, aucune lueur d’humanité. Haneke croit ainsi "révéler" l’impossibilité de lutter contre la violence ; en réalité, il abdique toute responsabilité artistique et morale. En refusant d’offrir le moindre contrepoint — esthétique, narratif ou émotionnel — il transforme son film en une apologie involontaire du crime, un manifeste du nihilisme le plus creux.
Certes, on peut reconnaître à Haneke une rigueur formelle et une intelligence conceptuelle. Mais à quoi bon ces qualités, lorsqu’elles servent à justifier une œuvre sans compassion ni espoir ? Funny Games ne questionne pas la violence : il la reproduit froidement, la fige dans un dispositif cérébral où la victime n’est plus qu’un prétexte, et le spectateur, un cobaye. Ce n’est pas un film qui dénonce ; c’est un film qui abdique. Et dans cette abdication, il finit par trahir sa propre prétention morale.