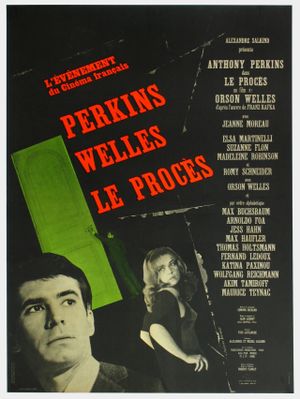Le Procès s’ouvre et se referme sur la fable Devant la Loi, racontée par Orson Welles lui-même. D’entrée, Welles se positionne non pas comme simple illustrateur, mais comme lecteur et interprète de Kafka, prêt à livrer sa vision. Fidèle à l’étrangeté du roman, il s’en détache pourtant pour en faire une œuvre profondément personnelle, inscrite dans son univers, par ce personnage de Joseph K écrasé par des forces qui le dépasse. « La logique de cette histoire est celle d’un rêve, d’un cauchemar », prévient-il dès le prologue. Et effectivement, pendant deux heures, on plonge dans un marécage d’absurde et d’angoisse.
Le récit est morcelé, sans causalité claire. Le temps devient flou : tout s’enchaîne, sans qu’on sache si l’histoire dure quelques jours ou des années. Joseph K passe d’un lieu à un autre, d’une rencontre à la suivante, sans logique apparente. Cette fragmentation rappelle aussi le tournage du film, éparpillé entre la Gare d’Orsay et la Croatie, parfois même au sein d’une seule scène. Les lieux immenses et minuscules se connectent de façon illogique : Joseph K monte au dernier étage chez le peintre officiel du tribunal, pour finir dans un tunnel qui le mène… jusqu’à une cathédrale.
Visuellement, impossible de se tromper : c’est bien du Welles. Décors monumentaux encombrés d’objets, profondeur de champ vertigineuse, grands angles déformants, cadres obliques, lignes de fuite interminables, ombres menaçantes et montage sec et nerveux. Cet expressionnisme renforce le caractère cauchemardesque du récit et fait du film non pas une simple adaptation, mais le cauchemar de Welles lui-même.
Ce qui fascine, c’est cette sensation d’étouffement née paradoxalement de décors gigantesques. Joseph K se débat, enfermé dans une procédure dont il ne comprend ni le sens ni les règles, et dont on ne saura jamais même l’accusation. Tout le film respire la paranoïa, la suspicion et l’angoisse : un individu broyé par une société incompréhensible. On parle sans cesse du procès, jamais de son fond.
Welles épouse cette logique inachevée et lacunaire du roman de Kafka. Comme dans Devant la Loi, on obtient des explications partielles, mais jamais la réponse essentielle. Cette quête de sens est vouée à l’échec. Plus le film avance, plus on s’enfonce dans le labyrinthe, et c’est précisément cela qui captive, outre la beauté plastique du film. Welles ne cherche pas à tout expliquer, il nous plonge dans l’absurde et le néant.
La fin brouille encore les frontières : Joseph K interrompt le récit du diaporama de Hastler (joué par Welles), brisant subtilement le quatrième mur : « Nous avons tous entendu cette histoire ». Joseph K est-il ce personnage de la fable ? Est-il à la fois protagoniste et spectateur, tout comme nous ? Finalement, il est exécuté par dynamite. Dans un chaos d’images et de sons, la fumée s’élève… puis disparaît, ne laissant que le vide.
Avec Le Procès, Welles nous plonge dans un monde illogique, cruel, absurdement fascinant. Un cauchemar où, comme Joseph K, on ne fait que sombrer sans jamais trouver la sortie. Le Procès est sans doute l'une des meilleurs dapatations qui soit, témoignant de comment un auteur s'approprie une oeuvre, sans la trahir, en usant les spécificités de son nouveau médium.