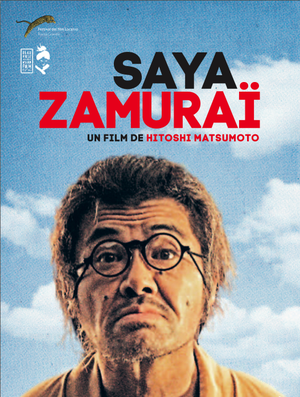Ce qui me plaît dans Saya Zamuraï, c’est la simplicité brutale du dispositif : un samouraï déchu, sans sabre, a trente jours pour faire rire un prince mutique. S’il échoue, il se tue. Voilà. À partir de là, le film ne cherche pas à “enrichir” l’idée, il la creuse : chaque matin, un nouveau numéro, chaque matin un nouveau bide, chaque matin la même honte mise en scène.
Ces performances ratées me font rire parce qu’elles sont nulles avec méthode. Trente tentatives, trente inventions plus ou moins absurdes, qui montent en complexité et en désespoir : machines bricolées, accessoires grotesques, mise en danger ridicule. Matsumoto travaille vraiment l’“art du flop” : les gags sont "mauvais", mais leur acharnement devient bouleversant. On rit du clown, pas du bide.
Le film tient aussi sur un fil plus politique : un homme sans statut qu’on force à divertir le pouvoir, un protocole de cour qui transforme tout le monde en témoin et en bourreau, une gamine qui répète “suicide” comme si c’était une issue administrative. Sous les kimonos, on n’est pas si loin d’un monde contemporain où l’on doit se rendre “intéressant” pour avoir le droit de rester en vie.
Et puis il y a la relation avec la fille, dure et tendre à la fois, qui refuse de lâcher ce père nul mais digne. La fin, sans pathos, arrive comme une évidence. On n’est pas dans le non-sens gratuit : derrière le comique visuel, le film dit beaucoup sur l’humiliation, la persévérance, et cette forme de "dignité" qui survit même quand on a tout raté