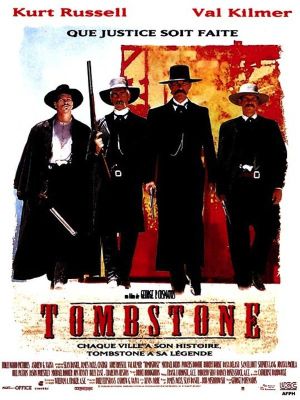À l’orée de Tombstone, un mariage se consume sous les fusils et la poussière s’élève comme une nappe de théâtre. Le film annonce alors son programme : l’Ouest ne sera pas traité comme un musée mais comme un espace d’ondes, d’embrasements, de contre-jours où les silhouettes se découpent avec une netteté mythologique. La mise en scène avance par blocs clairs, un découpage qui privilégie l’axe frontal et les travellings courts pour faire vibrer la tension dans la durée plutôt que dans la surenchère. Chaque surgissement d’armes devient une question de géométrie. Au cœur de ce ballet, Wyatt Earp se tient comme un plan fixe mobile, force vectorielle qui réorganise l’espace par sa seule présence, tandis que Doc Holliday, silhouette blême et ironique, en fissure l’ordre par le verbe et la maladie.
Le duel au OK Corral ne se contente pas de rejouer une liturgie célèbre. Il s’articule autour d’une dramaturgie du regard et de la distance. Le champ-contrechamp s’y resserre jusqu’au plan américain, la profondeur de champ se charge de diégetique poussière, les raccords sur le mouvement tracent des diagonales qui inscrivent les corps dans une cartographie précise. La violence est sèche, musicale dans son rythme de souffle et de détonations, jamais complaisante. On y sent un classicisme revendiqué, mais un classicisme baroque, traversé de fulgurances, notamment ce motif chromatique du rouge des foulards qui lacère l’ocre des décors et fonctionne comme une ponctuation visuelle.
La photographie cherche une lumière rasante, presque minérale, qui transforme les rues en couloirs d’air et de sable. Les intérieurs sont sculptés par des sources latérales qui modèlent les visages en reliefs de fièvre. Cette cohérence plastique n’exclut pas quelques effets plus appuyés, une brume ou un contre-jour qui sursignifie la légende, mais leur emphase n’écrase pas l’ensemble. La partition, ample et cuivrée, accompagne la progression tragique avec une noblesse parfois démonstrative. Elle sait toutefois se retirer pour laisser entendre ce qui fait la matière du western : bottes sur le bois, cuir qui crisse, souffle des chevaux, sonorité sourde des colts qui raccourcissent les phrases.
Le film travaille la figure de Wyatt comme un opérateur moral. Ses entrées de champ réordonnent le cadre, ses regards dictent la place des autres. Son héroïsme n’est pas celui du surhomme mais d’une ligne droite maintenue dans le chaos. Le montage l’inscrit dans une trajectoire patiente qui bascule au moment de la vendetta, lorsque la cavalcade fend la pluie et que les éclairs découpent les cavaliers en bas-reliefs électriques. Dans ces instants, Tombstone touche une forme d’opéra minéral. La caméra épouse le mouvement sans hystérie, par glissements, panoramiques mesurés, accélérations ponctuelles. Par endroits l’enchaînement se fait trop elliptique, comme s’il fallait précipiter un mythe vers sa résolution, mais la pulsation demeure.
Face à ce bloc d’autorité, la performance de Val Kilmer en Doc Holliday offre la contrepartie la plus précieuse. Le timbre traînant, le corps en angle, l’ironie comme dernière politesse, l’homme malade habite le cadre tel un contrechamp moral. Il aimante la mise en scène qui le freine à peine, le suit au seuil de la mort dans une chambre blanche où la lumière, soudain, ne dramatise plus rien. La manière dont le film dose son humour sec, posé en lisière des échanges, empêche la raideur du monument. Quelques lignes de dialogue, devenues proverbiales, y gagnent une tenue littéraire qui n’alourdit pas le récit.
Dans l’histoire du western des années 90, Tombstone se dresse à égale distance du révisionnisme grave et du pastiche. Il choisit une voie de classicisme réanimé, où l’icône retrouve sa densité sans perdre sa complexité. Le récit d’amour final, presque trop poli, pourrait sembler une concession, mais il sert une idée simple : l’épopée ne vaut que si elle laisse un reste de vie, une danse possible après la poudre. Il subsiste alors l’impression d’un film-signe, net comme une enseigne de saloon au crépuscule, qui aurait traversé la poussière pour redonner aux corps un poids, aux regards une portée, et au western sa tenue d’apparat.