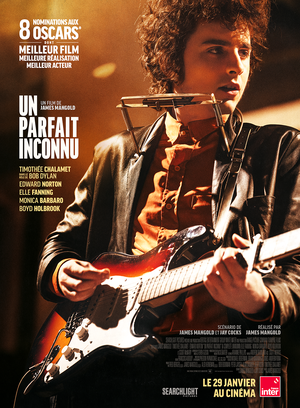Les biopics pullulent à Hollywood et n’épargnent aucune icône, même les plus sulfureuses. Le réalisme est souvent la dernière des préoccupations. Ce qu’on veut, c’est entériner la légende et exorciser les démons. La scène est là pour racheter les fautes, et une généreuse performance suffit souvent à immortaliser l’icône. L'intérêt du film de James Mangold tient justement à son réalisme strict. Il n'essaie pas de cristalliser une image de Dylan, mais de montrer les multiples visages d'un homme né avec un talent rare et une conscience intime de sa supériorité.
Quand il rencontre son idole, Woody Guthrie, Dylan a un moment d'hésitation avant de jouer devant lui. Le personnage d'Edward Norton lui demande s'il est timide. Sa réponse en dit long : "D'habitude non". C'est sans doute le seul moment du film où l'on voit Dylan légèrement troublé. Même quand il reçoit une lettre de Johnny Cash, il semble trouver ça normal et une relation d'égal à égal s'installe immédiatement. Dylan cultive aussi bien cette attitude que le récit qui la soutient. Il prétend qu’il a tout appris au cirque, raconte une vie de bohème auprès de cowboys et de freaks. Là encore, le point de vue de Mangold est remarquable car en faisant le choix de ne pas explorer le passé de Dylan, il fait preuve en apparence d'une certaine complaisance avec ce récit des origines et la posture égotiste de Dylan qui veut qu'on ne soit défini que par soi-même. En réalité, il laisse plusieurs fois des fissures apparaître, comme lorsqu'une amie de Sylvia parcourt l'album d'enfance de Dylan, ou lorsqu'il effleure à plusieurs reprises la question du nom de naissance, sans jamais approfondir. Il est d’ailleurs assez rare qu’un biopic ne nous montre ni le Père, ni la Mère. Ici, Mangold joue le jeu de Dylan, mais sans être jamais dupe. Il y a une forme de respect pour le mythe teinté d’ironie, comme si Dylan avait réussi cette prouesse d’effacer ses traces et de rendre sacrilège tout effort archéologique.
Si le talent de Dylan est une certitude inébranlable tout au long du film, son intégrité artistique est quant à elle sujette à un questionnement continu. Dès le début, alors qu'on voit Joan Baez refuser de jouer le jeu des grands studios, Dylan lui n'éprouve aucune réticence à sortir un album de reprises. On ne le voit ni crier au scandale, ni se battre pour chanter ses propres chansons. C'est uniquement l'échec commercial de son disque qui l'incite à changer d’approche. Et un grand nombre d'indices, disséminés par la mise en scène, laisse penser que la vraie préoccupation de Dylan est d'être avant tout un musicien reconnu, et qu'il est prêt à se plier aux règles du milieu pour y parvenir. Il laisse Joan Baez chanter Blowin' in the wind avant lui parce qu'il sait qu'elle est plus connue que lui, et qu'elle peut l'aider à vendre son album. Le talent n’empêche donc pas les petits calculs stratégiques, ni d’ailleurs l’envie et la jalousie.
On nous montre même au début un Dylan légèrement jaloux du succès de Joan Baez. Il n’en montre rien, mais dès qu’il peut la rabaisser, il n’hésite pas. Ainsi, il lui rappelle à plusieurs reprises qu’il possède ce talent d’écriture qu’elle n’a pas. Cette passion qu’il y a entre eux n’a vraiment rien de sentimental. Elle naît d’une admiration mutuelle pour le talent de l’autre, qui s’effondre à mesure que Dylan se considère discrètement supérieur à Baez. Son autre relation du film ne le flatte guère plus, mais elle se termine d’une manière plus touchante. Sylvia voudrait l’avoir que pour lui, mais elle comprend que c’est impossible, parce que lui est incapable de se donner tout entier. Cette scène devant le ferry, à travers le grillage, est magnifique parce qu’on voit Dylan subir les conséquences de la règle de vie qu’il s’est imposé, à savoir de ne jamais être emprisonné par personne. On sent qu’il a beaucoup d’affection pour Sylvia, mais il reste incapable de passer de l’autre côté du grillage. C’est sa liberté qui l’entrave, qui l’empêche de la garder auprès de lui.
Toutes les tensions du film arrivent à leur comble lors de la scène finale. Les organisateurs du festival folk de Newport menacent d’annuler son concert s’il joue de la musique électrique. Son vieux protecteur, Pete Seeger, essaye de le convaincre avec le plus de tact possible de respecter la tradition du festival. Dylan n’écoute personne, il joue son nouvel album électrique. La foule le hue, lui jette des gobelets et des canettes. Là où on aurait pu glorifier l’attitude révolutionnaire de Dylan, Mangold pose un regard beaucoup plus subtil sur les événements. Il n’y a pas d’un côté les réactionnaires, et de l’autre Dylan, le génie révolutionnaire. Non, on nous montre aussi Dylan le destructeur de valeurs, qui méprise une nouvelle fois ses origines et n’est même pas capable de rendre un dernier hommage à la musique folk à laquelle il doit tout. Si ce n’était pour Johnny Cash qui lui tend sa guitare, Dylan ne serait sans doute pas remonté sur scène pour apaiser le public. Ainsi, tout révolutionnaire est autant un destructeur qu’un créateur, et il y a dans cette passion créatrice quelque chose de sombre et de violent qui fait qu’elle ne doit pas être louée aveuglément. On ressent chez Dylan cette haine du passé qui nous détermine et cette volonté de déracinement permanent. Au contraire, Pete Seeger et les organisateurs du Newport Festival représentent bien plutôt un attachement sincère aux valeurs transmises par la musique folk. Leur horreur de la musique électrique peut paraître bêtement réactionnaire, mais en réalité, c’est la peur de perdre ce qui leur tient le plus à cœur, ce dans quoi ils ont mis toute leur âme, qui les fait autant paniquer. Tout l’inverse de Dylan, qui ne met son âme dans quelque chose que pour l’en extraire ensuite. Il n’y a ici aucun culte à l’artiste, mais plutôt une réflexion sur le fardeau du talent, qui, dès lors qu’on s’y complait, sépare l’individu de ses semblables et fait de lui aussi bien un ange qu’un démon.