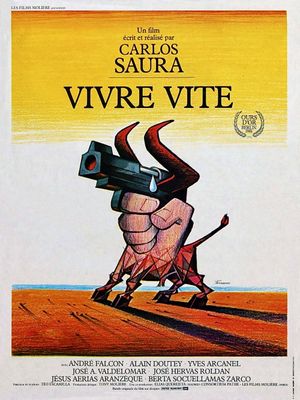Dans l’Espagne post-franquiste, entre espoirs démocratiques et fractures sociales béantes, un groupe de jeunes erre dans les faubourgs de Madrid. Ils volent, fuient, s’aiment et tentent, à leur manière, de respirer un peu plus fort. Carlos Saura ne les juge pas, mais les filme dans leur quotidien, sa caméra captant avec honeteté et sans complaisace des acteurs non professionnels, mais bouleversant de justesse.
Et cette justesse sociale du film est saisissante : elle se lit dans les regards, dans les silences, dans les lieux déserts et les gestes simples. Pas de discours, mais une immersion totale dans une réalité qui résonne encore aujourd’hui : celle des marges, de l’exclusion, de la fuite en avant quand tout semble fermé.
Mais Vivre vite, c’est aussi une histoire d’amour. Pablo et Ángela vivent leur relation comme une échappatoire, un sursis, une tentative de donner du sens à une existence qui les malmène. Leur passion est belle parce qu’elle est fragile, lumineuse parce qu’elle se sait condamnée.
Le romantisme ici n’est pas rose — il est noir, nerveux, désespéré. Il ne cherche pas à sauver, mais à exister. Il éclaire brièvement avant de brûler.
Tout, dans la mise en scène, respire l’urgence : le rythme, la lumière, les musiques populaires, les scènes filmées comme volées à la réalité. Vivre vite est un film qui vit à la vitesse de ses personnages : sans filet, sans avenir, mais avec une intensité fulgurante.
Quarante ans plus tard, ce chef-d’œuvre discret continue de toucher. Parce qu’il parle de la jeunesse comme peu savent le faire. Parce qu’il montre l’amour et la révolte avec une sincérité désarmante. Parce qu’il nous rappelle, sans crier, ce que c’est que vivre trop vite dans un monde trop lent.