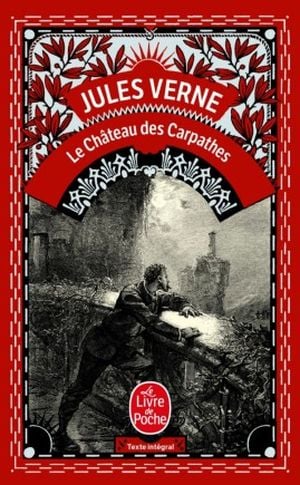Carnet de Curiosités : Lectures 2025
Carnet 2013 : https://www.senscritique.com/liste/Carnet_de_curiosites_Lectures_2013/166185
Carnet 2014 : https://www.senscritique.com/liste/Carnet_de_curiosites_Lectures_2014/361673
Carnet 2015 : https://www.senscritique.com/liste/Carnet_de_curiosites_Lectures_2015/720171
Carnet ...
150 livres
créée il y a 11 mois · modifiée il y a environ 15 heuresLe Château des Carpathes (1892)
Sortie : 1 décembre 1892. Roman
livre de Jules Verne
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
Verne doublement décevant.
Ce n'est pas un très bon Verne par manque d'aventures, de fraîcheur et de sciences. Je n'ai pas ressenti ce petit frisson régressif évocateur de l'enfance (et des vacances).
Ce n'est pas non plus un très bon roman gothique tant Verne coupe court à toute imagination en précisant bien que ce sont des gueux arriérés et que tout sera expliqué par la Science avec un S majuscule. D'ailleurs le jeu d'illusions et de machineries ne cherche jamais à faire planer le doute et n'est, au demeurant, pas si évolué ou inventif que ça.
Georges de La Tour (2025)
Entre ombre et lumière
Sortie : 10 septembre 2025. Beau livre & artbook, Peinture & sculpture
livre de Gail Feigenbaum, Pierre Curie et Paulette Choné
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
{2 clair-obscurs français auront fait parler en 2025 : Expedition 33 et George}
Ce catalogue et la communication de l'exposition se targue d'être la première rétrospective sur le peintre depuis 1997. Tout en ayant moins de la moitié de l'œuvre. Admettons, c'est le jeu des prêts ma pauvre pinacothèque. Mais c'est encore une fois une exposition squelettique à cause du parcours une exposition étriquée, engoncée entre ses murs, sans possibilité de salles thématiques, de coins "dossier" pour mieux montrer l'après, l'avant, l'en-face et l'à-côté. Certes cela oblige à la distillation mais frustre. Sans parler de la foule, de l'impolitesse des visiteurices, du manque d'assises pour juste pouvoir profiter des tableaux, s'immerger plus de 30 secondes dans la cohue. Parcourir ces cimaises est toujours un chemin de croix, un véritable calvaire qui gâte le goût.
Plus encore qu'Artemisia le catalogue est beau mais étique. Il manque à mon sens d'ampleur savante et d'horizon historiographique : à peine 3 essais qui synthétisent bien mais synthétisent seulement. Manquent de grands noms et des articles, si ce n'est novateur, inédits comme le font les catalogues des autres grands musées. Bonfait qui avait affiné et nuancé toute cette histoire des caravagesques en 2010 me semble trop peu repris.
Pur goût personnel le ton de Paulette Choné me hérisse.
[laïus répétitif] Chronologie classique : à quand de la dataviz dans les catalogues d'exposition pour nous montrer l'éclatement géographique des œuvres, leurs parcours, attributions et réattributions. Mises en parallèles de diverses données, hétérogènes. On y parle souvent de copies et de modèles qui n'ont pas le droit à leurs reproductions ni au jeu des 7 erreurs. Les musées intègrent de plus en plus ces représentations alternatives, stimulantes voire fertiles, dans leurs scénographies.
« Comment fait-il les plis ? Qui lui a appris cela? Il en fait le moins possible, mais c'est sans procédé tout fait, ils semblent exécutés d'après nature. La manche de lingerie, c'est une technique toute différente, une surface d'un gris vaporeux sur laquelle courent de menus serpentins soit en chenille, soit en flammèches. »
Humiliés et offensés (1861)
Униженные и оскорбленные
Sortie : 1866 (France). Roman
livre de Fiodor Dostoïevski
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
Je suis un peu lâche avec tonton Fiedor. Je renâcle malgré l'amour. Je n'avais pas le courage pour les grand, les gros. Alors j'ai pris son premier vrai roman dostoïevskien après les premiers.
«— Des romans, des romans ! prononça le prince à mi-voix, comme pour lui-même. La solitude, l’inclination aux songes et la lecture des romans ! »
Du théâtre ça, avec les personnages qui sortent tandis qu'un autre entre, les rencontres inopinées les et fortuites dans un grande ville. Histoires de cœur, de mariages, magouilles de mélodrame (je crois que sans le nom accolé la moyenne éclaireur serait loin de ces hauteurs) et quelques revirements ou révélations sans surprise. Ça crie, ça chouine, ça prend la fièvre et ça s'écroule sur le parquet. Le personnage de Nelly m'a fait penser à ces tableaux "poverty porn" du XIXe à la W. Bouguereau représentant de (jeunes) femmes pauvres pour faire frissonner le bourgeois.
Je suis vache avec tonton Fiedor mais on n'y est pas encore. Ça ne retourne pas comme une crêpe.
{Il y a plusieurs années il y eut un boom, une bulle Marko dans laquelle tout le monde encensait sans limite ses traductions, définitives. J'ai l'impression que l'on en est revenu et que les réserves sont plus nombreuses. Un éclaireur écrivait que ses amis russes lui disaient que Marko redonnait enfin la vraie voix de Dostoïevski ; un autre écrivait plus récemment que ses amis russes ne l'aimaient pas, trouvant qu'il en faisait bien trop. A quel sensique se vouer ? J'aurais donc bien testé la nouvelle des Frères Karamazov (que j'avais commencé il y a 20 ans dans l'une de ces vieilles trad. désavouées.)}
« C’était une histoire lugubre, l’une de ces histoires lugubres et torturantes qui, si souvent, et sans qu’on les remarque, presque mystérieusement, se jouent sous le ciel lourd de Pétersbourg, dans des recoins obscurs et cachés de cette ville immense, parmi le bouillonnement débridé de la vie, de l’égoïsme obtus, du choc des intérêts, de la débauche la plus ténébreuse, des crimes dissimulés, dans toute l’obscurité de cet enfer d’une vie absurde et anormale… »
Séries parisiennes (2024)
Vues de quartier
Sortie : 27 juin 2024. Poésie
livre de Etienne Faure
Nushku a mis 4/10.
Annotation :
Rimbaud in Paris. Carte postale, boule de Soupline.
Épigraphe de Desnos. Qui sonne comme un épitaphe tant on dirait bel et bien de la poésie de cette période, surréaliste, vieille comme le siècle. Foin de RImbaud, of course. Mais du Follain, du Desnos donc, du du Fargue, du Roy ou certains Aragon, toute la poésie du Paris de la première moitié du XXesiècle en somme, sans l'originalité, à tout le moins l'actualité et la saveur de l'époque. Grammaire déconstruire, flottante, semblant par facilité plus que par la force des mots. Sans le Paris de l'époque : les arriérés d'une sclérosée fantasmée du passé, ou plutôt, peut-être, celle d'une ville réelle actuelle mais bourgeoise.
Après Vazquez cela fait bizarre, presque mal, de revenir à cette poésie blanche cadrée de rouge. Comme toujours je me demande qui achète et lit ça à part moi pour remplir d'obscures listes ? Les vieux réac ?
Avait-on besoin d'un poème sur les chevaux de la Garde montée à Paris en 2025 ?
Indice, je l'ai trouvé à la boutique du musée Jacqueme...-André où il y a plus de vaisselle, mug, tote-bag que de livres et certainement pas des essais érudits sur l'artiste accroché du moment et sa période mais de petits opuscules pour offrir à des tantes éloignées.
« La main heureuse
à la bibliothèque est celle
qui longe un rayon, débusque un ouvrage
inconnu aux yeux qui agréent soudain
les cinq doigts.
main heureuse »
Andromaque (1667)
Sortie : 1667 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
Mais monsieur le théâtre et moi ça fait deux, voire trois, je n'y comprend goutte, je ne l'entends guère. Dans la myriade, j'en lis si peu et je grince toujours des dents lorsqu'un poète nous impose son micro-mélodrame fastidieux et étique. Peut-être devrais-je m'y rendre plus souvent après tout ? J'ai toujours aimé les quelques pièces vues, antiques, la Comédie française, du Shakespeare. Allons bon c'est que de tous je préfère Eschyle (oui, même et surtout à Sophocle, dès Euripide je décroche ; les Romains n'en parlons pas) : il n'y a pas encore toute cette pompe et cette unité de lieu si contraignante, coupante, frustrante. Ça chouine, ça crie, ça s'effondre sûrement sur le parquet, Oreste prompt à poignarder tout ce qui passe comme à son habitude.
*
(mais déformons, pas de purisme en mythes) « Je ne crois pas que j’eusse besoin de cet exemple d’Euripide pour justifier le peu de liberté que j’ai pris ; car il y a bien de la différence entre détruire le principal fondement d’une fable, et en altérer quelques incidents, qui changent presque de face dans toutes les mains qui les traitent. »
Agéladas d'Argos (2025)
Contre Thèbes
Sortie : 5 novembre 2025. Théâtre, Essai
livre de Pierre Michon
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
« Approchons-nous, Monsieur, n’ayez pas peur.
Vous avez bien gardé le ticket d’entrée ? Passons ces salles, laissons tomber les poteries, les épées et les fibules, les bidules pour spécialistes.
Ah, ils doivent être là. Je cherche la porte de derrière, l’issue de secours ; ce sera moins effrayant de les surprendre à rebours, pour faire connaissance.
Ce doit être cette porte-ci. »
Comme RF c'est une commande. Mais Michon n'est-il pas à son plus fort contraint ? Il a refusé (dit-il) Rembrandt comme il avait proposé Monroe à l'époque. Contre l'évidence et la superposition.
Les bronzes de Riace que Michon nous dit inconnus. Foutaises ! Longtemps regardés : aux lisses marbres faussement blancs j'ai toujours préféré la puissance du bronze. (Itou l’aurige de Delphes, le pugiliste...)
Excroissance de J'écris l’Iliade ? J'écris les Sept. Où est-ce un vieux fond de tiroir ? encore plus dans l'auto-parodie trop consciente et une ironie suspecte, louche, qui dans les anciens, les "vrais" Michon n'était qu'à demi mot, en sourdine, rejetée dans les marges de mensonges pour gourmets. « Remake des Onze ». Il n'en sortira pas. Au moins n'évoque-t-il plus VM, Avance-il dans la clôture de ses prétentions ? Lire Michon « à nu » est-il encore possible tant l’écrivant vient se jucher pour se juger ? Collage et fragments ; parfois on craint du Claro.
Soit. Il parle de l'antiquité comme Giono, comme j’aime, aka toujours présente au coin de la rue, prégnante, extirpée au fond diffus littéraire, classique dira-t-on. Je suis persuadé qu'il l'a relu. Ma maigre preuve ? Son "mettons". Phrase tout aussi rapide, hachée, le tac-tac sec d’interjections, pis le cul cru inutile.
« C’est bien un amphigourique "essai autobiographique", que vous m’avez commandé ?
Portant sur une immortelle « œuvre d’art », en plus ? Vous y allez carrément. Vous ne vous refusez rien.
Je récapitule les trois clauses majeures. Premièrement : le thème doit être un chef-d’œuvre universel très visible, peinture ou sculpture. Deuxièmement : l’écrivain narrateur est fermement invité à la forme de l’essai critique ; mais paradoxalement il doit en plus s’étendre sur les effets de cette œuvre dans sa propre vie. Troisièmement enfin, le livre aura pour titre le nom du vieux Maître, cela va de soi et importe peu.
Eh bien voilà : pour le paramètre autobiographique du contrat d’édition je suis bien là en personne, dans ce musée de Reggio au bout du monde ; je vous y ai embarqué avec moi ; pour "l’essai" je vais essayer
L'Événement (2000)
Sortie : 14 mars 2000. Roman
livre de Annie Ernaux
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
« (Si j'avais à représenter par un seul tableau cet événement de ma vie, je peindrais une petite table adossée à un mur, couverte de formica, avec une cuvette émaillée où flotte une sonde rouge. Légèrement sur la droite, une brosse à cheveux. Je ne crois pas qu'il existe un Atelier de la faiseuse d'anges dans aucun musée du monde.) »
Épineux face à ce type de texte de ne pas tomber dans la facilité de mots-clefs certes adéquats mais attendus ou, pire, la métaphore malvenue comme une écriture clinique, la phrase au scalpel, etc. Oh non par peur du sacrilège mais car le texte se suffit à lui-même, s'auto-alimente (à l'inverse de ces récits qui se dévorent) et que ce serait superfétatoire.
« Sans doute parce qu'une mémoire primitive nous fait voir toute la vie passée sous la forme élémentaire de l'ombre et de la lumière, du jour et de la nuit. »
*
« Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement – la clandestinité – relève d'une histoire révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie – même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de « c'est fini tout ça », si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce que aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années soixante-dix – « violence faite aux femmes », etc. –, affronter, dans sa réalité, cet événement inoubliable. »
Le K (1966)
Il colombre e altri cinquanta racconti
Sortie : 1967 (France). Recueil de nouvelles
livre de Dino Buzzati
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
{Relecture intégrale}
Au collège certaines nouvelles fantastiques m'ont marqué : la cervelle d'or, l'escamotage de Matheson, une ou deux de Lovecraft, Gautier, et aussi celle du petit Dolfi.
54 vignettes. Comme plonger sa main dans un bol apéritif. Amandes kafkaïennes, pistaches métaphysiques à décortiquer, noisettes fantastiques, cajou à portée morales. Toutefois la grille de lecture de Kafka me paraît avoir des mailles trop petites. Je le placerais stationnaire entre Borges et Aymé (qu'il ne connaissait sans doute pas), se frôlant mais ne se touchant pas. La vie y est triste, morne grise comme chez Bove. On replonge la bouche encore pleine et l'on finit un peu le cœur au bord des lèvres à ainsi n'avoir pas su s'arrêter. Ne s'est-on pas coupé l'appétit ? Toutes ne sont pas aussi marquantes, parfois maladroites, voire datée (les femmes... séductrices, dominantes ou capricieuses...) et la catabase finale, complaisante, datée, déçoit.
*
« Je vis alors à mes pieds, avec une précision merveilleuse, la ville jusqu’à ses lointains faubourgs. La lumière opaque et livide du jour avait baissé et les fenêtres s’étaient éclairées. Milan, Detroit, Düsseldorf, Paris, Prague, mélangées dans un délire de gratte-ciel et d’abîmes, resplendissaient, et dans cette immense coupe de lumière des hommes s’agitaient, ces pauvres microbes, talonnés par le galop du temps. L’épouvantable, l’orgueilleuse machine qu’ils avaient eux-mêmes construite tournait en les broyant et ils ne fuyaient pas, au contraire, ils se bousculaient pour se jeter au plus profond des engrenages. »
{Carta’ en aurait fait 50 pages}
*
« Il y avait aussi, dans cette lutte contre le vent, une exaltation perverse. Nous nous sentions intensément vivants, dramatiques, différents.
Jusqu’au moment où il souffla vraiment trop fort et où il nous brisa, c’est du moins l’impression que nous ressentîmes. Comme si le souffle de la tramontane lacérait, déchiquetait en les éparpillant au fur et à mesure en petits morceaux nos personnes, nos paroles, nos gestes, notre pauvre histoire, tout ce qui nous entourait comme du simple papier.
Voici le pont qui était si romantique dans les jours lointains, mais oui, au crépuscule. Et maintenant on dirait un fant… »
Dante et Virgile aux enfers (2004)
d'Eugène Delacroix
Sortie : 1 avril 2004. Beau livre & artbook, Essai, Peinture & sculpture
livre de Sébastien Allard
Nushku a mis 8/10.
Annotation :
Lire un catalogue d'exposition 20 ans après l'avoir visitée, c'est un concept. Catalogue d'une expo de 2004 au Louvre. Je n'avais pas pris le catalogue.
Mon tableau préféré. Normal : l'un de mes peintres préférés illustrant l'un de mes ouvrages préférés. Je déteste le Dante de Bouguereau, figé et pétrifié, platement descriptif, illustratif.
Mince catalogue, couverture souple, format presque carré, ce n'est pas encore ces jolis bouquins, beaux-livres à grosse couverture cartonnée, mais est riche en textes, avec a contrario, des reproductions petites comme des vignettes : dur de profiter des dessins du maître, et en n&b, dur de profiter des tons, couleurs du boss.
J'adore les expo-dossiers : remonter le fil, farfouiller dans les feuillets, explorer les environs plus ou moins lointains, lire les lettres pour reconstruire l'idiosyncrasie d'un tableau, la singularité replacée dans une trajectoire, un zoom sur ce moment sans perdre de vue les alentours. L'exposition Carpeaux d'il y a 10 ans était ainsi un assemblage de ces petits dossiers.
Allard y dépiaute la Barque, les croquis préparatoires, les inévitables inspirations antiques, renaissantes, moderne, l'influence tout sauf superficielle du texte de Dante sur Delacroix, vrai (et seul ?) peintre littéraire, le retour critique, la postérité. J'aime d'autant plus le tableau.
Chenique avait publié un ouvrage très intéressant sur l'influence et rivalité à sens unique entre le peintre de la Barque et le peintre du Radeau, 'Géricault, Delacroix : La barque de Dante ou la naissance du Romantisme'.
Fantasme d'un tableau jamais peint mais envisagé par le maître, celui des traîtres pris dans les eaux gelées du lac, mélimélo géricaultesque de têtes et seuls les pieds vus du duo arpenteur. C'eut été plus fort que le tableau statique, sage de Doré, bougeauresque de Doré.
Tiens, pas de Chauveau "La frénésie Delacroix" ou "l'ardeur Delacroix", le Tumulte.
IDÉE : lire enfin son gros journal.
Orient/Occident, mode d'emploi (2015)
East meets West
East meets West
Sortie : 29 janvier 2015. Beau livre & artbook, Culture & société
livre de Yang Liu
Nushku a mis 5/10.
Les Héraclides (1995)
Sortie : 1995 (France). Articles & chroniques
livre de Jean Giono
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
« Sur les 152 chroniques que Jean Giono écrivit pour la presse, 91 d'entre elles ont été réunies par les éditions Gallimard dans trois recueils posthumes : Les terrasses de l'île d'Elbe (1976), Les trois arbres de Palzem (1984) et La Chasse au bonheur (1988). Une vingtaine d'autres chroniques sont venues grossir le recueil Provence. [Lus donc] Enfin, une petite dizaine de ces textes ont été repris en divers lieux, notamment dans les volumes de la collection La Pléiade. Si l'on élimine la quinzaine d'articles parus en 1970 et qui ne sont en fait que des ‘repasses’ quasiment littérales de billets plus anciens, il restait jusqu'à ce jour 19 chroniques demeurées inédites depuis leur publication dans le courant des années 60 dans Le Dauphiné libéré. »
« Sur ces 19 là, nous avons choisi d'en éliminer deux (Casse-noisettes et L'Ecusson), parce qu'elles nous semblaient avoir, disons, mal vieillis... C'est ce reliquat de 17 textes qui compose le présent volume. » [curieux de les trouver, ça fait peur.]
Impression de déjà lu tant Giono avait ses petites marottes, micro-obsessions qui le tenaient quelques temps. Je suis allé vérifier, le texte sur Évariste Huc n'est pas le même que dans de Monluc à la Série noire. Quand il parle d'Homère, annonce de Michon ; parallèles avec l'Hélène multiple de Calasso.
J'aime Giono mais il ne se rend pas toujours facile à aimer. Le gros du recueil c'est du Giono réfractaire, pour ne pas dire réac, rétif en bloc, sans faille, aux trois mots maudits progrès vitesse modernité. Il n'a pas vraiment tort mais n'a pas raison non plus. Souvent de mauvaise foi, préférant le miroir obscurcissant à d'autres optiques. Il aurait pu écrire des romans de SF dystopique : à la nouvelle d'une première greffe d'organe il imagine tout de go les dérivés, pauvres comme bétail, moissons de bébé.
Oh mazette maintenant je rêve d'un space-opera écrit par Giono, avec des fragments d'horreur - fragments d'un paradis et le Hussard prouvent qu'il savait le faire. Angélique lorgnait bien du côté de la fantasy historique !
Le Voleur (1996)
Le Voleur de la Reine, tome 1
The Thief
Sortie : 3 octobre 2025 (France). Roman, Fantasy
livre de Megan Whalen Turner
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
Il y a dans ce roman de fantasy (j'ai peine à écrire héroic) quelque chose de terriblement classique, de presque de fade pourrait-on dire mais qui me plaît plus que les grands cycles en 12 tomes de 800 pages avec des dramatis personæ longs comme ce livre de 150 pages et du worldbuilding et du lore pour saturer ds serveurs de wikia. Oui le monde est dépeint à très fines touches et n'a rien d'original, c'est de l'Europe à peine gaussée façon Kay. C'est brossé à hauteur d'homme, même d'adolescent. C'est simple comme bonjour : un casse à faire, on y va, on en revient et baste ! Oui, l'on passe plus de temps à décrire la fraicheur des chevaux et le petit-déjeuner, comme chez Le Guin ou comme chez Hobb, qu'à décrire des batailles et bastons sans fin, Jaworski j'écris ton patronyme, et c'est ça qui me plaît. Dès lors, petit manque de sensualité et de précisions dans les descriptions alors que l'on s'attarde beaucoup sur les sensations des protagonistes.
Un petit twist qui fait perdre de la cohérence au personnage principal, narrateur non-fiable.
Il paraît que la suite se bonifie à défaut de se complexifier. Ou vice-versa.
Ruines-de-Rome (2002)
Sortie : janvier 2002. Roman
livre de Pierre Senges
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
L'un de ces livres repérés il y a belle-lurette, presque à leur sortie, réservés dans des paniers, des étagères et qui, tout ce temps, en parallèle, avancent et font leur petit buzz et quand enfin l'on se décide à les lire, l'impression d'arriver après la bataille, d'avoir été volé de je ne sais quelle primeur idiote. Tout ça pour dire que je ne sais plus ce qui m'avait freiné à l'époque malgré titre, 4e de couverture. Je serai dur.
Même ambiance que Saisons. Un monde délétère, délabré, qui semble creux derrière la pierre, boue figée prête à s’effondrer, s’amollir pesante, à la moindre goutte de pluie.
_Jardins statuaires_
Baroque retenu, ors éteints. Huysmans, Laforgue, le Flaubert encyclopédique mais texte aphone, presque atonal. Plus que Mancé, Chevillard prenant un objet et le faire tourner sous toutes les coutures, filer la métaphore et de descendantes radicelles.
Puisque Senges est de ces auteurs que j'imagine facilement pouvoir écrire sans discontinuer sur des milliers de pages, fortes de mots rares, de termes scientifiques ; longues phrases corsetées de virgules truffées ras la moelle de références, d’allusions érudites, dénichées dans les palimpsestes, saupoudrées d'humour en dépit de tout. En somme un Chevillard chaleureux donc, moins pointu, pour les lecteurs de Borges en peignoir de chambre. Comme l'auteur de l'autofictif, malgré (à cause ?) de cette maestria formelle et de cette sprezzatura où l'on ne sent aucun effort, je ne retire pas autant que je devrais. Ces livres commencent, se terminent sans apparente nécessité, tout s'écrit — malgré l'apocalypse — sans urgence. Jeu et, peut-être les mots sont-ils fort, surtout pour un auteur que j'apprécie, creux, vain.
Brillant, malicieux mais tournant à vide. J'allais rajouter érudit mais à quel point Senges est-il venu puiser au grès des sonorités plutôt que de suivre les Liné ? Il n’a sans doute pas la main verte. Lecture étouffante, compacte, sinueuse mais entre d'étroits murs. Très vite j'ai lu sans lire, sans plus comprendre ni écouter la phrase, au vrai sans but. J'aurais pu reposer le livre, ne jamais le reprendre. Qu'en ai-je retiré ?
(Oh depuis on en a écris de tels manuels de botanique rebelle, de friches comme zones à défendre, au premier degré. Ce texte paraît d’autant plus frivole, voire inactuel.)
Traduction vers le rose (2023)
Sortie : 28 avril 2023. Fantasy
livre de Esmée Dubois
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
La main gauche de la nuit ou le Désert des tartares glacés. Jouant à Silksong j'ai imaginé les couleurs et les perspectives comme HK. Si le texte avait eu un twist d'un monde d'insectes et non d'humains je n'aurais pas été surpris. Au-delà de la perméabilité arbitraire, le monde de Dubois est souvent vaporeux. Elle nous parle de sensations et il est pourtant si peu ancré.
La logique de cette novella n'est ni celle du rêve ni celle du réalisme, encore celle moins des habituels systèmes fantasiens, mais bien celle de la poésie. Dubois explique sa méthode qui semble en effet partir d'images, plus précisément, dévoile-t-elle, d'un tableau, et le reste de s'accrétionner presque tout seul à partir de ce noyau irrégulier (plus que le fameux grain de sable qui donne la perle, le noyau plissé de la Terre qui donne les plaques, les montagnes). De là découle l'asyndète accentuée par les sauts de narrateurices. (D'où aussi les apparentes incohérences : comment Begga a-t-elle trouvé toute celle le rituel, déjà établi de la traduction du froid en chaleur ? Aude borgne voit "de ses yeux", insensible souffre de ses lèvres ?) D'où ce froid abstrait, impalpable, si loin de la véritable froideur telle que nous la connaissons. Il y aurait, soit dit en passant, un grand livre métaphysique, la Peste, la Horde, le Hussard, sur le froid.
Étrange, différent, maladroit mais qui sans me convaincre entièrement gauffrera l'esprit.
« Je sors dans la nuit tachée. Tout s'affaire dans le bois, comme j'aime : taches de lumière, chênes verts agités, vent dans les nuages, vent. Planant sur un courant chaud, literie de l'air, je pique à la vue du halo orange produit par la cheminée du beffroi et m'abats, pieds en avant, sur la surface gelée du fleuve. J’ai même mis des chaussures, pour l'occasion. »
Romain Bernini (2025)
Zeugma 01
Sortie : 2025 (France). Beau livre & artbook, Peinture & sculpture
livre de Dominique Gagneux, Romain Bernini et Florent Meng Lechevallier
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
J'aime bien lorsque des artistes contemporains investissent des vieux châteaux, palais, abbayes. Foin des Kermits ou plugs qui font, si ce n'est fureur, à peine scandale, juste parler pour égrener les mêmes clichés, ce sont souvent des frictions pleines de sens, cohérentes. Chambord par exemple, ou Chaumont dans une autre approche, proposent des choses équivoques et intéressantes, souvent... pour utiliser un vilain terme, jolies, voire belles.
Les couleurs acides, comme passées au vitriol de Bernini me font penser à la fois à celle du déjà classique Leonardo Cremonini et plus récemment de Laurent Proux.
Des arbres, des yeux d'animaux, des textures estampées de Fontevraud : rien de moins classique et pas de quoi sauter au plafond.
Panta Rhei (2025)
Jean-Pierre Formica
Sortie : juin 2025. Beau livre & artbook, Peinture & sculpture
livre de Matthieu Bameule
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
J.-P. Formica, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, se place dans cette mouvance d'artistes-archéologues modernes jouant des matériaux, des épaisseurs, textures et densités. Fouilles futures. On a vu passer Kiefer, le couple Poirier, Ugo Schievi dans ces listes.
Le texte : soupir. C'est toujours la même chose, un texte emphatique, laudatif et ultra-répétitif qui effleure à peine ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. Répétitif : cunéiforme tous les trois liges, archéologie moderne les 4 paragraphes. J'avoue n'y avoir pas pensé devant ces fûts luisant (Pourtant !) Mais argile oblige et une sorte d'automatisme... Laudatif, emphatique et si creux, disant les mots-clefs sans leur substance derrière, si peu de l'œuvre.
Citez De Biasi, le Land art, les artistes archéologues, chimistes, l’Arte poverta, que sais-je plutôt que trois vagues références à la Renaissance ; explicitez les influences directes et convoquez les voisinages artistiques d'artistes sans doute méconnus, ; donnez des explications techniques pour la mettre au jour, pour reprendre l'une des expressions répétées la technique.
Il n'est pas le premier à réaliser des sculptures de sel, par exemple.
L'œuvre : brouillonne. Manque de rigueur précisions, germe d’une vraie grammaire possible, de nouveaux ordres de colonnes, d’une antiquité à venir, avortée. Paradoxe de l'AC : trouver l'idée intéressante et astucieuse et le processus profond mais trouver le résultat fort laid. À remonter (ou descendre) les Alyscamps je suis loin d’avoir ressenti et éprouvé tout ce que le texte laudatif et répétitif nous promets et si j’ai bien vu ou compris les idées j’ai eu l’impression du brouillon à venir, de la note d’intention d’autre chose.
*
« Ses œuvres, tout en célébrant la finitude de l'existence, rendent hommage à la résilience de la vie et à sa perpétuelle réinvention. Elles nous offrent une synthèse du graveur, du peintre et du sculpteur, qui compose l'alphabet stratifié de l'artiste.
Panta rhei, souffle insaisissable, écho d'un instant qui se défait, d'un fleuve qui ne revient jamais, et pourtant qui perdure. Le monde s'efface et se refait, chaque instant un seuil, chaque souffle un départ. Chaque trace sur la terre, déjà balayée par le vent, pâlit à la caresse du soleil. La promesse de l'éphémère, l'éternité qui ne retient rien mais garde la mémoire de tout. »
Je me souviens (1976)
Sortie : 1976 (France).
livre de Georges Perec
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
C'est la force de ce livre, comme les listes à la Prévert et dans une moindre mesure les œuvres imaginaires de Levé, d'être à la fois terriblement périssable, au vrai déjà périmé, fort personnel (mais si peu intime) et majestueusement universel. Ce n'est pas tant ce dont Pérec se souvient qui compte, importe, intéresse (à part quelques vieux ?) mais les choses qui sous la voûte crânienne du lecteur émergent à son tour. Livres virtuels qu'il ne faudrait pourtant surtout pas écrire. La magie est dans cette transparence superposée au livre.
Aussi est-ce pour ça que même si tant de ces acteurs, chansonnettes, blagues, marques, ne nous parlent plus du tout (comme les références de King) ou sont devenues de populaire à une culture pré-classique, lire Je me souviens de Je me souviens de Brasseur ne paraît pas pertinent pour un sou, antinomique même.
*
« Je me souviens que j’étais fier de connaître et d’utiliser, relativement tôt, des mots et des expressions comme "à la rescousse", "estafette", "caducée", "dès potron-minet". »
« Je me souviens qu’à Villard-de-Lans, j’avais trouvé très drôle le fait qu’un réfugié qui se nommait Normand habite chez un paysan nommé Breton. Des années plus tard, à Paris, j’ai ri tout autant de savoir qu’un restaurant appelé Le Lamartine était célèbre pour ses chateaubriands. »
« Je me souviens de :
"Ich weiss nicht was soll es bedeuten
Das Ich so traurig bin."
et de :
"I wander lonely as a cloud
When all at once I see a crowd
A -?- of golden daffodils." »
Le Livre du large et du long (2023)
Sortie : 10 mars 2023. Roman, Poésie
livre de Laura Vazquez
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
Comme une poule devant un couteau.
Poule fascinée, corps et tête.
"Les jours glissent comme des connards"
« pour me lier aux images qui vivent dans le temps et je voyais autour de moi les insectes »
« tant et si
J’inventais mes propres règles »
Mots qui reviennent mais est-ce mon propre filtre ? Sol, la puanteur, les images.
Si j'écrivais de la poésie cela serait géologique, tellurique, biologique, cellulaire, cosmologique, quantique, bordélique, scientifique faussement, romantique par la bande, romanesque de biais et je n'oserais pas. Vazquez est tout ça, et plus encore.
N'est-ce pas ça que je cherche et recherche, dans la poésie contemporaine ? Pourtant si je ne manque pas de ronchonner sur la poésie des ronds de cuir Gallimard, j'aime ma poésie bien ordonnée : sonnets, rimes, vers bien comptés sur les doigts, laisses de versets justifiés, compacts. Ordonnée et courte : les longs poèmes efflanqués de Valery, par exemple, m'éreintent le souffle. Les sauts de lignes, les blancs, les majuscules, tout ce tralala m'empêche, bêtement je vous l'accorde.
J’aimerais dmpg lire plus, apprécier plus la poésie contemporain. ::Insérez ici le gif de Luchini et la hauteur d’âme::
N'est-ce pas ça pourtant que je cherche, recherche, dans le peu de poésie contemporaine que je lis (j'ai souvent pris et reposé les Vinclair) ? Une voie, une violence (une voix), une voile, voilance. Pas les faux modernes d'un langage urbain volé.
Artaud, Michaux, Lucrèce, oui mais aussi Joyce Mansour, parfois dans le rythme SJP. Tout cela est disséqué, mieux, par d'autres. Vazquez lance une longue chaîne de mots façon marabout, longuement retravaillée, où le sens se cherche, se creuse (l’écouter dans ses interviews).
Vous ne vous étonnerez pas si je dis n'avoir rien compris, mais retiré des images, une force, des effusions, des lances, laisses, lacets.
*
« Plus tard
À force de cheminer par l’intérieur et l’extérieur
j’ai formé les catalogu de ce qui nous entour
Le catalogue des visages celui des animaux les blancs poissons mammifères
insectes blancs et rouges bleus et gris funèbr et toutes pièces vues de la
naissance à ce jour toutes conversations véritabl et imaginair dans mon
cerveau et les expressions normal et anormales et les saveurs qui me
venaient dans la bouch sans manger je m’y intéressais »
Ça (1986)
It
Sortie : 1988 (France). Roman
livre de Stephen King / Richard Bachman
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
C'était long. Mais l'envie d'un truc épais et facile à lire sous le plaid. J'aime les livres long-courrier et en lis si peu ! Car tant me font envie, je n'arrive pas ; et ce indépendamment de l'implication ou du plaisir ; à ne pas vouloir en lire d'autres, souvent à l'opposé. En plein livre d'art, un roman de SF, de la poésie ?
Tout King est là. La petite ville faussement paisible et son voisinage scrutateur derrière des masques souriants, les derniers feux de l'enfance, les métaphores un peu lourdes et pourtant jamais réellement explicitées, les références full U.S.A. à gogo, absconses pour le lecteur francophone (dorénavant le lecteur étasunien ?)...
King mais encore plus ce livre est incarné, corporel. Les personnages semblent tous empêtrés dans leur carcasse. Cicatrices, surpoids, sueur, sang, violence en tous genres, bégaiement, désirs inavoués et foutre même avec la fameuse orgie (plus GB). Obsession gênante de King pour le corps pubescent de Bev. On dira que c'est dans le thème du passage à l'âge adulte, il ne parle cependant guère du zizi de Ricchie ou des noisettes de Richie... Ils passent leur temps à s'esclaffer, se rouler et pleurer de rire, pour des blagues peu drôles.
Par contre, tout ce que je croyais être des gimmicks de films d'horreur direct-to-netflix ou d'une série Flanagan, les hallucinations surréalistes sans fins avec cut sec de retour à la réalité sont en fait bel et bien dans le livre. Pouvoirs à géométrie variable, hallucinations plein air et jour : peu d'effroi, pas de trouble. Il y a ces passages ringards qui frisent le ridicule comme la statue géante similaires aux topiaires animales et au tuyau de Shining. Le clown ne fait pas peur. King en dit trop et en montre trop trop vite. Prenons aussi en compte la mini-suite, la duologie au cinéma : les images sont connues, attendues, certes.
Souvent gêné par le style. Je retrouve ce qui me heurtait il y a plusieurs décennies, l'argot daté, trop vulgaire qui n'était en fait pas celui de King, les expressions inusitées, les références purement étasuniennes parfois laissées brutes mais parfois adaptées, jurantes, les idiomes traduits mots à mot comme dans un scantrad et tout cela provient je crois de W. O. Desmond.
Le tongue twister original a plus de classe (et de liens thématiques) que le virelangue français et les chaussettes de la duchesse...
[suite en commentaires...]
Structura 3 (2014)
The Art of Sparth
Sortie : 15 novembre 2014 (États-Unis). Beau livre & artbook, Peinture & sculpture, Version originale
livre de Nicolas Bouvier (Sparth)
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
[La qualité de l'ouvrage, le piqué des impression est encore meilleur que les précédents ; la relire plus fragile.]
Sparth revient à ses débuts, chargé de ses expériences plus colorées et minimalistes. S'il s'échappe de sa période "line" il s'autorise quelques expérimentions voxel, 'neon' pas si mauvaises, trop rares.
Sparth incarne et même recherche les "happy accidents" de Bob Ross à partit de brush customs, de formes dégagées de textures façon De Vinci, effets de calques pour les couleurs. Ses images toute entières guidées par la composition, l'équilibre via le hasard, l'expérimentation, mouvantes, se recomposant sans cesse. Et c'est là je crois sa limite, partant ainsi d'un matériau pré-déterminé un peu malgré lui et toujours fluctuant ses images ne racontent jamais une grande ou petite histoire profonde où se perdre. J'ai toujours l'impression de voir chez lui la tentation repoussée de l'abstraction totale. Il affirmerait probablement le contraire. Plus le temps passe moins ses images m'impressionnent (précurseur sur de nombreux points, ses techniques récupérées et amplifiées par d'autres), moins elles me parlent.
Ou bien est-ce moi qui ai perdu cette faculté, capacité à imaginer tout un monde, des aventures, faire tout un roman d'une image floue (mais précise ? C'est ce qui le caractérise, ce flou précis si dur voir impossible à atteindre pour le commun des mortels.)
::2014. En '19 il disait "it will now be time to wrap up my 4th book, Structura 4"::
--
https://conceptartworld.com/books/structura-3-the-art-of-sparth/
*
"I have so much to explain about the digital art explorations I have been experimenting with these last 15 years. Basically, I have always tried to keep the excitement alive through the implementation of changes. Digital art is all about experimenting, testing, breaking things apart, and reconstructing them afterward. It's all about giving fresh materials to the eyes.
There will never be any end to it, since it's tightly connected to the evolution of new art applications and tools hitting the market, not to mention the use of 3-D tools inevitably emerging into the concept art world. But what prevails is the art process based on academic knowledge: shape balance, composition, color theory, narrative themes, and the way we make stylistic decisions to successfully join all these principles together. Beyond the tools and digital techniques, this is truly where the fun begins."
Survivance des lucioles (2009)
Sortie : 2009 (France). Essai
livre de Georges Didi-Huberman
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
Je croyais l'avoir déjà lu. Didi se place souvent dans un entre-deux malaisé, flottant : reprenant à son compte et malaxant à l'envi les mêmes références, Benjamin, Bataille, Agamben (Contre Agamben ici), Warburg ofc, etc. pour leur faire dire des choses peut-être pas si nouvelles, peut-être si l'on s'y connait à l'encontre de l'esprit. Ni vulgarisateur-passeur de ces penseurs, ni créateur de concepts inédits et forts, voués à durer, ni vraiment inscrit dans un cercle de pensée plus sobre. Ses livres sont toujours fourmillants et bouillonnants mais sans lignes de force dégagées. Il aime trop filer les métaphores jusqu'au bout pour sobriété et rigueur garder. Plus que bâtir des fondations avec des étais et des clous de fondation que seraient ses auteurs fétiches, il me semble tisser une fine coquille fragile, pas loin de cocciaceries. (Antichrist dans sa critique de Désirer, Déboérir résume bien ce double Didi). Il m'avait donc lassé. Pailleté, pétillant bulleux, mais un peu creux, tournant à vide sur les mêmes figures défigurées. Beaucoup de bluff ? Ses livres s'évaporent. Il m'avait lassé. Celui-là retend l'envie.
*
« Il savait le caractère indestructible, ici transmis, là invisible mais latent, ailleurs resurgissant, des images en perpétuelles métamorphoses. »
« Mais il faut opposer à ce désespoir « éclairé » que la danse vivante des lucioles s’effectue justement au cœur des ténèbres. Et que ce n’est rien d’autre qu’une danse du désir formant communauté (cela même que Pasolini devait mettre en scène dans le tout dernier plan de Salò, cela même qu’il cherchait encore, sans doute, sur la plage d’Ostie, juste avant que ne surviennent les phares de la voiture qui le mit en charpie) »
(« C’est une danse du désir dans la nuit parisienne, un contre-sujet aux mouvements des avions et aux féroces projecteurs de la guerre en cours. »)
Gens de Dublin (1914)
Dubliners
Sortie : 1974 (France). Recueil de nouvelles
livre de James Joyce
Nushku a mis 7/10.
Annotation :
/Traductions de Yva Fernandez, Hélène du Pasquier, Jacques-Paul Reynaud. Préface par Valery Larbaud/
Portrait de la ville en coupe, strate par strate. Comme chez Sherwood, publié 5 ans après Dublinois — mais a priori nulle influence directe.
Je ne peux cacher un brin de déception. Oh mais en restant dans une certaine mesure. Car Dubliners est somme toute de facture très classique. Jugement réalisé dans les limites de la traduction et de coups d'œil subreptices au texte original.
Si la plupart de ces nouvelles se déroule en plein été ce qui se dégage de ce livre c'est la mélancolie. J'ai préféré les récits courts, les premières, sur l'enfance, vignettes vaporeuses, rapides, tristes. Moins convaincu par les deux avant-dernières, surtout 'Grace' et toute ses allusions à la doctrine catholique ; l'ironie m'est passé en grande partie au-dessus de la tête. Parait pourtant que la structure est inspirée de la Divine Comédie. Puis la célèbre dernière nouvelle.
Et pourtant, quelque chose reste, tourne. Comme Seiobo : le texte demeure, perdure, se déploie par après.
{Un jour il faudra bien s'y coller.}
« Cette nuit, la ville avait le visage d’une capitale. Les cinq jeunes gens déambulèrent le long du Green Stephen clans un léger nuage de tabac odorant. Ils bavardaient gaiement, bruyamment, et leurs pardessus flottaient sur leurs épaules. Les gens s’écartaient sur leur passage. »
« Il se tint coi dans l’obscurité du hall s’efforçant de reconnaître l’air que chantait la voix, levant les yeux sur sa femme. Il y avait de la grâce et du mystère dans son attitude, comme si elle symbolisait quelque chose. Il se demanda de quoi une femme qui se tient dans l’ombre de l’escalier, écoutant une musique lointaine, pouvait bien être le symbole. S’il était peintre, il la peindrait dans cette attitude. Son chapeau de feutre bleu mettrait en valeur le reflet bronzé de ses cheveux sur le fond noir, et les panneaux foncés de sa jupe feraient ressortir les panneaux clairs. « Musique lointaine » serait le nom qu’il donnerait au tableau, s’il était peintre. »
L'Aventure (2015)
L'avventura
Sortie : 31 août 2016 (France). Essai, Philosophie
livre de Giorgio Agamben
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
6.9. Rapide, dense, enlevé.
« Ici, en effet, l'aventure, pour l'individu à qui elle arrive, s'identifie sans reste avec la vie, non seulement parce que elle investit et transfigure son existence tout entière, mais aussi et surtout parce qu'elle transforme le sujet même, en le régénérant comme une créature nouvelle (qui s'appelle, par convention, "chevalier", mais n'a rien à faire avec la figure sociale du même nom). Et si Eros et aventure y sont souvent intimement mêlés, ce n'est pas parce que l'amour donne sens et légitimité à l'aventure, mais, au contraire, parce que seule une vie ayant la forme de l'aventure peut vraiment rencontrer l'amour. »
*
« Comme on l'a suggéré Ranke l'aventure est pour le chevalier autant rencontre avec le monde que rencontre avec lui-même et, de ce fait, source de désir et d'effroi. Dans un lai de Marie de France,le protagoniste, après avoir rencontré la femme aimée, rentre chez lui en proie à un si grand trouble qu'il doute de lui et de ce qu'il a vu :
"Il pensait à son aventure
et doutant en son cour
il est saisi d'effroi, ne sait que croire
et il ne lui paraît pas qu'elle soit vraie."
(Lai de Lanval, v. 197-200)
Toutefois, plus étrange et risquée est
l'aventure, plus elle est désirable :
"Mais plus grande est la merveille
et plus risquée l'aventure,
plus il la désire et plus elle l'attire."
(Érec et Énide, v. 5644-5646) »
*
« Aventure apparaît au milieu de l'histoire car elle n'est pas, comme la Muse, la puissance numineuse qui préexiste au récit et donne la parole au poète : elle est plutôt le récit et ne vit qu'en lui et par lui. La dame n'est pas ici celle qui donne la parole : elle est l'événement même de parole - elle n'est pas le don du récit, mais le récit même. »
Augustin Frison-Roche (2025)
Épiphanies
Sortie : 15 janvier 2025. Essai, Peinture & sculpture
livre de Christiane Rancé
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
J’avais raté l’exposition aux Bernardins. Plus honnêtement, je ne m’étais pas non précipité pour aller la voir…. Pourquoi ? Car c’est beau, c’est sûr.
Je trouve ça jolie, joliet, mais à ma rétine défendante. Reniflant quelque chose d’autre. Les références coulent toutes seules. Les fonds d’or de Byzance, l’or encore de Klimt, son aspect décoratif (pincée de Mucha ici), les bleus de Sienne et même d’Odilon Redon ! L'anti-Masaccio (cf. plus bas), car plutôt que la Renaissance, un revival du gothique international. Or, il y en a eu plusieurs, fin XIXe, kitscheries début XXe gardées en vies sur des blogspots chineurs de peintres oubliés avec cette idée sous-marine d’un savoir-faire perdu. Peinture décorative à mille années-lumières de cette jeune vague de peintres néo-figuratifs mis en avant ces 5 dernières années : comme un réactionnaire pictural du début du XXe qui aurait refusé les courants modernistes en vogue. Cela sent la naphtaline ou plutôt la néo-naphtaline tant je vois d'artistes, souvent illustrateurs avoir une approche analogue, sans ironie (à l'inverse Tenmyou Hisashi, ultra-célèbre ou Yu Hong a une série inspirée d’icônes dorées) : Brad Kunkle joue de la feuille d'or ; Nikolaos Tower a un style sans imagination pas si éloigné... désuets. Bref, autrement dit, Frison-Roche ne jurerait pas au sein des couvertures Atalantes qui jouent, elles aussi, parfois, le jeu de l’archaïsme comme celles de Sarance que je trouve belles et osées et qui n’avait pas plu. Idem pour les couv. troubadour de la version poche du Chevalier aux épines) mais le peintre ne serait sans doute pas content de le voir ainsi rabattu du côté de la simple illustration fantasie. Je ne parlerai pourtant pas du fond ni du texte de Rancé : des Annonciations, Adorations, Christs, commandes d'églises. Frison-Roche (ni ses commentateurs Rancé, Ducay car sans surprise tous ses commentateurs...) ne "voit pas de différence entre le sacré et le profane". Position facile ! lorsqu'on se tient du côté que d'autres, justement, ne peuvent ou veulent accepter. On baigne dans la religiosité et cela m'éloigne de ces tableaux.
Le Promontoire du songe (1864)
Sortie : 1864 (France). Essai
livre de Victor Hugo
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
J'attendais un long poème en prose sur les gouffre sidéraux. Cela coupe court. Texte en deux parties disjointes. Litanie de chimères, monstres, dieux oubliés, obscurs, faux surtout dans la ligne droite d'une Tentation de Saint-Antoine ou des délires d'Artaud. Fût un temps j'aurais adoré ça. Beaucoup de léviathans.
« — Je ne vois rien, dis-je.
Arago répondit : — Vous voyez la lune.
J’insistai : — Je ne vois rien.
Arago reprit : — Regardez.
Un instant après, Arago poursuivit : — Vous venez de faire un voyage.
[...]
— Je ne vois rien.
— Regardez, dit Arago.
Je suivis l’exemple de Dante vis-à-vis de Virgile. J’obéis. »
Mais ce bout, ne dirait-on pas le Giono familier du Melville et de Blanche ? Peut-être une influence secrète entre ce Promontoire et le Poids du ciel avec leur cosmophilie à la pointe et la dérive des songes. Giono a souvent raconté à quel point son père admirait le poète Totor.
« Pendant ce temps-là, Astolphe va dans la lune. »
{
La préface d'ALB c'est tout ce que je déteste dans les avant-propos, de celles qui ne disent rien sur le texte, tout sur le préfacier : un chapelet de citations entre guillemets cisaillées de petites phrases sibyllines, définitives, voulant absolument ramener le texte à notre époque et le tirer à soi. Ici la télé-réalité et le recyclage (on devine le fond rance boomérisant). Elle affirme que ce texte de Hugo irritera. Pas du tout, par contre sa préface oui et guère pour les raisons attendues.
}
*
« Qu’on nous permette ce mot : chimérisme. Il pourrait servir de nom commun à toutes les théogonies. Les diverses théogonies sont, sans exception, idolâtrie par un coin et philosophie par l’autre. Toute leur philosophie, qui contient leur vérité, peut se résumer par le mot Religion ; et toute leur idolâtrie, qui contient leur politique, peut se résumer par le mot Chimérisme. »
La Fièvre Masaccio (2025)
Sortie : 20 février 2025. Roman, Histoire
livre de Sophie Chauveau
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
L'impression de me retrouver à 12 ans lorsque je prenais au hasard des livres dans la bibliothèque familiale pour tomber sur, certes, non pas de véritables romans de gare mais de la littérature d'autrices à la mode dans les années 70 ou 80, au succès évaporé, renommée oubliée. Voila, cela fleure bon les années 90. Car des années que je vois passer Le XX Botticelli, la YY Lippi, etc. Une formule Chauveau ? Il faut admettre que les titres attirent l'amateur de peinture. J'ai l'impression que cela s'adresse à ceux qui aiment tant la peinture mais sans vraiment lire dessus, se méfiant des spécialistes. Zut je fais du gatekeeping.
Je ressasse mais c'est cette histoire de l'art que j'appelle Taschen, celle des "génies", "grands hommes" à la téléologie sous-jacente, la révolution à venir, l'idée de la Renaissance comme révolution absolue, fracture. Masaccio défonce tout. Pourtant Lippi et Boticcelli iront vers plus de manières et un aspect décoratif, appelé pseudo-Renaissance par Zeri. Curieux donc de voir ce qu'elle écrit sur eux, si elle en fait des apôtres itou.
Étrange de le lire après Seiobo, son chapitre sur Lippi.
« La gravité des visages peints par Masaccio laisse pantois. Mélancolie, malheur, misère:toute l'humanité du monde semble concentrée dans cette chambre. »
"Écriture simple et fluide" disent-ils, je dirais hétérogène et désarticulée, heurtée, pas aussi mielleuse que ce que je pensais, pas autant le décor carton-pâte auquel je m'attendais. Un trouble inattendu, bienvenu. D'où le 6. Pour autant, dérivatif, répétitif surtout, comme si Chauveau peinait à trouver assez de matière à ses 260 pages et n'osait, ici, la recette Vuillard.
« À son arrivée, Masaccio ne voit rien, ne sait rien, ne veut pas trop en savoir. Hypersensible, il ressent tout si intensément qu'il s'empêche d'être trop poreux face au monde : il enfouit sa sensibilité profondément et se la dissimule à lui-même. Il s'éveille souvent le matin les yeux pleins de larmes, ces pleurs du rêve dont il perd aussitôt la mémoire. C'est plus prudent ; il peut ainsi se consacrer sans chagrin à sa peinture. »
As-tu mérité tes yeux ? (2021)
Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke
Sortie : 23 janvier 2021 (France). Nouvelle, Fantastique
livre de Eric Larocca
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
Manqué, à mon avis, le jeu de manipulation et d'emprise psychologique sur quelqu'un via Internet : tout va trop vite, trop simplement, trop directement surtout, de façon carrément frontale, sans les méandres, les vas-et-viens, la répétition, les petites touches.
L'auteur ne pousse d'ailleurs pas l'exercice stylistique jusqu'au bout : longs monologues peaufinés, pas de fautes, pas d'abréviations ni de typos, pas l'ombre d'un smiley. Même si en 2000 les gens avaient encore tendance à faire attention à leur expression virtuelle, c'est bien trop léché.
Manque aussi cet aspect de rendez-vous quotidien, le soir, après une longue journée, se connecter à IRC, ICQ, MSN, retrouver la personne, parler de tout mais surtout de rien pour créer du lien. Rien d'inutile dans leurs conversations. Dès lors comment croire à l'investissement de la victime ?
J'attendais aussi plus de variété dans les pièces du dossier : mails à d'autres personnes, d'autres échanges sur le forum, bref comme d'habitude un récit en biais.
L'aspect gore du quotidien m'a fait penser à la trilogie Molly Southbourne.
« Chaque famille possède son propre mythe dont héritent les plus jeunes — une fable non documentée transmise par voie orale, une maladie grave à contracter — comme si les mots eux-mêmes étaient un fléau avec lequel contaminer les nouveaux arrivants pour leur apprendre qu'ils sont désormais invités à faire partie du groupe.Après tout, qu'est-ce qu'une famille si ce n'est une fratrie dont tous les membres sont atteints de la même maladie au stade terminal ? »
Ferdinand du Puigaudeau (2025)
Capturer la lumière
Sortie : 30 mai 2025. Essai, Peinture & sculpture
livre de Jean-Marc Pinet
Nushku a mis 5/10.
Annotation :
Dans la même collection « 36 vues » de l’éditeur Locus Solus. Comme pour Marguerite Sérusier, je ne connaissais pas du tout cet artiste.
J’apprécie. Néanmoins saurais-je reconnaître du du Puigaudeau dorénavant tant chaque tableau ressemble à l’œuvre… d’un autre, plus connu : un peu de Degas, un peu de ci, de post, un peu de fauvisme, un peu de ça, beaucoup de Gauguin dont il fut proche… Quel manque de caractère ! Même pour les paysages nocturnes sous la lune, Boudin en propose deux ou trois dans sa récente exposition… Encore l’un de ces peintres joliets, gentillet que l’on aime regarder, un petit plaisir lorsqu’on tombe dessus dans un musée de province poussiéreux, mais qui sont loin de la fièvre picturale que l’on cherche.
*
« La rupture avec la Bretagne ne se prolongera toutefois pas au-delà de quatre années puisqu'un rebondissement viendra mettre en péril les finances du couple : le prêteur grâce auquel le voyage à Venise avait été rendu possible demanda soudainement le remboursement de la totalité des sommes prêtées. L’espoir d'une exposition qui aurait fois encore dans la difficulté, ses biens ayant été saisis suite à une permis le remboursement disparaît. La famille du Puigaudeau est une plainte déposée par son créancier. Dans ces conditions, Ferdinand et Blanche décident d'un repli en Bretagne, considérée comme un havre de tranquillité propice à la création. La famille du Puigaudeau arrive dans la presqu'île guérandaise en 1906 où elle loge d'abord au bourg de Batz. Puis, à partir de 1907, au manoir de Kervaudu, situé sur la commune du Croisic où se rencontrent des artistes renommés, peintres, graveurs tels Jean-Émile Laboureur ou Émile Dezaunay, et musiciens comme le compositeur Florent Schmitt. Pendant une vingtaine d'années le peintre sillonnera la presqu'île ainsi que la Brière à vélo, peignant le plus souvent sur le motif ou bien enfermé dans son atelier durant les mois d'hiver. »
Marguerite Sérusier (2025)
La Création spontanée
Sortie : 13 juin 2025. Essai, Peinture & sculpture
livre de Virginie Foutel
Nushku a mis 6/10.
Annotation :
Locus Solus, maison d'édition indépendante et bretonne (2012) édite une collection en 36 vues de petits fascicules souples sur des artistes pas si connus, bretons ou non. Si l'intention est louable et le prix léger, c'est aussi le contenu qui l'est : à peine quelques pages de textes, les 36 œuvres sans commentaires, la qualité des reproductions n'étant pas non exceptionnelle et me semblant sombre. On aimerait un peu plus de matière, de plaisir.
Sérusier ? Oui bien sûr Paul, les Nabis, Denis, etc. Je vous dévide le chapelet, le Talisman séminal, enfin les ouvertures vers les autres -ismes du siècle. En fait, c'est aussi Marguerite, qui a peu ou prou été occultée, éclipsée (parfois jusqu'à la signature) par son époux. Marguerite dont Orsay a fait l'acquisition d'un magnifique paravent il n'y a pas si longtemps.
Magnifiques couleurs automnales, teintes mates de fresques, d'un monde à part, passé, orangé, fantastique, lointain et flottant, à l'influence japonaise prégnante comme souvent à cette époque et dans ces cercles. On s'y baignerait l'âme.
Terriblement envie maintenant de visiter le récent (2025) musée Sérusier, caché dans les tréfonds de la Bretagne.
W ou le souvenir d'enfance (1975)
Sortie : 1975 (France). Roman, Biographie
livre de Georges Perec
Nushku a mis 8/10.
Annotation :
Bon, je connaissais le fin mot de l'histoire, ce qui me bloquait à y aller. J'allais dire le twist mais loin de toute révélation finale grandiloquente, la vérité se fait jour des le début, se confirme pas touche. Frustration : ne pas avoir plus de ces souvenirs. Il y aurait des parallèles intéressants à faire avec, pour rester d'actualité, Mauvignier et tous ces auteurs qui, à chaque saison, chaque rentrée, fouillent leur passé. Ai-je lu Je me souviens en entier ? Je ne me souviens plus.
*
« Je ne sais pas si je n’ai rien à dire, je sais que je ne dis rien ; je ne sais pas si ce que j’aurais à dire n’est pas dit parce qu’il est l’indicible (l’indicible n’est pas tapi dans l’écriture, il est ce qui l’a bien avant déclenchée) ; je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d’un anéantissement une fois pour toutes. »
*
« Une fois de plus, les pièges de l’écriture se mirent en place. Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu’il craint ou désire le plus : rester caché, être découvert. [...]
Aujourd’hui, quatre ans plus tard, j’entreprends de mettre un terme — je veux tout autant dire par là « tracer les limites » que « donner un nom » — à ce lent déchiffrement. W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu’ils tissent comme dans la lecture que j’en fais, je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j’ai parcouru, le cheminement de mon histoire et l’histoire de mon cheminement. »
« Source d’une mémoire inépuisable, d’un ressassement, d’une certitude : les mots étaient à leur place, les livres racontaient des histoires ; on pouvait suivre on pouvait relire, et, relisant, retrouver, magnifiée par la certitude qu’on avait de les retrouver, l’impression qu’on avait d’abord éprouvée : ce plaisir ne s’est jamais tari : je lis peu, mais je relis sans cesse, Flaubert et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et Queneau ; je relis les livres que j’aime et j’aime les livres que je relis, et chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt pages, trois chapitres ou le livre entier : celle d’une complicité, d’une connivence, ou plus encore, au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée. »