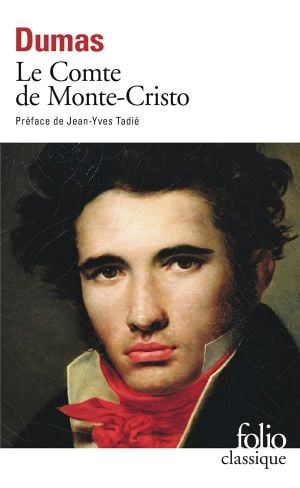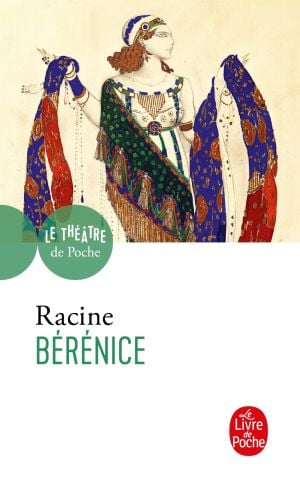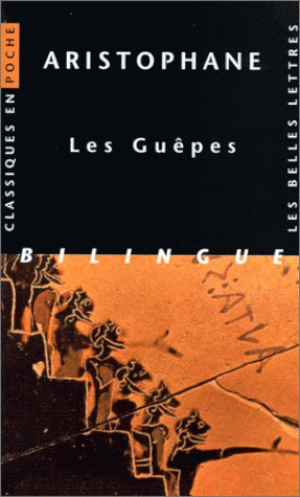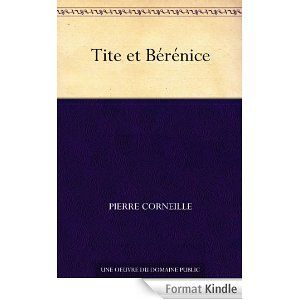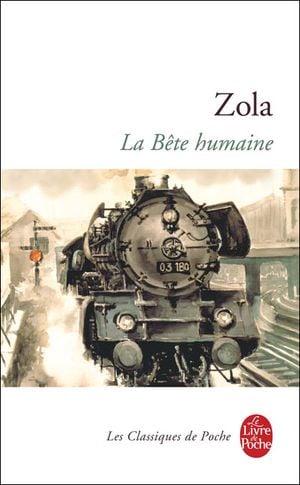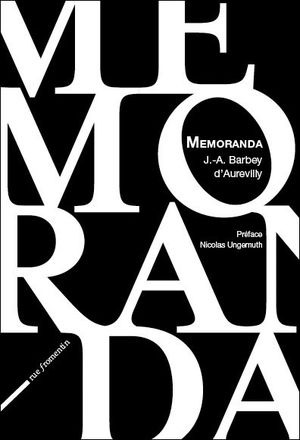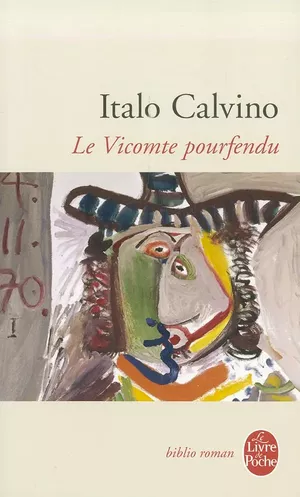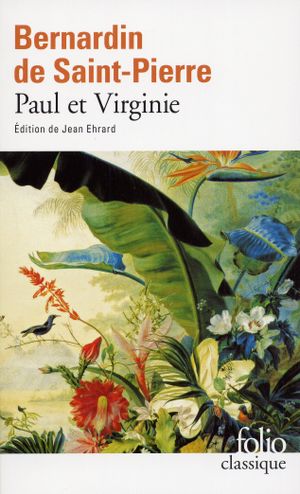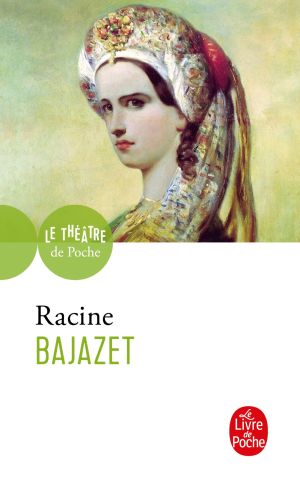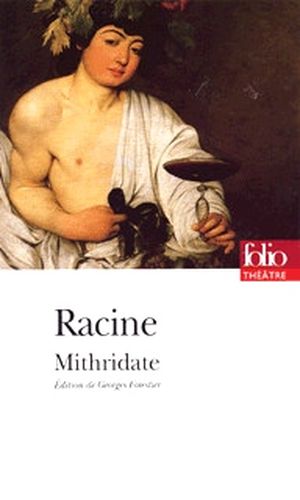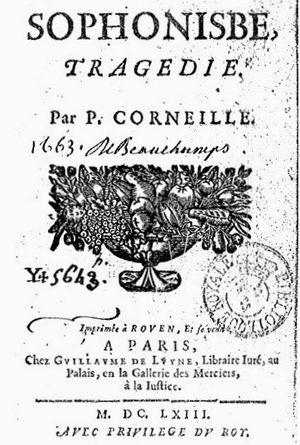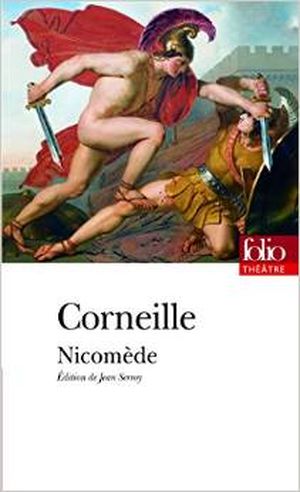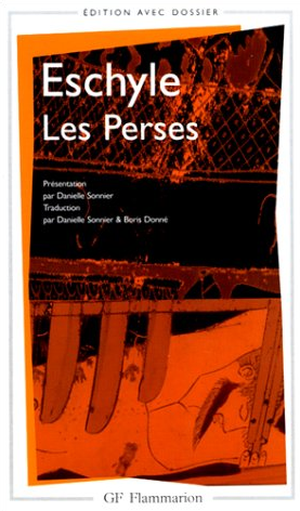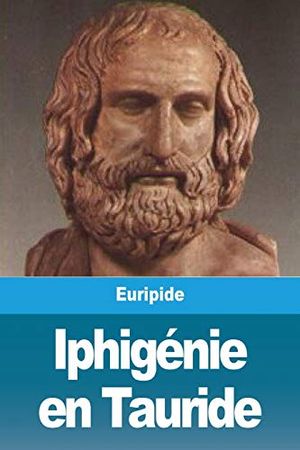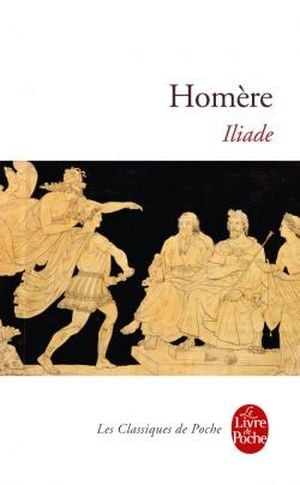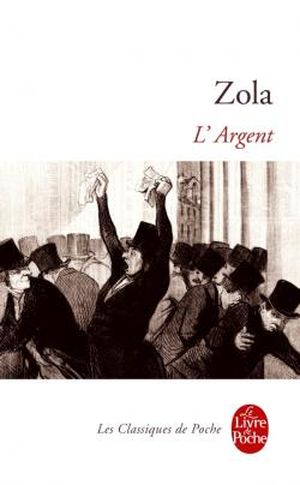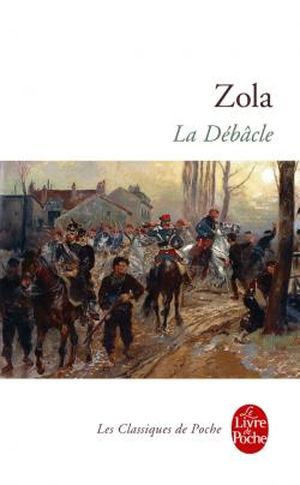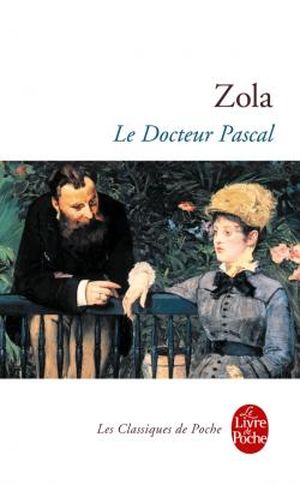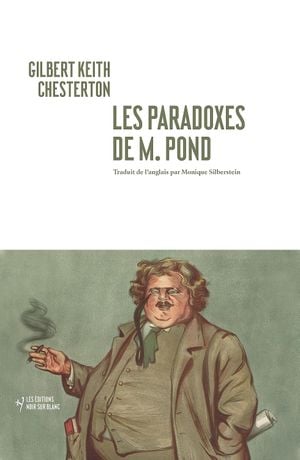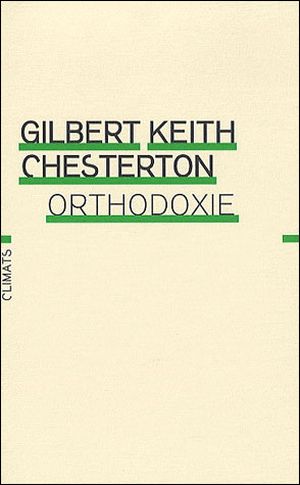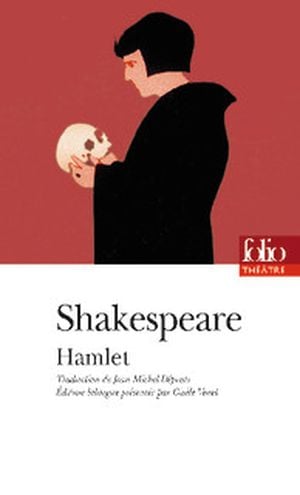Application SensCritique : Une semaine après sa sortie, on fait le point ici.
Élévations littéraires 2025
Je renoue cette année avec une ancienne habitude, fixer des objectifs de lecture. Je les veux cette fois plus précis :
- Terminer les Rougon-Macquart (accompli le 03.07) ;
- Terminer le théâtre complet de Racine (accompli le 16.08) ;
- Au moins commencer les Deux ...
61 livres
créée il y a 11 mois · modifiée il y a 3 joursLe Comte de Monte-Cristo (1844)
Sortie : 1844 (France). Roman, Aventures
livre de Alexandre Dumas
Kavarma a mis 10/10.
Annotation :
J’aime bien commencer l’année avec un classique gros et haletant. Ca inaugure l’année de lecture avec entrain, lance une certaine impulsion initiale. Il y a en plus la sortie du film que je voudrais bien voir plus tard, donc d’une pierre deux coups.
Comme pour le cycle des Trois Mousquetaires, Dumas puise dans la matière historique de France pour construire une intrigue palpitante, tartiner des pages, les remplir d’action et de dialogues savoureux (la première scène entre Monte-Cristo et Benedetto/Andrea Cavalcanti est un modèle). Ici, on commence en 1815, sur fond de nostalgie impériale, alors que Napoléon est à l’île d’Elbe. Contrairement aux Trois Mousquetaires, l’intrigue tient sur un timbre-poste : Edmond Dantès est marin, se retrouve au château d’If sur fausse dénonciation de bonapartisme, s’en évade après 14 ans, trouve un trésor et s’en sert pour rétribuer et punir. Oui, mais combien de splendeurs sont entrevues par ces quelques éléments ! Combien de voluptés, d’aventures sensorielles se dégagent de ce menu synopsis ! Combien grande est l’épopée promise par ce si simple appareil ! On est à la limite de l’érotisme littéraire, tant Dumas nous en met plein la gueule et tant on en redemande. Un chapitre n’est jamais assez, il faut en lire deux d’un coup, trois, quatre, on atteint une moyenne de 100 pages par jour, le pic de dopamine ne connaît pas de crash, ça ne s’arrête jamais... mais en fait si. La fabuleuse entreprise de Dantès se termine, le comte de Monte-Cristo, cette grande figure taillée par la douleur d’avoir tout perdu, forgée par l’injustice et les murs du cachot, par 14 ans de désespoir, d’obscurité, qu’il mit cependant à profit pour se former grâce au génial abbé Faria, cette grande figure, nimbée d’une aura de mystère, de puissance, de sagesse, de savoir, d’expérience, s’étant investie d’un rôle qu’on ne pourra jamais vraiment dissocier entre vengeur et agent de la Providence pour punir les méchants et récompenser les justes, qui peut gérer à la fois les plus grands bandits de Rome et le portefeuille des maisons concurrentes du baron Danglars, qui peut lessiver un procureur du roi, saboter un pair de France, cette grande figure envoyée de Dieu, elle doit nous quitter un jour. Ou plutôt, nous devons la quitter, au terme de ces courtes et bêtes 1500 pages, qui nous ont donné du plaisir mais qu’il faut abandonner lorsque l’acte a été consommé... Quitte à y revenir plus tard, comme à une vieille maîtresse.
Les Plaideurs (1668)
Sortie : 1668 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 6/10.
Annotation :
C’est l’heure d’une session racinienne. Première et unique comédie du sieur, qu’on qualifie plutôt de « pochade » que d’une pièce ayant réellement de l’ampleur, du moins de nos jours, c’est pourtant celle de Racine qui a été la plus jouée et appréciée entre la fin du XVIIe et le début du XXe siècle.
Le choix d’une comédie pour un arriviste qui s’est déjà illustré dans la tragédie est assez curieux, mais s’explique par la même raison. Ayant déjà concurrencé Corneille sur ce terrain, il souhaite égaler son Molière de rival dans son propre domaine. Mais sous son air de ne pas y toucher, Racine accède en fait à une requête de troupe d’acteurs s’étant senti humiliés par ce même Molière, et se laisse avec nonchalance aller à écrire dans un genre qu’on méprise à cette époque. Si le burlesque est le traitement de matières nobles dans un style familier, et qu’on peut qualifier certains éléments de la pièce de burlesque, on est ici dans l’inverse, et on traite d’un sujet vulgaire avec grandes déclamations, ici le système judiciaire. Sujet universel, qu’on connaît en France dès le Moyen Âge, il est cependant emprunté, coutume du genre oblige, à l’Antiquité, précisément aux Guêpes d’Aristophane, mais sans les audaces stylistiques et les obscénités, moralisme du temps oblige. Je n’y ai pas trouvé le brillant des comédies de Molière, et l’action m’est passé assez au-dessus, je dois dire, même s’il y a des dialogues acerbes et certaines scènes du juge Dandin qui sont assez efficaces. Il y a de la verve, ça reste Racine, mais ça manque clairement de profondeur émotionnelle (ce n’est pas ce qui est recherché, certes), ou d’implications du lecteur-spectateur, Racine écrivant pour plaire avant tout, au roi et à la cour si possible, et ne cherchant pas à dénoncer réellement quoi que ce soit. En somme, ce n’est pas déplaisant, mais je qualifierais la pièce de mineure dans l’œuvre du poète.
Britannicus (1669)
Sortie : 1669 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 8/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Tragédie historique, et pour la première fois dans le domaine très sérieux de l’histoire romaine : la concurrence à Corneille s’affirme ici et se cristallise sur son propre terrain. Mais plutôt que de chercher l’héroïsme à Rome, Racine vient y chercher la monstruosité.
Comme en réaction au badinage comique de la pièce précédente, Racine renoue avec la violence de la Thébaïde et compose une tragédie particulièrement sombre, « la plus travaillée » selon lui, ayant pour sujet, emprunté à Tacite, l’avidité du pouvoir de Néron et de sa mère Agrippine. L’avidité du pouvoir, oui, mais pas uniquement, voire très peu, politique : c’est l’empire de soi qui forme le cœur des actions, Néron cherchant à se prémunir de sa castratrice de mère, afin de vivre en empereur libre de s’adonner à ses passions, en une recherche de plaisirs infinis. La concupiscence d’un empereur, qui n’est pas encore le « monstre » proverbial, se dessine déjà, elle lui est intrinsèque et le guide dans sa volonté d’écarter les obstacles à cette voie : au premier rang desquels, son frère Britannicus, rendu bien plus naïf et moral que chez Tacite, sans doute pour accentuer l’aspect tragique de son destin. La lame de Néron plane sur sa tête tout au long de la pièce, balloté qu’il est tel le jouet de l’empereur qui ne sait pas exactement quoi faire, qui hésite encore à l’éliminer au nom du pouvoir ou à l’épargner par devoir familial ou plutôt par appréhension du qu’en-dira-t-on romain, tant il est vrai que combattent en lui uniquement ces deux sentiments, représentés par les conseillers Burrhus et Narcisse. Non, on peut en ajouter un troisième, son amour réel pour l’immaculée, l’innocente Junie, amante de Britannicus, symbole absolu de tout ce que Néron n’est pas et qui se refuse à lui, qu’il convoite en tant qu’elle est sa négation absolue, l’inaccessibilité même d’un désir. L’élimination finale scelle le destin du monstre, l’éloigne de Junie pour toujours et le mène précisément à l’absence de la liberté qu’il recherchait, c’est-à-dire à le faire prisonnier de ses propres passions, dans une course effrénée conclue par le suicide qu’on connaît.
Bérénice (1670)
Sortie : 1670 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 8/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Sujet emprunté très probablement cette fois directement à Corneille, mais en s’en démarquant dans le ton. Une grande sensibilité émane de la Bérénice racinienne, amante du guerrier Titus, qu’il a amenée à Rome après sa campagne de Judée.
A la mort de Vespasien son père, il devient empereur et la pièce se déroule huit jours après l’accession au trône. Ces huit jours sont déterminants, car ils accusent la transformation de Titus, qui est l’exact inverse de Néron : d’abord concupiscent, débauché, vivant de plaisirs, le pouvoir suprême lui fait accepter son nouveau rôle et ses responsabilités. Exit la vie de luxure avec la pétillante Bérénice, il s’est calfeutré une semaine pour réfléchir à comment l’éconduire, les lois romaines proscrivant l’union royale avec des étrangers. Et alors, dans cette pièce sans action, sans péripéties d’aucune sorte, tout l’art sensible de Racine se dévoile, dans ces longs dialogues, les états d’âme dans les monologues, on apprend la patience, parce qu’il s’agit de trouver le bon mot, le bon moment, pour annoncer la douloureuse mais inéluctable séparation qui, selon le mot de Suétone, se fait invitus invitam, « malgré lui, malgré elle » ; Titus s’afflige pendant que Bérénice espère toujours qu’elle l’épousera, mais vient l’annonce, par la bouche du frère d’arme et néanmoins rival de Titus auprès de la femme aimée : Antiochus, le souffre-douleur de la pièce à l’insu de tous, aimant la femme mais se faisant l’ambassadeur de l’amour de Titus auprès d’elle, gardant malgré tout sa loyauté pour lui et sa propre grandeur d’âme. Beaucoup de pathos dans cette tragédie, et beaucoup d’héroïsme aussi : Titus qui se responsabilise, et, à la fin, Bérénice consent enfin à son devoir, la séparation, mais uniquement quand elle est assurée de l’amour éternel de Titus, que, loin de vouloir l’éconduire pour trouver meilleure femme, il lui gardera toujours sa place de reine dans le cœur. Pièce très touchante, qui prend sa place de tragédie morale toute spéciale dans l’œuvre de Racine.
Les Guêpes (-422)
Σφῆκες (Sphễkes)
Théâtre
livre de Aristophane
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
Eh bien comme les Plaideurs, il s’agit ici d’une comédie sur le système judiciaire, mise en scène à travers les personnages de Chéricléon, le père juriste, et Vomicléon, le fils idéaliste. Les noms déjà loufoques annoncent la teneur de l’œuvre, on est d’accord, et renvoient très très subtilement à Cléon, maître d’Athènes au Ve siècle, contre lequel écrit Aristophane : un démagogue ayant réformé la justice sous prétexte de la rendre au peuple (appâter le quidam en le payant 2 oboles de salaire par affaire pour s’instituer juré), mais qui l’instrumentalise évidemment à son profit. Chéricléon prend son travail très à cœur et se sent grand juge appelé par le ciel pour juger tout et tout le temps, et surtout tout le monde, si bien que son fils l’enferme dans la maison pour le guérir de sa « judicarite », comme d’aucuns souffrent de « picolite biberonnante » ! Oui, c’est le cœur du style d’Aristophane : les jeux de langage et l’obscénité, qui rappellent volontiers, d’abord Rabelais, parfois Céline. Il faut dire que la traduction de l’excellent Victor-Henry Debidour rend honneur au style familier et à ces jeux, et donne la pièce lisible comme un délire théâtral du XIXème siècle.
Aristophane n’oublie pas de compisser les sentiments bas et faibles, se pose en anti-démagogue en fustigeant ses propres spectateurs de ne pas avoir cru en les vertus qu’il tente de partager dans son œuvre, rappelant qu’il s’en prend aux puissants en son propre nom et non pas aux petits, tout cela car il « n’entend pas que son commerce avec les muses tourne au maquerellage ». Il est vrai que la différence se pose aussi là avec Racine, outre l’originalité de la forme et du style, il y a la volonté de réellement pointer du doigt les problèmes posés en profondeur. Vomicléon argumente face à son père pour le convaincre qu’en croyant être un maître, il n’est en fait que l’esclave du système des maîtres qui l’utilisent, non seulement à fins politiques, mais en plus pour une bouchée de pain et sans le respect populaire qu’il croit avoir. Ses yeux se dessillent peu à peu, et après avoir jugé un chien pour vol de fromage, il entend les arguments en faveur des bonnes vertus : le bon vin, la bonne tenue dans le monde, le respect qu’on se doit... en somme, une sorte d’épicurisme aristocratique, si j’ose m’exprimer ainsi. Il oublie cependant la modération, consubstantielle au dit épicurisme.
Tite et Bérénice (1670)
Sortie : 1670 (France). Théâtre
livre de Pierre Corneille
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
Si Racine écrit une tragédie de Bérénice, Corneille tire du sujet une comédie héroïque, la deuxième pièce de ce genre-là qu’il écrit, vingt ans après avoir inventé le genre avec Don Sanche d’Aragon.
Pour un même événement (la séparation de Titus, devenu empereur, et Bérénice, reine de Judée), deux esthétiques. Les différences sont palpables, car si Racine écrit une tragédie morale d’amours malheureuses remplie de déclamations élégiaques, Corneille donne une fin assez heureuse à une pièce bien plus axée sur le dialogue rhétorique et les problèmes d’État que pose la liaison des amants, Corneille oblige. Il ajoute aussi un second couple, Domitie, fille d’une famille romaine influente à qui Titus est promis, et Domitian, frère d’icelui. Ces deux-là s’aiment cependant, et en plus de fournir matière à plusieurs dialogues de négociations affectives assez drôles (par ex. Domitian propose que son frère lui donne Bérénice puisqu’il doit remplir son devoir en prenant Domitie, ou Domitie qui veut Tite parce que c’est l’empereur et argumente en ce sens auprès de son propre amant), cet ajout offre de quoi renforcer les aspects rhétorique et politique du style cornélien.
L’histoire, si elle donne autant de soucis aux deux auteurs, se moule avec assez de brio dans les deux genres qu’ils ont respectivement choisis pour en rendre compte, mais pas sans adaptations. Si les amours contrariées donnent plutôt matière à comédie, l’analyse des souffrances du cœur et l’origine politique de ces contradictions ont mené Racine vers la tragédie ; malgré ces aspects-là, Corneille, en s’insérant dans les canons tragiques qu’il a lui-même mis en place après le Cid, voit néanmoins le potentiel comique du récit des amants en remplaçant les déplorations par la rhétorique, les passions tendres (amour, tendresse) par les fortes (puissance, ambition), l’élégie par le pathos aristotélicien, et en faisant l’éloge de la décision finale d’un point de vue héroïque. Comme quoi, un sujet ne vaut rien tant qu’il n’est pas mis en forme.
Histoires (109)
Historiae
Sortie : 0109 (Empire romain). Histoire
livre de Tacite
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Annotation en espace commentaire.
Le Rêve (1888)
Sortie : 1888 (France). Roman
livre de Émile Zola
Kavarma a mis 7/10.
Annotation :
J’entame le dernier quart de la série.
Roman assez déroutant qu’est le Rêve, écrit en premier lieu pour répondre aux détracteurs de Zola qui lui reprochent son goût de l’infâme. Qu’à cela ne tienne, pensa-t-il, il écrira un roman qu’on pourra mettre en toutes les mains, y compris des petites filles (sa jeune nièce lui ayant demandé si elle pouvait lire une de ses œuvres) ; il récrira Paul et Virginie.
Mais si le Rêve est une parenthèse dans le cycle, il n’oublie pas d’en faire partie. L’héroïne Angélique est recueillie enfant par d’humbles artisans brodeurs de Beaumont, mais on apprend plus tard qu’elle est une Rougon, fille abandonnée de Sidonie, la louche, l’entremetteuse, la sœur d’Eugène le ministre qu’on a lu dans le sixième tome. Mais elle ne connaît pas tout cela, elle vit encloîtrée dans la petite maison jouxtant la cathédrale, apprend le métier de brodeuse à l’ombre de la « mère » aux beaux vitraux, nourrie à l’unique lecture de la Légende dorée, achevant de faire de la petite ermite une chrétienne des anciens temps. N’étant son orgueil de Rougon qui çà et là perce la carapace, Angélique est une petite sainte, un ange parfaitement pur qui a peur de l’amour dès qu’il pourrait devenir charnel et briser son rêve d’idéal.
Mais le rêve, c’est aussi ce monde de grâce et de foi pure, que Zola relie au monde matériel, car c’est Angélique qui se crée ce monde-là toute seule, par son environnement immédiat, par ses lectures et son ermitage. La mère Hubertine l’élève dans l’innocence du monde et l’avertit pourtant qu’il est plus dur que ce qu’elle croit. Son hérédité, concept matériel, est ici combattue par son milieu, concept également matériel, la dynamique matérialiste des Rougon-Macquart. Ainsi, la foi est née du milieu et de l’éducation, en cela est-elle aussi un rêve ? La scène de l’extrême-onction et la scène finale du roman montrent plutôt l’angélique perfection de l’héroïne : l’inutilité de la purgation et l’état de grâce final qu’elle atteint. Paradoxal pour une jeune fille croyant à une forme primitive de christianisme, remplie de toutes les figures de saintes locales, d’icônes, d’une époque où la sainteté s’incarnait d’abord dans un corps, elle qui a refusé l’éveil des sens.
La Bête humaine (1890)
Sortie : 1890 (France). Roman
livre de Émile Zola
Kavarma a mis 9/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Finalement pas tant un roman sur le crime qu’un roman sur la folie meurtrière qui s’empare de Jacques Lantier, 2e fils de Gervaise inventé sur le tard spécialement pour cette histoire, à la vue de la chair féminine. L’atavisme mâle, la fêlure des Macquart et le sentiment de la faute originelle (tante Dide) se mêlent en lui et le détraquent, lui provoquent ces trous par où son « moi lui échappait ». Un meurtrier en puissance qui ne veut pas tuer, opposé à Roubaud, l’homme rustaud qui tuera sur un coup de sang par vengeance : et lorsque Jacques voudra le tuer, invoquant le « droit au meurtre » de Raskolnikov, il ne pourra pas, tant il est vrai qu’en raisonnant son meurtre il cesse d’être fou pour devenir criminel, mais aussi parce qu’il faut une femme. Séverine est la seule qui puisse le séduire et le guérir momentanément de cet instinct, par la même passivité qu’offre la mécanique Lison, sa locomotive pour qui il voue une passion tendre et asexuée : il faut que son orgueil de mâle ne trouve aucun obstacle, jusqu’à ce que la réunion d’Eros et de Thanatos, très présente tout au long de l’œuvre, ne fasse son travail final, à force de confessions de meurtre sur lits de stupre.
Le sujet, c’est surtout la bestialité de l’homme qui lui est intrinsèque et que ne pourront jamais supprimer les avancées vers le progrès, symbolisées ici par la figure de la locomotive, l’inhumaine toute en muscles mécaniques, aimée par des Esseintes et par Lantier certes, mais entité moderne roulant effrénée à l’avenir, imperméable à ce qui fait l’homme : la passion. Après « l’ogre » du Bonheur des dames ou le « monstre » du Voreux, c’est le « serpent de fer » qui continue de donner une dimension mythologique aux destinées des personnages, encore accentuée par le style toujours épique de Zola qui, non content de donner un juge Denizet en Porphyre Petrovitch raté, peint son tableau par touches de couleurs impressionnistes. Le noir du drame tragique, dans les ambitions ou les instincts meurtriers, dans les fusils de Tchekhov, dans les descriptions des trains et des gares toutes de fer ; le rouge du sang et de la folie, de l’amour sexuel et de la Croix-de-Maufras maléfique mêlé au blanc des gorges de femme ; les feux follets des paysages des voyages en train, chevauchées fantastiques nocturnes du monstre hennissant qu’on ressent à pleine vitesse depuis la plateforme du mécanicien, devenu un aventurier d’odyssée. En terme de composition et de puissance, un des meilleurs romans de la série.
Mémoranda (1864)
Sortie : 1864. Journal & carnet
livre de Jules Barbey d'Aurevilly
Kavarma a mis 9/10 et a écrit une critique.
Annotation :
Voir chronique rédigée.
Le Vicomte pourfendu (1952)
Il visconte dimezzato
Sortie : 1955 (France). Roman
livre de Italo Calvino
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
J’avais envie d’une petite pause fantaisiste, et de goûter un peu de littérature italienne alors pourquoi ne pas concilier les deux ?
En vérité peu fidèle à ce que j’imaginais en évoquant la littérature italienne, ce petit livre est un conte qui se place plus volontiers dans l’atmosphère générale de son siècle que dans un particularisme national (à ce qu’il me semble en tout cas). Un peu sombre mais pas trop, un peu fantaisiste mais sanglant, le merveilleux du Vicomte pourfendu s’inscrit dans l’esthétique très XXème siècle du malaise existentiel et met en scène ce fameux vicomte de Terralba qui a pris un boulet de canon durant une bataille contre les Turcs, et s’est vu pourfendu en deux moitiés symétriques. Le Mauvais est très mauvais et fait des trucs de mauvais, il terrifie les gens, se montre absolument cruel et rusé, par pur goût du mal. Mais la moitié bonne a survécu, et à partir du moment où le Bon revient en scène pour contraster le mal, ce dernier se voit renommé l’Infortuné, par la communauté huguenote qu’il persécute. Oui, il y a une communauté huguenote, qui vit comme des Amish, ayant tellement peur d’aller en Enfer qu’ils ne se permettent aucun discours sur leurs propres dogmes, puisqu’on n’est jamais sûr de ne pas blasphémer en affirmant une chose. Ça se plaint mais pour faire du business à 3 écus la livre de seigle alors que le pays meurt de faim, là y a du monde.
Le Mauvais est trop mauvais, mais le Bon est trop bon, tellement que ça l’empêche de voir le mal autour de lui, et d’en tolérer un petit pour en enrayer un plus grand. Ce qui est vu en coupe est certes étudiable, mais au détriment de l’intégrité et des facultés du sujet. La balance n’est rétablie que lorsque les deux moitiés se refondent, recousues par le docteur Trelawney, et le nouveau Médard de Terralba se voit enrichi de la sagesse accumulée de ses deux parties individuelles. L’histoire est un prétexte au conte d’initiation, car le narrateur, neveu du vicomte, perd le docteur son compagnon, parti en voyage, alors que lui doit rester en ce monde fait de « responsabilités et de feux follets » : entre duretés de la vie d’adulte et manifestations poétiques de sa propre finitude. Entre fin de l’enfance symbolique et émanations fluorescentes de pierres tombales. Et si la communauté de lépreux heureux peut le faire, vivant une vie de carnaval éternel, alors pourquoi pas lui ? Mais vrai, « il est clair qu’il ne suffit pas d’un vicomte complet pour que le monde entier soit complet ».
Paul et Virginie (1788)
Sortie : 1788 (France). Roman
livre de Bernardin de Saint-Pierre
Kavarma a mis 7/10 et a écrit une critique.
Annotation :
Voir chronique rédigée.
Les Rêveries du promeneur solitaire (1778)
Sortie : 1778 (France). Autobiographie & mémoires, Philosophie
livre de Jean-Jacques Rousseau
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
Mon premier Rousseau, c’est pas trop tôt !
On entend beaucoup de mal sur lui, mais j’aime cet opus. Divisé en dix promenades qui sont autant de méditations, Rousseau y déploie sa pensée comme le flux de sa marche, en mouvement, et s’y montre très fin psychologue de lui-même. Non destinées à la publication, elles étaient censées mettre l’écrivain face à l’homme, par désir de se connaître : Rousseau s’y livre, presque entier. Si le bonheur pour lui, dans cette fin de vie, est le bonheur de l’ascète, il convient cependant que ce même bonheur se goûte au moment propice, après qu’on n’est plus utile à la société. En général il me semble faire beaucoup l’éloge d’une philosophie stoïcienne, qu’on pourrait concentrer en cette formule : « J’ai appris à porter le joug de la nécessité sans murmure ».
Si l’éloignement des hommes lui donne le bonheur d’être en paix, c’est qu’il n’a pu s’aguerrir contre leurs vicissitudes ; d’un autre côté l’homme doit se confronter au monde dans sa vie, affronter l’adversité dont on manque tous les bienfaits en l’évitant. Puis, rentrer en soi enrichi de sagesse, plus tard, car si « la jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer ». Et comment goûter pleinement cet état d’ataraxie si l’on n’a jamais pu remplir son âme, ce réservoir d’expérience, au puits de la vie ? Un grand sens de la nuance, parfois du paradoxe, anime ces promenades : sur la bienfaisance qui, conduite sans discernement, devient néfaste ; qu’il faut être déjà libre pour avoir le plaisir d’agir bien ; que la société des hommes éloigne de l’homme ; que c’est en vivant la solitude qu’il se rend compte de sa grande porosité au monde ; cette perméabilité lui fait dire que le mal n’existe qu’en tant qu’il est visible immédiatement, ce qui, sous des dehors subjectivistes, sonne un peu comme une philosophie de l’irresponsabilité. Malgré cette excellente prose, très fluide et réjouissante dans sa maîtrise de l’allusion et des élégances, Rousseau se fuit. Sur l’abandon de ses enfants il élude un peu vite, clamant simplement à force d’anecdotes touchantes son amour sincère des enfants. Aussi, il dit faire son bonheur de ne plus penser à ses persécuteurs, et même de rire du peu d’effet de leurs maux, préférant que les méchants le « tourmentent sans résistance », plutôt qu’être forcé de penser à eux... dit-il en y pensant continuellement ! « Je me crois sage et je ne suis que dupe » : le verdict de tout apprentissage, il est vrai.
Bajazet (1672)
Sortie : 1672 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 9/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Annotation en espace commentaire.
Mithridate (1673)
Sortie : 1673 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Où l’on voit la transition entre les deux manières de Racine se poursuivre, et cette dramaturgie du secret se prononcer : Xipharès, Monime ou Mithridate prétendent tous pouvoir cerner les pensées profondes mieux que ceux qui les disent ; où aussi les moments où l’on pourrait se trahir sont coupés par qui voudrait continuer à se bercer d’illusions ; où des jeux d’investigation, des pièges psychologiques, sont menés pour apprendre la vérité ; où s’affirme encore cette intrication insoluble du pouvoir et de la passion ; où cette fois la conscience morale du couple idéal se rend apte au sacrifice ; mais où le dénouement apporte une rédemption.
Mithridate, roi du Pont et de « quantité d’autres royaumes », grand rebelle à l’occupation romaine, revient de campagne dans un palais où s’aiment son aimée Monime et son fils Xipharès. Il se doute de quelque chose et la pièce aura pour centre cette recherche de la vérité. Elle revêt aussi une dimension épique où le pouvoir se voit en grand et la politique ferme, jusqu’au projet d’invasion de Rome. La part belle est faite à l’héroïsme du roi et de son fils, qui cherche la fierté et l’approbation du père, autant qu’est échu à Pharnace, l’autre fils, le rôle de traître vendu aux Romains. Dimension mélodramatique, galante et romanesque aussi, bien dans le goût de l’époque, mais dont l’enchaînement de revirements dramatiques sont encore relevés par cette inspiration cornélienne héroïque, qui donne ce coup de théâtre final grandiloquent et épique, offrant la rédemption du « monstre », c’est-à-dire de Mithridate destructeur de sa concupiscence, sur son glorieux lit de mort, léguant, comme de juste, le sceptre et l’objet du désir au fils méritant, transmission symbolique et effective du pouvoir autant politique que sexuel. Mais l’influence de Corneille se voit aussi dans la dénonciation faite de son idéalisme, en montrant la réalité de ce qu’est la passion, dont le ravage ne se laisse pas si facilement dépasser par la raison d’Etat (amour, hybris, etc.). L’antinomie tragique racinienne trouve donc son dénouement dans cette rédemption, et fait de cette pièce la transition entre celles se déroulant du point de vue de la pulsion et du désir et celles, suivantes, du point de vue de la conscience, dont le regard demeure ce qui pèse le plus, déjà ici. Pièce préférée de Louis XIV paraît-il, je comprends l’attrait pour tout cet héroïsme et cette intransigeance que vient ponctuer, au sommet, la conversion morale du tyran devenu grand.
Iphigénie (1674)
Sortie : 1674 (France). Théâtre
livre de Jean Racine
Kavarma a mis 9/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Transition confirmée et incursion actée de l’anthropologie chrétienne dans la dramaturgie racinienne.
Du mythe grec, Racine reprend la trame précise de la deuxième Iphigénie d’Euripide, et met en scène cet épisode devant commencer la guerre de Troie, le sacrifice d’Iphigénie par Agamemnon son père, promise aux dieux pour lever les vents et permettre le départ de la flotte. Toute entière aux rebondissements, cette tragédie à fin heureuse repose sur une question, qui parcourt toute l’intrigue : Iphigénie vivra-t-elle ? Comme dans le mythe originel, oui ; contrairement à ce mythe, c’est une pure invention de Racine qui la sauve (je ne dirai pas comment) : le personnage d’Eriphile, qui concentre le plus gros nœud tragique, rappelant Roxane dans son besoin de reconnaissance, amie et captive d’Iphigénie qu’elle jalouse pour tout l’amour qu’elle reçoit de partout, jusqu’à la promesse même de son sacrifice qui la grandit aux yeux de tous.
Mais le deuxième nœud tragique se trouve en Agamemnon. Pétri de doutes, voulant la gloire pour les Grecs mais aimant sa fille, tout entier à l’hybris de son propre rôle de roi des rois et ne supportant pas l’orgueil d’Achille en retour, il manigance pour condamner ou sauver sa fille sans avoir l’air qu’aucune décision ne soit dictée par lui, il marque aussi un glissement du rôle du Père chez Racine : passant de l’incarnation de l’autorité, de la loi et de la répression du désir à celui d’un père d’une commune condition humaine, dominée par les passions jusqu’à la fin. C’est Iphigénie qui acte la dynamique de conversion, qui se donne d’elle-même à cette exigence transcendante et se fait martyre pour la gloire de son sang d’Atride, des Grecs et par conformité aux oracles divins. La fureur du désir rencontre la résignation au devoir, quitte à renoncer au bonheur et à la vie ; mais une troisième voie se trouve en Eriphile, dans cette détermination humaine qui représente le vice à éradiquer, mais aussi, pourquoi pas, le refus de toute récupération transcendante, hybris humain revendiquant tout acte pour soi. Et toujours, par le père, Clytemnestre, Eriphile, Iphigénie, ce souci du secret ; ce sentiment épique teinté de sentiment religieux et de lyrisme : une « anthologie de la poésie racinienne ».
Othon (1664)
Sortie : 1664 (France). Théâtre
livre de Pierre Corneille
Kavarma a mis 7/10.
Annotation :
Sujet emprunté à Tacite (début des Histoires), cette tragédie met en scène l’avènement d’Othon, en l’an 69.
Toujours encore, comme on dit chez moi, l’intrigue est formée de l’intrication de la politique avec l’amour : il s’agit pour Othon de régner, pour cela il doit séduire Camille, nièce de l’empereur Galba, afin d’en pouvoir être le successeur. Il en est aimé, mais problème : il aime Plautine, qui l’aime aussi, fille d’un intrigant qui sera confronté à d’autres intrigants. Chacun jouera son rôle pour arriver à ses fins au milieu d’un Galba naïf qui croit aux bons et loyaux services de chacun. Mais Othon a l’âme pure, bien que teintée d’ambition, comme Bajazet. Racine aura repris à son compte plusieurs éléments de relations entre personnages, notamment ce couple déjà amoureux (Othon et Plautine), dont l’amante pousse l’amant vers celle pouvant le faire souverain (Camille), et quand Othon s’exécute, non sans verser des larmes, elle croit qu’il pourrait bel et bien être sincère dans cette feinte séduction, ce qui rappelle les atermoiements d’Atalide ; mais aussi Bérénice, dans ce sacrifice de la présence de l’amant à la sûreté d’en avoir le cœur, au moins au début. L’intrigue se développera à grand renfort de rebondissements, on séduit puis laisse tomber, on s’offre et on se rétracte, Camille se voit offrir à tour de rôle par son oncle à Othon, à Pison, à tel autre intrigant, pour finir à personne. Une scène particulière (III, 4) atteint un point qui frise la comédie, quand Galba accorde enfin Camille à Othon, après moult efforts dans l’unique but d’avoir le trône... mais sans ce trône, attribué à Pison ! S’entame alors une suite de dialogues où Othon se déclarera indigne de l’amour d’un si haut sang, où Camille comprendra alors ses manœuvres et cherchera à se venger, où Plautine se débrouillera dans son coin pour tenter d’épouser un haut placé, qui la placerait elle-même en mesure ensuite de faire Othon empereur... oui, on n’est pas loin du mélodrame politique.
Cela dit, la fin assombrit l’œuvre : ce coup d’Etat othonien, cette atmosphère de guerre civile durant laquelle meurt assassiné le père de Plautine, cette victoire en demi-teinte d’Othon, qui a conquis le trône et se précipite vers celle qu’il veut faire impératrice... mais le deuil, chargé de reproches, la fait lui échapper. J’ai aussi noté certaines rimes (couronné/condamné, respect/suspect, fréquemment Camille/inutile), admirables d’évocation.
Sophonisbe (1663)
Sortie : 1663. Théâtre
livre de Pierre Corneille
Kavarma a mis 9/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
« J’aime mieux qu’on me reproche d’avoir fait mes femmes trop héroïnes [...], que de m’entendre louer d’avoir efféminé mes héros par une docte et sublime complaisance au goût de nos délicats, qui veulent de l’amour partout, et ne permettent qu’à lui de faire auprès d’eux la bonne ou mauvaise fortune de nos ouvrages. » L’avis au lecteur donne le ton d’emblée : pièce de l’honneur, de la dignité, de l’intransigeance. L’amour ne sera présent qu’autant de fois qu’il faudra relever la grandeur morale et le sacrifice amoureux de Sophonisbe pour sa cause perdue.
Comme pour Mithridate dix ans plus tard, la rébellion face aux Romains forme le cœur politique de la pièce, mais même si l’amour est annoncé absent, il s’insinue partout, sous d’autres modes. L’orgueil de posséder un cœur dont on ne veut pas, l’adultère à but politique, la rivalité entre Sophonisbe, reine de Numidie fille de général carthaginois (la fierté de l’enfant qui se veut digne de son père se retrouvera chez Xipharès), et Eryxe auprès du roi Massinisse, dont la seconde brigue le cœur et la première le statut : toutes ces modalités de l’amour, sur le mode mineur et néanmoins indispensables, se trouvent mobilisés dans la pièce. Et c’est bien l’enchaînement des stratégies amoureuses de Sophonisbe qui fait avancer l’intrigue, elle qui a compris ses armes de femme et qui sait parfaitement les utiliser. Elle est même une sorte de femme fatale, que les hommes veulent pour sa beauté et sa grande fierté, mais toujours elle se dérobe, montre une ferme virilité en réponse aux implorations des hommes, coupe leurs déclarations, se donne au plus offrant pour repartir quand le vent tourne, revendiquant toujours hautement que seule sa main est à prendre et non son cœur, pour un unique but : la résistance à Rome. Beaucoup de répliques de Sophonisbe montrent sa grande intelligence psychologique au sujet des relations amoureuses, et sa compréhension de ses dynamiques, qu’elle cache sous des dehors froids et calculateurs. Vraiment, une pièce peu connue mais excellente.
Une tragédie pourtant, puisque c’est par hybris qu’elle résiste, que Rome est évidemment supérieure et que la cause est perdue depuis le début. « En dépit de sa haine,/Une telle fierté devait naître romaine », clame Laelius devant la fin flamboyante de la reine, superbe, fière jusque dans la mort : « Et n’étant plus qu’à moi, je meurs toute à Carthage ! » Fin qui, après le recueillement, refait place à la politique ; le temps des grandeurs a passé.
Nicomède (1658)
Sortie : 26 mars 2009 (France). Théâtre
livre de Pierre Corneille
Kavarma a mis 8/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Un dernier Corneille pour la route ? Faisons comme ça.
Tout comme celui de la pièce précédente, l’Avis au lecteur pose les termes dans sa volonté de ne pas mettre trop d’amour et de focaliser sur la « grandeur de courage », avec un héros qui sort un peu des règles établies, ne cherchant pas à faire pitié avec les malheurs qui l’accablent : au lieu de cette pitié à faire ressentir au spectateur, l’un des principes originels de la tragédie, Corneille entend proposer l’admiration des grands cœurs, car « il est bon de hasarder un peu ! et ne s’attacher pas toujours si servilement à ses préceptes ». Cette admiration est de fait une autre manière de purger les passions, puisqu’en donnant de l’amour pour une vertu que nous admirons, on donne de la haine pour le vice contraire.
Nicomède, prince héritier de Prusias roi de Bithynie, s’inscrit dans ce petit cycle des héros de la rébellion face à Rome. Il est toute fierté et grandeur, tellement que le roi veut calmer son insolence devant l’ambassadeur romain, qu’il essaie de maintenir en bonne relation. Un deuxième fils de Prusias, né d’un second lit avec Arsinoé, revient de Rome où il a passé sa jeunesse et son éducation : cet Attale, poussé par sa mère pour évincer Nicomède, s’oppose à celui-ci, manigance pour prendre le trône, poussé également par Rome qui voit en lui le parfait soumis, mais au fond admire la grandeur de Nicomède, grand conquérant. De fait, il est plusieurs fois fait mention que le roi de la province, quel qu’il soit, devra toujours deux tiers du royaume à ses conquêtes. Et là est le cœur de l’intrigue : la grandeur de Nicomède est solaire mais écrasante, ne laissant que peu de place aux autres ambitions : « Il n’a qu’à l’entreprendre, et peut tout ce qu’il veut./Juge, Araspe, où j’en suis, s’il veut tout ce qu’il peut. » De fréquentes joutes verbales ponctuent joyeusement l’histoire, la part belle est faite aux registres autant lyrique que rhétorique (épidictique, voilà je l’ai dit : laudatif en public) ou les mentions au roi légendaire Annibal, symbole de la révolte, pour en assoir la légitimité, donnent une très bonne pièce très agréable à lire. On pourrait se décevoir par la fin heureuse, mais j’aime la rédemption d’Attale faisant ses preuves et la résolution de Nicomède, entre refus et pardon : le nœud tragique se dénoue simplement, par l’acceptation, enfin communément admise, de cette grandeur éclatante, encore augmentée.
Les Perses (-472)
(traduction Paul Mazon)
Persai
Théâtre
livre de Eschyle
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Non seulement c’est la première tragédie grecque que l’on ait conservée, mais aussi le seul exemple connu d’un sujet contemporain, non emprunté aux mythes : la bataille récente de Salamine, victoire grecque à laquelle Eschyle a participé.
Ce qui saute directement aux yeux, c’est l’originalité, à mon sens, de la démarche, déjà éminemment littéraire : mettre en scène, en tant que Grec victorieux, le sentiment des Perses, c’est à dire de la défaite. Original et très efficace, la victoire racontée du point de vue de la défaite permet, à travers les lamentations du Chœur et des personnages, de glorifier d’autant plus la victoire grecque en insistant sur son côté spectaculaire : ils ont vaincu, par le petit nombre d’« hommes libres » cette « fourmilière » qu’est l’armée perse, indifférenciée, presque anonymisée, topos de l’Orient du point de vue occidental repris jusqu’à Bajazet, où Racine emploie le même terme.
Ces lamentations se lisent alors sur deux plans : d’un côté la gageure immense bel et bien ressentie par l’empire perse, mais de l’autre on entend sonner en elles comme le chant épique, louangeur et fébrile des victorieux. Et prétexte alors de blâmer Xerxès, le tyran atteint du vice suprême de l’hybris, dont l’empire s’étend naturellement vers l’Asie et qui a commis l’erreur de tenter la conquête par mer vers l’Occident. Injure aux dieux parce qu’injure au cosmos et à son équilibre, il se voit puni de sa démesure par les citoyens des cités libres, Eschyle opposant patriotiquement, voire civilisationnellement la fourmilière orientale et despotique à la valeur individuelle des citoyens libres et valeureux. On voit Xerxès se lamentant, encore paré de ses guenilles du jour de la défaite, entouré de rares soldats survivants, son carquois vide sur l’épaule. Et cette première impression ressentie à la lecture des Sept contre Thèbes m’est revenue : cette aridité dans la narration, ce minimalisme au goût de sable chaud déserté de champ de bataille où chante seule la dure destinée.
Les scènes où Xerxès se fait daronned par l’ombre de Darius son père sont également savoureuses, où il revient dire à son fils qu’il n’est qu’un inconséquent d’avoir tenté sa désastreuse entreprise.
Iphigénie en Tauride
Sortie : 11 novembre 2020 (France). Théâtre
livre de Euripide
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
Voir espace commentaire.
Iphigénie à Aulis (-405)
Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι
Sortie : 8 novembre 1990 (France). Théâtre
livre de Euripide
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Voir espace commentaire.
Iliade
(traduction Mario Meunier)
Ἰλιάς
Sortie : 1943 (France). Mythes & épopée
livre de Homère
Kavarma a mis 10/10.
Annotation :
Rattrapages de classiques, et pas des moindres. Que dire sur ce poème père de tous les poèmes ?
Juste que ce fut une expérience gratifiante, nécessaire tant il est vrai que, selon la magnifique formule de Hugo, « le monde naît, Homère chante. C’est l’oiseau de cette aurore. » Peut-être est-ce cette naissance du monde qui explique l’omniprésence des dieux dans l’Iliade, poème où se meuvent à égalité la divinité et l’humanité, où la guerre que se livrent les Grecs et les Troyens sur la terre est aussi le théâtre, j’allais dire de la guerre, mais bien plutôt des jeux de la guerre auxquels se livrent les dieux de l’Olympe. Intrication presque insoluble des dieux et des hommes, la guerre de Troie laisse pourtant une grande place à la valeur individuelle des guerriers, dont certains sont capables de blesser ou de faire fuir les dieux s’étant placé sur le champ de bataille, que ce soit Apollon ou Arès lui-même. Hector au casque scintillant, Achille aux pieds rapides, le puissant Ajax, Agamemnon le roi des rois, le blond Ménélas, sont autant de guerriers qui déjà au temps d’Homère se livrent à une guerre de l’ordre de la légende ; où déjà de son temps on les envisage du point de vue du mythe, ayant perdu une petite part d’humanité pour devenir des demi-dieux. Tous les comportements sont d’une grandeur qui n’est plus concevable, une grandeur qui refuse la compromission de trancher entre le bien et le mal, car Hector et Énée ont autant le droit moral de défendre Troie que Ménélas ou Achille de vouloir la conquérir, parce que c’est l’homme. Tout est grand, tout est furieux mais tout est tranquille, tout est colossal, tout est aussi divin qu’humain, l’épique de l’Iliade est une pureté et une véritable bouffée d’air frais.
L'Argent (1891)
Sortie : 1891 (France). Roman
livre de Émile Zola
Kavarma a mis 8/10.
Annotation :
Voir espace commentaire.
La Débâcle (1892)
Sortie : 1892 (France). Roman
livre de Émile Zola
Kavarma a mis 7/10.
Annotation :
Voir espace commentaire.
Zone et Châtiment (2001)
Life at the Bottom
Sortie : 2024 (France). Essai
livre de Theodore Dalrymple
Kavarma a mis 8/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.
Annotation :
Pause rougon-macquaresque, je me garde le dernier et épilogue pour plus tard, avec un essai qui prolonge étrangement le sujet, d’une certaine manière.
Voir chronique rédigée.
Le Docteur Pascal (1893)
Sortie : 1893 (France). Roman
livre de Émile Zola
Kavarma a mis 7/10.
Annotation :
Finalement ce plus tard est venu plus vite que prévu. Ce dernier roman de la saga est vraiment rédigé et conçu comme un épilogue, comme une conclusion, en ce sens qu’il met en scène ce personnage du docteur Pascal Rougon, l’un des cinq enfants de la fratrie née de Pierre et Félicité, introduit dans le tout premier tome et qui maintenant finit sa vie comme un Rougon, en l’ayant toujours crue extraite de leur histoire. Cette histoire familiale et son étude est justement l’œuvre de sa vie, Zola met en abyme son propre travail de romancier et le projette sur le scientifique Pascal, étudiant l’atavisme des tares, les élections père ou mère de tel individu et dans quel domaine, l’alcoolisme du côté Macquart ou l’orgueil du côté Rougon donnant dans chacune des branches de différents fruits selon l’union. Ce travail est l’horreur de Félicité, qui en authentique Rougon cherche à finir sa vie auréolée de gloire bourgeoise, voulant étouffer les sales affaires. On ressent une vraie haine pour ce personnage pendant la lecture, je dois le dire, pour cette raison et non pas pendant le mémorable épisode de l’incendie chez le vieux Macquart, disparu en incroyable et presque féérique flambée éthylique... la féérie zolienne.
La féérie zolienne se retrouve aussi dans l’idylle incestueuse entre Pascal et sa nièce Clotilde, fille d’Aristide Saccard le banquier magouilleur. Homme de science, de labeur, il découvre sa virilité dans l’âge tardif, cette nièce venue habiter chez lui depuis l’enfance ayant grandi jusqu’à 25 ans de très belle manière et ayant réveillé chez lui les instincts ignorés. Trop monstrueuse pour être assumée, l’idylle prend douloureusement fin et Clotilde est envoyée à Paris pour que Pascal puisse en souffrir et en devenir fou. L’obsession de la germination et de la paternité, qui le hante jusqu’à la fin, trouve enfin résolution : Clotilde enceinte donne un nouveau souffle à la lignée, donnera peut-être le rejeton parfait de ce sang à la fois si mauvais et cependant terriblement humain. Un avenir duquel Pascal ne sera pas témoin... comme le symbole du chercheur éternel qui ne pourra jamais contempler le résultat de son labeur, à la fois scientifique et humain. Un roman qui termine les Rougon-Maquart comme une conclusion pessimiste mais aussi une ouverture optimiste sur la foi en la vie, éternelle régénératrice ; un roman, comme l'Œuvre, très personnel ; un roman, pas comme l'Œuvre, qui a quelque chose de forcé dans la déclamation de la foi.
Les Paradoxes de M. Pond (1936)
The Paradoxes of Mr. Pond
Sortie : 1985 (France). Recueil de nouvelles
livre de G. K. Chesterton
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Ma rencontre avec Chesterton se fait sous des auspices bienveillants. Je voulais lire Orthodoxie mais m’introduire d’abord à l’œuvre de l’espiègle anglais par un chemin de traverse. Touche-à-tout de génie, semble-t-il, Chesterton a composé un petit recueil de huit histoires paradoxales racontées par un narrateur, lui-même dérouté par un certain M. Pond, haut fonctionnaire au gouvernement, résolveur de mystères à ses heures, et souvent impliqué dans des histoires invraisemblables. L’esprit et la mise du bonhomme rappellent sa signification (« pond » signifiant étang en anglais) : la surface semble lisse, bien sous tous rapports. Mais de temps en temps perce à cette surface quelque chose qui permet d’en voir la profondeur insoupçonnée, c’est le paradoxe lançant l’histoire ; c’est la haute intelligence du monsieur combinée à une grande perspicacité, un sens de l’observation et un common sense dignes du Britannique qu’il est. La première histoire, le premier paradoxe, se présente comme suit : en campagne en Pologne, le maréchal von Grock tenait absolument à faire mourir le poète Petrowski. Il envoie des ordres pour le faire exécuter le soir-même. Plus tard, une lettre de grâce part pour le sauver, « mais comme l’homme chargé de la grâce périt en route, le prisonnier fut finalement libéré ». La faute au « trop-plein de discipline militaire allemande ». C’est ce genre de déclarations énigmatiques et parfaitement logiques sous leur apparence absurde qui lance les huit récits.
Drôles, pleins du charme de l’esprit british flegmatique, émaillés de bons mots et de sa galerie de personnages iconiques tels que l’impatient Wotton ou l’exubérant capitaine Gahagan, ces récits sont un condensé de ce que le « prince du paradoxe » a pu produire en terme de démonstration de ce talent. Sherlock Holmes doit très certainement faire partie des influences majeures ici, mais on sent en toile de fond plutôt un univers intellectuel se rapportant aux littératures française et anglaise classiques, dont Chesterton était grand amateur. Quoi qu’il en soit, il fait montre, en plus, d’une habileté narrative qui transforme le recueil en page turner, comme on dit.
Orthodoxie (1908)
Orthodoxy
Sortie : 19 mars 2010 (France). Essai
livre de G. K. Chesterton
Kavarma a mis 9/10 et l'a mis dans ses coups de cœur.
Annotation :
Un esprit rigoureux et espiègle, qui prouve la réalité de la magie des contes de fées aussi sûrement que 2 et 2 font 4... Contre le matérialisme, l’anarchie, l’athéisme ou le scientisme comme autant de maladies modernes qu’il faut guérir en l’homme, Chesterton préconise, me semble-t-il percevoir, ces quatre piliers sur lesquels se fonde sa philosophie, d’abord personnelle puis se superposant parfaitement, comme par miracle, à la doctrine chrétienne : le juste jugement, la mesure, l’émerveillement, et la santé – de l’esprit.
« Ces essais ont pour seul objectif de discuter de ce fait réel que le noyau central de la théologie chrétienne, résumée de façon satisfaisante par le Credo des Apôtres, est le meilleur fondement de l’énergie et d’une saine morale. »
Tout Chesterton, me semble-t-il, ou du moins toute la substance de Chesterton, se trouve dans cette phrase liminaire ; plus précisément, dans cette discrète mais lumineuse épithète de saine. Mais il ment, ce n’est pas seulement une apologie actualisée du christianisme, c’est un essai qui laisse voir la grande profondeur d’esprit de l’auteur sur les questions polémiques de son temps, qu’il analyse en premier lieu sans le filtre du christianisme, puisqu’il y est lui-même venu tardivement dans sa vie. Le paradoxe sur le chrétien libéral tombé d’un dogme à un autre, ou la parabole sur les murs du terrain de jeu protégeant l’enfant du précipice figurant le cadre moral nécessaire à l’épanouissement réel ; la parabole sur le poteau à repeindre en blanc continuellement comme étant du conservatisme bien compris ; la conception d’un rapport au monde comme étant une hétérogénéité entre lui et l’homme, qui doit être sain d’esprit pour pouvoir apprécier tout le bizarre et l’extraordinaire de la vie ; sur la méfiance à nourrir, non pas à l’endroit de la raison, mais à l’endroit des raisonneurs, qui ont raison de s’en tenir aux faits mais qui devraient alors les voir réellement ; sur le fou qui n’est pas exempt de raison mais qui est « celui qui a tout perdu, sauf la raison »... Beaucoup de nœuds, à nouer et à dénouer sans cesse, pour un grand plaisir de lecture intellectuellement stimulant. Peut-être en ferai-je une « critique » plus élaborée un jour.
Hamlet (1603)
(traduction Jean-Michel Déprats)
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark
Sortie : 2002 (France). Théâtre
livre de William Shakespeare
Kavarma a mis 9/10.
Annotation :
Rattrapage de classique, et pas des moindres !#2. Et puis j’avais envie après Chesterton de lire un peu de littérature anglaise.
La tragédie dans ce qu’elle remue de plus profond, mais plutôt d’un point de vue organique, je dirais même d’un point de vue des viscères et de la morale, les deux ensemble en vérité. Pour tuer, Hamlet prince de Danemark doit savoir absolument, il veut accomplir l’acte, il ne veut pas l’injustice, mais cette envie bouillonne jusqu’à se faire confondre l’envie de savoir et l’envie de tuer, les deux ensemble, qui sont une seule et même envie de justice. Le spectre du feu père descend parler à Hamlet, et lui souffle cette solution de vérité aux bouleversements, à cette étrangeté qu’il ressentait déjà. Simulacre de folie pour dégager le vrai, mise en scène de pièce de théâtre pour confondre les coupables car c’est le miroir, quoique fictif, d’un acte qui en montre toute l’horreur chez ses actants, qui insuffle en eux... quoi ? La honte ? La peur ? La culpabilité ? Tout ? Mais le justicier assoiffé de justice en vient à se laisser finalement aveugler par la rage, et à commettre l’injustice, à devenir le fou qu’il simulait auparavant... C’est la tragédie du crime engendrant, dans sa propre démesure, la démesure d’un autre crime. Pauvre Ophélie, cette figure du désir impossible pour l’homme qui a une mission, figure d’un destin sacrifié, aussi, à l’aveuglement de la rage, et qui finit par inspirer dans sa délicate mort tant de peintres préraphaélites.
Et sinon, pareil, qu’est-ce que je pourrais bien dire de neuf ou d’intéressant sur Hamlet ? Hm ? Rien, non ? Ben voilà. C’est une pièce qui charrie une grande puissance émotionnelle.