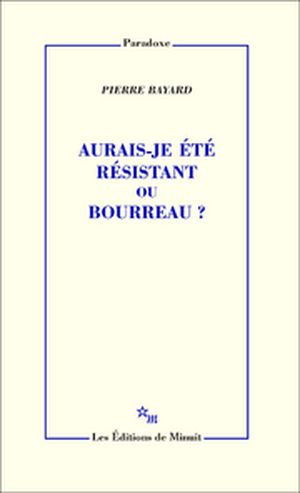Pierre Bayard s’attaque à une question impossible, presque provocante : que serait-il devenu pendant la Seconde Guerre mondiale ? Bourreau ? Résistant ? Rien du tout ? Il sait que l’exercice est fictionnel, limité, mais il le mène avec sérieux, en interrogeant les mécanismes psychologiques et sociaux qui façonnent nos comportements en temps de crise.
Ce qui ressort, c’est que la personnalité profonde ne se révèle vraiment que dans l’adversité, et que beaucoup d’entre nous ne sauront jamais qui ils sont vraiment, faute d’avoir été confrontés à une situation extrême. L’auteur insiste sur le fait que devenir bourreau est plus courant que devenir résistant. C’est la pente naturelle, celle qui se dessine quand les barrières tombent, quand l’autorité couvre nos actes, quand le groupe nous absorbe.
Bayard convoque Milgram, bien sûr, et cette idée glaçante : on appuie sur le bouton tant que l’autre accepte, et on rejette la faute sur l’autorité. L’humain, s’il est encadré, couvert, encouragé, peut faire le pire sans se sentir responsable. Le conformisme de groupe et la soumission à l’autorité sont les deux piliers du basculement.
Mais il y a des contrepoids. L’image de soi, la honte, le regard des autres, la peur de ne pas être fidèle à ses valeurs. Il faut parfois se mentir à soi-même pour agir, sortir du cadre confortable, du moule social, et inventer une action originale. Et ça coûte. Agir coûte plus que ne rien faire.
La résistance, dans ce livre, prend deux formes : celle du héros combattant, et celle du sauveteur discret, qui cache, protège, agit sans violence. Les deux demandent une force d’âme, une ossature morale, souvent héritée du modèle familial, parfois nourrie par une foi, ou par un lien avec un autre qui agit et nous entraîne.
Bayard montre que l’empathie ne suffit pas. Il faut aussi une capacité à penser en dehors des cadres, à se détacher du groupe, à accepter la solitude morale. Et même là, rien n’est garanti. Il y a une part de mystère dans le fait de devenir résistant, une dimension presque mystique, tant cela va à rebours de l’intérêt personnel.
Ce livre ne donne pas de réponse, mais il pose les bonnes questions. Il nous confronte à notre propre passivité, à notre confort, à notre image. Il nous rappelle que l’autre moi, celui qui agit ou qui se tait, ne se révèle que dans la crise. Et que la majorité reste entre les deux, dans une forme d’apathie velléitaire.
Une lecture stimulante, dérangeante, mais salutaire. Bayard ne cherche pas à briller, il cherche à comprendre. Et à nous faire réfléchir, sans nous flatter.