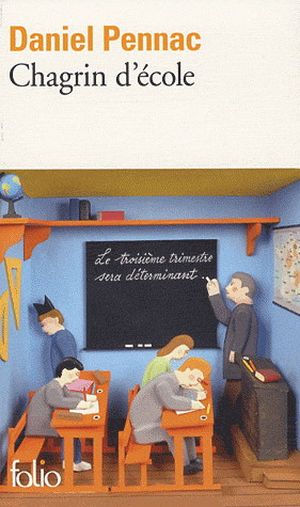Chagrin d’école, Daniel Pennac
Laissant la voix au cancre qu’il fût, Daniel Pennac interroge et réfléchit la figure psychologique, sociologique et historique du « cancre ». C’est que subsumant les singularités d’un cancre tantôt bourgeois (le cas de Pennac), tantôt prolétaire ; tantôt rural, tantôt urbain ; des années 60 ou d’aujourd’hui, etc., il existe un « commun » du cancre : une incompréhension et une solitude immense, la perte de confiance en soi (notamment alimentée par l’institution) et un sentiment de fatalité, les réprimandes et les accusations (« tu le fais exprès »). Une souffrance donc. Mais aussi un certain nombre de stéréotypes, comme le cancre ne « veut » rien faire ou, plus contemporainement, il est ce délinquant banlieusard, violent et irrécupérable. C’est dire en effet que, pour Pennac, nulle cause (encore moins unique) ne saurait facilement être assignée à ce commun de douleur qui fait le cancre. Je peux venir d’ici ou de là et me retrouver en situation d’échec scolaire. La cancrerie est certes favorisée par des facteurs socio-économiques, mais ceux-ci n’épuisent pas l’explication de celle-là. Pour lui-même, D. Pennac ne sait expliquer pourquoi il avait tant de mal à comprendre à l’école, et pourquoi le moindre apprentissage, dès lors qu’il s’opérait dans le cadre de la classe, devenait opaque. Cependant, il s’explique davantage sa « métamorphose » en professeur et homme de lettres. La rencontre d’une poignée d’hommes et de femmes, professeur(e)s, devait produire en lui une profonde secousse. A ses yeux, ces hommes et ces femmes se retrouvent dans la sincérité de leur démarche, la passion de la matière enseignée, leur dévouement envers chacun des élèves, leur exigence et donc leur bienveillance, la pleine compréhension de leur mission qui est de cheminer dans la difficulté (en sachant qu’avant d’apprendre il est parfois nécessaire de donner le désir d’apprendre), leur pleine présence aux élèves à même de redonner confiance et de faire advenir ce « présent d’incarnation » que théorise l’écrivain. C’est le temps de la classe et de la présence aux apprentissages, le ici et maintenant de l’élève presque débarrassé de lui-même, du rôle social et familial, pour être enfin disponible au savoir. Pour l’auteur, ces êtres rares sont d’autant plus précieux aujourd’hui que la jeunesse est absolument instrumentalisée par « Grand-mère Marketing », qui lui prend sa tête et ses désirs sous le couvert du divertissement et de l’anodin. Une jeunesse toujours plus déracinée par manque de culture et qui se trouve poussée comme jamais à la consommation. Une jeunesse cliente qui se voit adulte par le mimétisme de l’achat et de la propriété privée. Ce phénomène qui date du milieu des années 1970 complexifie encore la tâche du professeur, confronté à des élèves-clients (parmi lesquels des cancres-clients) qui connaissent rarement un langage de l’amour qui ne parle pas « objets »…
« Pourquoi le cancre abandonnerait-il son statut de maturité commerciale pour la position de l’élève obéissant, qu’il estime infantilisante ? Pourquoi irait-il payer à l’école [en termes d’engagement, d’efforts] dans une société où des ersatz de connaissance lui sont, du matin au soir, proposés gratuitement sous la forme de sensations et d’échange ? Tout cancre qu’il soit en classe, ne se sent-il pas maître de l’univers quand, enfermé dans sa chambre, il est assis devant sa console ? (…) ».