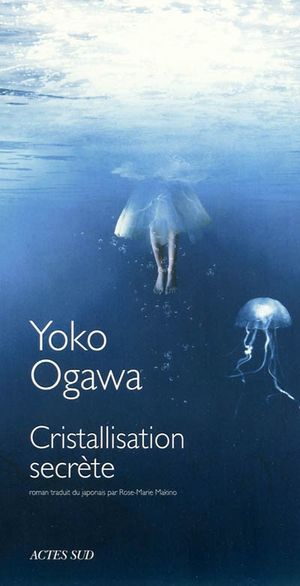La trame du roman semble, au premier abord, quelque peu banale, faisant usage des tropes de l’anticipation : un monde sous totale surveillance, avec une milice, des gens qui se cachent, une métaphore du totalitarisme aliénant avec ces mystérieuses « disparitions ».
Mais déjà, cet aspect là n’est pas si banal, en tout cas il n’est pas banalement traité. Les disparitions semblent frapper au hasard, sans grande cohérence, même s’il semble que les éléments du monde qui s’évanouissent soient de plus en plus « intimes ». Les choses ne disparaissent pas objectivement, mais dans la perception, elles perdent pour les habitants de l’île toute connotation, toute utilité. Elles deviennent étrangères. Cela crée une atmosphère mélancolique au récit, d’autant plus que la plupart des habitants ne peuvent lutter contre l’oubli. Ce n’est pas un hasard si une rivière coule à côté de la maison du personnage principal : on a l’impression d’un cours incessant, inexorable, qui emporte tout. Ce n’est pas vraiment plus triste que le temps qui passe.
Le point le plus intéressant du livre est très certainement le récit enchassé, écrit par le personnage principal, qui est autrice. Il nous dépeint une relation d’emprise totale entre un homme et son étudiante, qui la séquestre physiquement et la réduit à néant, comme toutes les femmes qu’il rencontre. Elle perd progressivement son humanité, jusqu’à devenir une des nombreuses machines à écrire brisées, l’outil même dont son agresseur lui enseignait l’usage. La parabole est brillante, car elle tend à montrer comment d’une part l’oppression que fait subir un système totalitaire peut toucher intimement, comme dans une relation dysfonctionnelle, violente ; d’autre part, que les mécanismes d’emprise sont comparables : nous faire oublier ce qu’on était, quels étaient nos goûts, nos préférences, nous faire croire que ce qui nous opprime est pourtant le seul point de référence, le seul moyen d’être heureux, est le propre autant d’un système coercitif que d’un amant toxique.
Mon petit bémol serait le développement des personnages, qui ne présente rien de neuf ou de particulièrement intéressant. Une relation mignonne avec un vieil homme, bourru et doux, la figure paternelle du récit. Plus agaçant, l’éditeur qui est au départ un ami qu’elle cache dans son sous sol, et qui évidemment, devient son amant (alors qu’il a déjà une famille). C’est agaçant, parce que cette relation semble simplement guidée par le fait qu’un homme et une femme du même âge ne peuvent pas avoir d’autre lien d’intimité que celui d’une relation amoureuse. Il y a pourtant suffisamment de liens dans le récit les rapprochant et créant une relation d’interdépendance entre eux pour qu’ils aient besoin de ce lien supplémentaire.
De belles images restent néanmoins en tête après la lecture : les roses filant sur la rivière, le jardin de roses abandonné, ce clocher rempli de machines à écrire brisées, le vieil homme essayant, seul, de retrouver vainement du sens à la musique qui sort de sa petite boite.