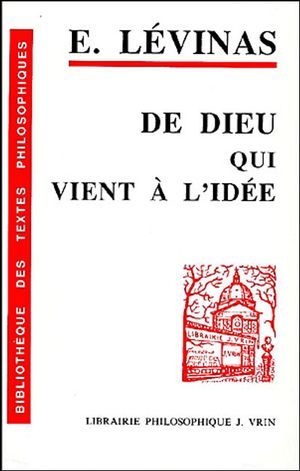Je ne vais pas parler de tout le livre, pas même des très beaux chapitres sur la vigilance et sur Dieu : je voudrais juste parler du Mal dans ce livre et plus généralement dans Lévinas. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup et il y a plusieurs paradoxes qui me frappent dans cette notion. D'abord, il me semble qu'on peut la comprendre dans deux sens tout à fait opposés (mais qui se rejoignent peut-être secrètement) : soit comme marque de l'inscription de la volonté dans une réalité matérielle (au sens où l'intention morale se corromprait inévitablement en se réalisant dans une action, au sens des "mains sales" de Sartre, même si j'ai pas lu le bouquin c'est ce que je mets dans cette image : agir c'est "mettre les mains dans le cambouis", "se salir les mains", dans toute action il y a une compromission des idéaux moraux qui est la condition de leur incarnation) ; soit comme la marque d'une structure propre à la volonté. Soit on comprend le mal comme le résultat de la mise en relation du vouloir avec l'extériorité du monde, soit on le comprend comme une propriété intrinsèque de la volonté. Je ne vais pas épiloguer sur cette distinction, j'en viens vite à Lévinas, mais je ferais simplement la remarque suivante : dans le même ordre d'idées que ce que je viens de dire, soit on comprend le mal à la Socrate ("nul n'est méchant volontairement"), c'est-à-dire comme la marque d'une chute dans l'involontaire, soit on comprend le mal, je dirais, au sens de la perversion ou de la transgression, c'est-à-dire comme l'effet d'une volonté voulant tellement s'affirmer qu'elle se hisse à l'arbitraire, est prête à renverser le devoir, vécu comme une borne, pour se poser comme souveraine. Le mal serait l'effet, soit d'une faiblesse de la volonté, soit d'une sur-puissance du vouloir qui le place au-delà du devoir ; soit d'une limitation empirique (les impulsions, le manque de savoir, le "pathologique" kantien), soit d'une infinité structurelle. Mais bref. Ce qui m'intéresse chez Lévinas, dans ce cadre, c'est cette conception d'une responsabilité fautive dans la mesure même où elle est responsable, c'est l'idée que la mauvaise conscience est condition de la moralité. Autrement dit, dans l'alternative que j'ai essayé de dessiner, il serait du côté de la compréhension du mal comme caractère propre à la volonté en tant que telle, et non comme limite externe à sa moralité. Lévinas cite souvent la phrase célèbre de Dostoïevski, "Nous sommes responsables de tout devant tous, et moi le premier", et pour cause : ça met bien en évidence cette idée d'une responsabilité en défaut sur ce dont elle est responsable, d'une liberté en défaut sur ce qu'elle doit. La conscience morale est essentiellement inquiète, l'affect moral par excellence, c'est le "souci" (on parle de "souci moral"), sinon la culpabilité (les gens qui ont "bonne conscience" ne sont jamais vraiment bons), parce que cette conscience intime, inextinguible, d'une inadéquation à la loi, est le moteur qui nous fait tendre vers elle. Donc être responsable, c'est être coupable : pas de différence entre responsabilité et culpabilité. C'est dans l'épreuve d'un mal accompli (le mal est fait) et pourtant in-assumable (qu'est-ce que j'ai fait ?) que je découvre la moralité.
Il faut reprendre les choses à zéro, remettre les pendules à l'heure, revenir au point de départ de la réflexion de Lévinas, qu'on voit par exemple dans ce passage à la fin de Totalité et infini : "La liberté ne se justifie pas dans la conscience de la certitude, mais dans une exigence infinie à l'égard de soi, dans le dépassement de toute bonne conscience". Pour comprendre ce passage il faut voir ce que dit Lévinas juste avant, l'idée que c'est l'autre qui me juge, qu'agir c'est agir sous le jugement de l'autre et donc que je suis justifié par un autre. Paradoxalement, la liberté ne peut pas s'auto-justifier, c'est toujours un autre qui la justifie. On arrive au vrai problème que pose Lévinas quand il parle du mal, et qui tient au caractère asymétrique de la relation interpersonnelle (selon l'expression qui donne son titre à une section de Totalité et infini) : je suis responsable d'autrui, mais autrui n'est pas responsable de moi. C'est en vertu de cette non-réciprocité qu'il est impossible de soumettre la relation à autrui à un calcul équitable. En fait je simplifie. Disons qu'il y a ça, d'un côté, c'est-à-dire le fait que je suis absolument responsable de ce qui arrive à autrui, mais que l'inverse n'est pas vrai, de sorte que l'action morale est toujours de l'ordre d'un don, irréductible à un échange équitable (du genre sois gentil si tu veux qu'on soit gentil avec toi), et que ce don possède un caractère infini ; ensuite il y a le fait que ma responsabilité, c'est celle qui m'incombe en tant que sujet, et que mes conduites sont à ce titre in-excusables en fonction de lois objectives (c'est l'échappement de la subjectivité à l'objectivité qui explique son caractère irréductiblement responsable). Mais bref, il y a une situation d'exception du moi, quelque chose d'in-intégrable, une relation non-réciproque à l'autre qui m'investit d'une responsabilité.
(Au fait, c'est étrange, je trouve, que Lévinas conjugue ces deux thèmes apparemment opposés : celui d'une liberté déposée (il parle de "déposition" du sujet devant l'autre dans De Dieu qui vient à l'idée pour dire que face à l'autre je ne suis plus tout-puissant, je dois m'incliner face aux devoirs qui m'incombent du fait de ma relation avec lui) ; et qu'en même temps cette déposition soit le fait d'une liberté absolument irréductible. Le moi est in-substituable, mais pas souverain. J'aime bien cette solitude qui m'est imposée du fait même de ma relation à l'autre.)
Revenons à nos moutons. Il y a un beau passage où Lévinas développe ce paradoxe d'une justice infinie, d'une exigence incalculable : "la justice me somme d'aller au-delà de la ligne droite de la justice, et rien ne peut marquer dès lors la fin de cette marche (...) Je suis donc nécessaire à la justice comme responsable au-delà de toute limite fixée par une loi objective". C'est là qu'on rejoint, me semble-t-il, le thème présent dans le chapitre "De la déficience sans souci" de De Dieu qui vient à l'idée. Lévinas se demande comment il se fait qu'on ne soit jamais à la hauteur de nous-mêmes. Ce n'est pas par hasard : être soi, être un soi, c'est être en défaut par rapport à soi. Comme il le dit, la déficience humaine est "l'envers de sa tâche d'être". Ce qui me paraît intéressant dans ce chapitre du livre, c'est que c'est l'exister même de l'homme qui est compris comme tâche : le souci moral est inscrit dans son être même. Il ne s'agit pas de dire que l'homme est d'abord, et qu'il doit ensuite : pour l'homme, être, c'est devoir (puisqu'exister c'est avoir à être). Donc déficience ontologique, et pourtant, dans le même temps, le moi est marqué par l'impossibilité de se dérober à soi -- le mode d'existence du moi, c'est l'assomption : il "a à être" ce qu'il est (Lévinas aime bien rappeler cette expression de Heidegger, "l'avoir-à-être"). Je vous cite le passage en question : "Le ne-pas-pouvoir-se-dérober, c'est précisément cette marque d'unicité en moi : la première personne reste première personne, même quand empiriquement elle se dérobe". Lévinas utilise aussi ce terme d'assomption à un autre moment du livre : "Rien n'arrive à l'homme qui ne soit, à un degré quelconque, assumé". Quoi qu'il en soit, infinité de la tâche d'être soi : on n'est jamais à la hauteur de son devoir, déficience de l'être et pourtant impossibilité de se complaire dans cette "défectuosité" (si j'ose dire) : il faut surmonter son propre défaut, excéder les bornes de sa capacité à être.
J'aime bien cette idée, ça me fait penser à Devant la loi de Kafka : dans le texte de Kafka, le moi est fautif de naissance, d'une façon originelle. Sa culpabilité ne découle pas d'un acte qu'il aurait commis, mais lui vient de sa sujétion même à la Loi. Devant la loi, on est toujours coupable : pour cela pas besoin d'avoir fait quelque chose en particulier... Faut-il dire, du coup, qu'on est coupable de n'avoir rien fait ? Ou de ne pas en avoir fait assez ? Je ne sais pas, je crois que notre existence même est une faute, que l'exister de la volonté est coupable par nature. Cela, pas seulement parce qu'il y a une disproportion entre l'universalité de la loi et la singularité de la personne, qui rend la Loi irréalisable dans la mesure même où elle vaut (qui rend le devoir inapplicable précisément en tant qu'il vaut comme devoir, c'est-à-dire en tant qu'il faut l'appliquer : on ne peut pas le faire parce qu'il faut le faire ; et si on pouvait le faire, il ne faudrait pas le faire) ; également parce que la loi est inconnaissable, cryptique, parce qu'il y a un indéfini du devoir qui nous empêche de nous y conformer. Que dois-je faire ? demandait Kant. Que dois-je faire ? demandent Kafka, Lévinas. Mais en un tout autre sens : car il ne s'agit pas de déterminer le critère d'évaluation morale d'une conduite (puis-je l'universaliser), mais de déterminer le contenu du devoir (on procède dans l'autre sens en quelque sorte chez Kafka, on ne remonte pas du contenu à sa légalité mais on part de la Loi impersonnelle et indéterminée pour interroger son contenu). Et puis peut-être que l'ignorance de la Loi fait partie de la nature de la loi, peut-être que la loi est inconnaissable par essence, du fait de sa transcendance. Et je noterais au passage que dans cette descente de la forme au contenu -- descente impossible en réalité -- par opposition à l'ascension kantienne, qui part d'une conduite particulière pour en tester l'universalisabilité, il y a cette inquiétude devant une forme vidée de tout contenu : le Devoir règne en maître, parce qu'il est pure affirmation du "Il faut", qu'il faut l'il faut indépendamment de toute particularité empirique. L'universalité formelle de la Loi a pour conséquence son indéterminabilité matérielle : la loi est pure forme, vraiment, indifférente à tout contenu, inapplicable à quelque cas que ce soit, indéterminable quant à sa matière. Mais la culpabilité est originelle aussi parce que, chez Lévinas comme chez Kafka me semble-t-il, c'est en tant qu'il est que le sujet est fautif : le moi est coupable avant même d'avoir fait quoi que ce soit, il y a comme une antériorité de la faute sur le sujet qui en est responsable, parce que c'est cette faute qui me produit comme sujet. Chez Lévinas, ça se voit bien dans l'analyse de la honte qui est faite dans De l'évasion, au moment où la honte est interrogée comme responsabilité à l'égard de ma propre existence, dans ce qu'elle a d'inassumable. La honte est sentiment de culpabilité, mais pas devant tel ou tel acte, pas devant telle action que j'aurais commise, non : elle est responsabilité coupable à l'égard du fait même d'exister. C'est de mon existence même que j'ai honte. Concrètement, Lévinas dit que la honte c'est quand on est pris en flagrant délit, quand on trahit quelque chose de son intimité ; bref, c'est la présence du soi à lui-même, l'éclatement en plein jour de ma propre présence physique (en l'espèce : la nudité), l'impossibilité de me cacher, de me couvrir c'est-à-dire de dénier, de refouler ma propre présence, qui fait honte. Dans la honte, le moi se découvre responsable, non de sa quiddité, mais de son esse lui-même : responsabilité à l'égard de son propre exister qui précède et conditionne la responsabilité à l'égard de ses propres conduites, la honte m'ipséise, me rive à moi-même comme sujet, en tant qu'elle me découvre fondamentalement injustifiable. C'est sûrement pour ça que Lévinas dit que "la honte est en fin de compte une existence qui se cherche des excuses". Avoir des excuses, c'est être libéré de sa propre originarité ontologique, c'est ne plus être à partir de soi c'est-à-dire ne plus être soi. L'être, en tant que commencement infondé, est absence de toute justification. Ou peut-être est-ce l'inverse : peut-être y va-t-il plutôt, dans l'existence du moi, d'une conséquence sans prémisses, d'un produit sans origine. Peut-être le moi est-il déraciné, et partant injustifiable car dépourvu de fondement. Il me semble que dans cette idée d'une "brutalité" de l'être (brutalité qu'il faut entendre au sens de la violence, mais aussi au sens de ce qui est brut, in-élaboré, c'est-à-dire, de ce qui n'est pas le résultat d'une construction), il y a aussi cette idée. Fautif faute de raison d'être, en défaut à défaut d'être positivement fondé, le moi est injustifiable. Être, c'est être coupable.
Et il y a aussi cette grande étrangeté, je trouve, de la pensée de Kafka : que la loi me soit adressée, me soit destinée, alors même que je ne puis rien lui répondre. Je suis désolé d'être aussi emphatique, mais c'est vraiment un immense mystère, je trouve, cette "chute" de Devant la loi : au moment précis où le personnage demande, interroge, pourquoi les autres ne sont pas entrés, ça y est, la porte est celée à jamais. On pourrait gloser pendant des siècles. Ma professeur adorée chérie disait "texte extra-ordinaire, d'une profondeur inouïe". Je suis d'accord, quoique je n'aie pas encore sondé cet abîme. J'aime beaucoup le fait que la loi soit universelle, non seulement dans sa forme mais, virtuellement, dans ses destinataires, et que pourtant elle ne soit adressée qu'à moi : elle est entièrement présente dans cette relation personnelle. Non pas métonymiquement : entièrement. Elle n'est faite que pour moi. Et il y a cette intimité non-réciproque, cette proximité de l'impénétrable, cette adresse personnelle de l'impersonnel. Je suis requis par la loi, mais ne puis répondre à ce qu'elle me demande. Je ne peux même pas entendre sa demande. Non seulement les médiations sont infinies, mais elles sont gardées, par le "gardien" qui, à la fois, défend l'accès à la loi et, par là-même, l'institue à nos yeux comme loi. Si la loi n'était pas celée, ce ne serait pas une loi.
Et je trouve très frappant que le Mal non seulement découle du réel, mais même soit le réel, que l’ess-a-nce de l’être, l’acte d’être de ce qui est soit Mal, que l’être en tant qu’il est soit — mauvais… purement et simplement… Car le Mal est tracé, trace, traçance aimerais-je dire si je l’osais… « ça laisse des traces » : un viol, une maltraitance, un harcèlement, un viol… Comme si le propre du mal, c’était d’être super-réel, sur-réel : absolument irréversible, ineffaçable. Le mal est fait, vraiment : on ne peut revenir là-dessus. Le mal est réel en tant que mal. Le mal c’est la blessure du réel, c’est le réel en tant que blessure, et en tant que sa blessure laisse une cicatrice indélébile sur l’existant qui y fut, non seulement exposé, mais même confronté. Le bien s’oublie, le bien s’efface : mais le mal, non. Le Mal est inoubliable. Vraiment. Démesure de la différence : mon professeur adoré avait intitulé sa thèse, « Démesure et différence ». C’est le Mal qui incruste dans ce qui est la douleur du temps, la souffrance de l’effectivité. On n’y coupera pas putain de merde, « et vous n’échapperez pas à l’épreuve de ce dont il n’y aura jamais eu d’expérience, faute d’un sujet capable de la vivre », disait mon professeur adoré. « Il y a » : cela, c’est terrible. Et là où le Bien est oubli, correction et rectification, le Mal est abandon, abdication face à ce qui est, abandon aux pressions du désir, à la naturalité sauvage de notre vouloir — pas même vouloir : impulsive, compulsive pulsion qui pousse, pousse, pousse aveuglément — cécité de l’élan. Abandonner, s’abandonner : absence, urgence. Intensité de l’involontaire. Rien à dire face au Mal. L’être est, l’être se pose, il y a l’il y a : si violente évidence. Je ne puis souffrir cette absurdité d’Aristote, que j’entends si mal cela étant : le mal, c’est la privation. Le mal, c’est le fait d’un être qui n’est pas pleinement. Le mal, c’est le Négatif pur. Non. Non non. Non non non. Le mal c’est la positivité du positif, c’est l’irrépressible positionnalité de l’esse. Le bien est toujours un irréel : le bien, c’est l’Ineffectif. Lévinas a cette formule magnifique, dans le chapitre de De Dieu qui vient à l’idée que je n’ai pas relu : le Mal c’est le dérangement, le non-intégrable, le non-synthétisable. Et je suis d’accord dans la mesure où le Mal c’est l’inintelligible, le Mal opacifie notre expérience, introduit un trouble, un malaise, un incompréhensible. L’homme mauvais, le Fat, c’est un « monstre incompréhensible », dit quelque part Pascal. Il le dit quelque part. Ça suffit. Ça suffit à comprendre. Vous saisissez ?
En même temps, je noterais qu'il y a aussi cette très belle idée, à l'opposée de tout ce que je viens de dire, dans De l'évasion : toute philosophie de l'être serait barbarie. Citons le passage : "Toute civilisation qui accepte l'être, le désespoir tragique qu'il comporte et les crimes qu'il justifie, mérite le nom de barbare". Je trouve ça assez beau parce que ça veut dire que le réel, par sa réalité même (qu'il faudrait écrire réal-ité : le caractère réel du réel), est mauvais. N'allez pas chercher là-dedans un quelconque dédain du monde à la sauce judéo-chrétienne (comme Nietzsche le ferait sans doute) : c'est une idée très profonde en fait, et qui veut dire plusieurs choses. D'abord, que le devoir, il suppose un refus du monde tel qu'il est (donc une négativité en quelque sorte) : l'être se caractérisant, pour Lévinas, par une sorte d'adhésion à soi, de coïncidence tautologique, la différence et l'évolution lui viendront toujours d'un élan vers un non-être. Plus simplement dit, il s'agit de rompre avec l'auto-suffisance de l'être, avec ce que j'aurais envie d'appeler sa suffisance (dans tous les sens du terme). Donc on revient bien à l'idée de départ d'un réel mauvais par lui-même, et d'une volonté qui impose la rigueur du devoir à un monde lui demeurant réfractaire. Ensuite, d'une façon que je trouve très belle, il y a dans cette idée une opposition entre le monde et l'humain (l'être étant "barbare", c'est-à-dire fondamentalement inhumain) : j'y vois l'idée lévinassienne que la relation de face-à-face avec autrui est irréductible à la relation avec un objet (je crois que ça lui vient de Martin Buber), bref que le rapport inter-subjectif est utopique, hors-monde. Enfin, dans cette idée, je vois le refus d'abandonner cyniquement les idéaux, au nom d'un réalisme de bon sens qui amènerait, d'une façon supposément inévitable, à reconnaître leur caractère in-atteignable. N'importe quoi ! De toute façon la moralité c'est faire l'impossible. Faire le bien demande nécessairement un courage héroïque, parce que faire le bien c'est refuser de se donner des excuses (or des excuses, on peut toujours en trouver, il y a toujours un contexte empirique, un enchaînement de causes et d'effets, qui peut justifier nos méfaits). Bref : sympa cette idée qu'on est au-delà de l'être, c'est-à-dire, que la volonté est in-excusable, absolument responsable, irréductiblement libre.
Mais peut-être suis-je en train de trahir le fait que j'avais tort d'opposer au départ les deux versants que je vois dans le concept de Mal... Car peut-être est-ce au fond ce décalage de la volonté par rapport à elle-même, qui tient à ce qu'elle est écartelée entre ses buts voulus et ses conditions réelles, peut-être est au fond cette tension interne d'une responsabilité en droit infinie et en fait limitée qui explique ces deux aspects du problème que j'ai cités au départ, peut-être que toute la difficulté, c'est qu'on doit ce qu'on ne peut, c'est la disjonction essentielle, fondamentale, entre les devoirs et les pouvoirs. Pour valoir, la Valeur doit transcender le réel ; mais, dès lors, elle est irréalisable : parce qu'elle vaut, elle est impossible. "Tu dois, donc tu peux", disait Kant. "Tu ne peux pas, donc tu dois", diraient Lévinas et Kafka.