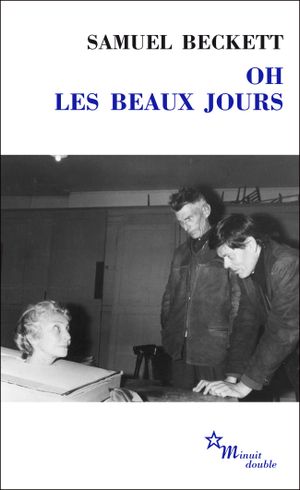J'ai beaucoup aimé cette pièce, qui parle très bien du silence à mes yeux. C'est sans doute la meilleure manière de parler du non-sens : le mettre en scène dans la faillite du discours -- non pas une faillite dramatique, non pas un effondrement violent et subit, mais de simples cassures, de discrètes fêlures, incessamment répétées. C'est ça que j'aime beaucoup, je crois, dans Beckett, c'est que des écrivains de l'absurde que je connais (Camus, Sartre et lui) c'est celui qui en parle le mieux. Chez Sartre et Camus, ce qui m'embête c'est que l'absurde est dramatisé, théâtralisé dans la tragédie de la répétition insensée (Camus) ou dans la crise de l'esprit (Sartre : je pense à la "scène du marronnier" et au face-à-face entre le Pour-soi et l'En-soi). Je ne me souviens peut-être pas assez bien des textes de ces deux auteurs sur l'absurde (je pense au Mythe de Sisyphe et à La nausée) mais il y a quand même chez eux, à mes yeux, cette gravité, ce poids du non-sens, qui ne me semble pas rendre parfaitement l'ambiguïté de ce sentiment de l'absurde. Chez Beckett, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce sens du comique, oserais-je dire cette dérision tragique et ce tragique dérisoire. On ne sait jamais s'il faut en rire ou en pleurer, et pour cause : nos larmes sont comiques et nos rires sont tragiques... Il y a ce passage l'un dans l'autre du plus grave au plus insignifiant, et toute l'instabilité de cette pensée, à mes yeux, toute son inquiétude, c'est que le grave ne soit pas grave car c'est justement que rien ne soit grave qui est grave... Je pense notamment à l'usage du journal qui est fait dans cette pièce : c'est drôle cette manière qu'a Willie de nommer des événements censés être significatifs, signifiants (sinon ils ne figureraient pas dans un journal...) et de les dire comme d'énièmes faits racontés par un énième numéro de journal (il dit des trucs du genre : "baisse du rendement..." "mort de Perier..."). Au fond ça rend bien l'ambiguïté de l'objet "journal", qui est d'être le médium banal de l'événement, le lieu qui s'efforce de dire l'important, le remarquable, le significatif, mais énonce tellement de choses supposément graves que ça en devient juste insignifiant. Et c'est drôle que le journal soit justement un médium langagier : c'est la mise en mots de l'événement, et cette énonciation de "ce qui se passe", cette diction de l'action, elle en fait une monnaie creuse qu'on s'échange dans des conversations insignifiantes ("tu sais pas quoi, il s'est passé ceci ou cela en Syrie" -- ce qui devrait être un drame devient un événement parmi tant d'autres, l'enjeu d'une conversation banale). C'est drôle que dans l'objet "journal", la mise en discours soit le lieu, non pas d'une donation de sens (quoique les faits soient commentés) mais d'un évidement du sens, ou tout au moins du significatif. L'unique est pris dans une répétition : tous les jours, un nouveau numéro de journal, tous les jours, de nouveaux événements -- quoi ? peu importe, demain il y en aura d'autres. Ça me fait penser à l'analyse que fait Claude Romano de l'événement journalistique dans L'événement et le monde : le journal, il fait déchoir l'événement au rang de "fait intra-mondain", c'est-à-dire que les événements gravissimes deviennent juste trois lignes parmi tant d'autres dans un numéro parmi tant d'autres. Ça me plaît bien cet usage du journal, à mes yeux ça veut dire : il ne se passe rien, même quand il se passe quelque chose il ne se passe rien. C'est vraiment un théâtre de l'inaction ! D'où la paralysie, d'où les gestes incessants de préparation à une action qui ne vient jamais (se coiffer, se mettre du rouge à lèvres, se brosser les dents -- mais pour aller où, puisque de toute façon on a perdu l'usage de ses jambes ?). Et j'aime bien la manière dont Winnie fait semblant de s'émerveiller des faits journalistiques que lui raconte Willie : oh là là ! un tel est mort ! comme si elle essayait de recréer de l'événementialité, de la nouveauté, dans une temporalité parfaitement vide et cyclique, où tout n'est que perpétuel vide entre deux vides : de la veille au sommeil et du sommeil à la veille, on navigue d'une vacuité l'autre, sans jamais sortir du rien. Comme si elle essayait de simuler la surprise, de faire comme si il y avait de quoi être ému, de quoi réagir, alors qu'en fait non, tout disparaît, et le pire c'est qu'en un sens on ne peut même pas s'insurger de cette disparition, se révolter contre sa condition : à quoi bon ? pour quoi faire ? au nom de quoi ? Qu'y a-t-il de significatif dans l'insignifiant ? Comment pourrait-on se révolter contre la platitude même ? J'ai peut-être tort de le lire comme ça, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup chez Beckett, notamment parce que je m'y reconnais : une grande faiblesse, une grande lâcheté, une grande inertie. Pas de combativité, pas d'héroïque espoir : justement un lâcher-prise, un abandon parce qu'il n'y a rien contre quoi l'on puisse lutter à proprement parler. À mes yeux, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le balancement très étrange dans lequel se trouve prise Winnie : la pièce est partagée entre des moments où elle fait semblant de faire quelque chose (et même : où elle fait semblant de s'intéresser à la semblance ! à l'apparence ! en se maquillant, regardant dans la glace etc. !), de discuter avec Willie, bref de s'affairer, de vivre, et des moments où elle se rend compte de la vacuité de tout ça, à savoir les moments où sa voix se brise, et tout particulièrement le très beau passage où elle dit le fait qu'il n'y a rien à dire ("Plus un mot jusqu'au dernier soupir, plus rien qui rompe le silence de ces lieux"). Comme si elle avait des étincelles de lucidité dans un flot d'illusion et de discrète dénégation du néant. Mais ce que je trouve très beau dans cette alternance, c'est la manière dont Winnie est systématiquement, irrémédiablement rattrapée par la petite mécanique de sa routine dans les moments où elle se met à s'angoisser. Systématiquement, elle finit par se rendre compte de sa tristesse latente (notamment devant la disparition, le non-sens, la perte), et tout aussi systématiquement, ce douloureux néant la remet en mouvement. C'est très étrange, je trouve, parce que le vide est tel qu'on ne peut jamais s'y affronter, qu'il nous pénètre, nous dirige comme des pantins, au point qu'il est impossible de s'en défaire parce qu'on y appartient complètement. C'est un tel degré de vide que le vide ne peut pas être pleinement conscientisé, qu'il sait se faire discret, que le néant parvient à chaque fois à se faire oublier par des personnages qui n'ont même pas pour eux la possibilité d'y faire face, de prendre du recul vis-à-vis de lui pour éventuellement le surmonter en recréant du sens. À mes yeux, on est aux antipodes de l'itinéraire décrit dans La nausée de Sartre : parce que dans La nausée, si ma mémoire est bonne, ok le personnage est perdu, n'arrive plus à donner de sens à sa vie etc. mais à un moment il prend conscience de la vacuité totale de l'être et après c'est reparti, parce qu'il comprend qu'en fait c'était à lui de donner un sens à sa vie ! Que le Sens il nous tombe pas tout cuit dans le bec mais que c'est à nous de l'inventer ! Super ! Soyons clairs j'adore Sartre mais ça me paraît quand même vachement facile ce retournement (j'espère que je ne me trompe pas sur le résumé parce que j'ai lu le livre il y a longtemps). Le non-sens, la disparition, soit on s'y complaît dans un sommeil assommant, permanent, qui est en lui-même absurde (Willie), soit on s'efforce d'y résister dans des gestes et des paroles qui sont à leur tour vides de sens (Winnie). Face au rien -- ou plutôt : au sein du rien -- aucune issue, aucun moyen de s'échapper. À mes yeux c'est le côté "tragique" de la pièce. Le plus comique, c'est que la souffrance ne vire jamais au tragique, qu'elle soit un simple intermède de lucidité entre deux moments d'abrutissement, que ce soit un enfant mort-né, une "étincelle" comme dirait Jankélévitch (ce qui s'éteint en s'allumant). C'est bizarre cette cyclicité, c'est étrange que l'événement de la prise de conscience, qui devrait, qui pourrait marquer une rupture, introduire une discontinuité ou une linéarité dans l'existence de Winnie, retombe sans arrêt dans la temporalité cyclique de la routine. Et j'aime beaucoup le fait que cette cette prise de conscience, elle passe par un moment de silence. C'est très étrange, je trouve, que le vrai événement, que le moment où il se passe vraiment quelque chose dans la pièce, que les brefs instants où on sent que quelque chose se joue en elle (bien que cet enjeu soit aussitôt déjoué par ce qu'il prétendait dénouer) soient les moments où elle se tait. J'aimerais beaucoup savoir si le "théâtre de l'absurde" est un mouvement théâtral (plutôt que romanesque par exemple) pour des raisons de contingences historiques ou pour des raisons littéraires essentielles. En tout cas, je trouve intéressantes les ressources que le théâtre offre à qui veut illustrer l'absurdité de la vie. Parce que justement, il y a tout ce jeu sur le non-verbal (les gestes de Winnie qui déstructurent son discours, y introduisent des saccades), ce jeu sur la communication, et aussi ce jeu sur l'acte de parler ou de se taire. C'est difficile dans un roman de mettre en scène le fait de se taire, là on peut. Et notamment dans les procédés théâtraux je trouve sympa ce décalage entre ce qu'on voit et ce qui se dit, le fatras verbal de Winnie et le vide du décor ("le silence de ces lieux" comme elle dit), la répétition du "Oh les beaux jours" "Oh quel beau jour ça va être !" et le fait qu'on voit bien qu'il ne se passe rien. C'est très étrange que la scène théâtrale manifeste l'évidence même du vide, et fasse éclater le contraste entre l'obstination de Winnie à espérer quelque chose, et le fait que rien n'arrive, que rien ne se passe : comme si le côté théâtre permettait de matérialiser la dénégation de l'évidence même, parce que ça crève les yeux qu'il n'y a rien à voir. Mais bref : je disais, elle se tait. Et ça c'est un curieux phénomène, à mes yeux, que ce soit au moment précis où elle se tait qu'il se passe quelque chose, comme si le plus sensé c'était de se taire, et le plus absurde, de parler. À cet égard j'aime beaucoup le moment où Winnie dit à Willie qu'elle vient de dire un truc significatif, intelligent, que lui comme d'habitude ne répond pas, et qu'elle lui répond "Oui, il semble s'être produit quelque chose, quelque chose semble s'être produit, et il ne s'est rien produit du tout, c'est toi qui as raison, Willie". J'aime bien que ce soit celui qui se tait qui a raison. On a affaire à "un silence qui en dit long", non pas au sens où il trahit une pensée latente, mais au sens où il dit par son refus même de dire, au sens où sa justesse est d'accepter de se taire, c'est-à-dire de se résoudre à l'insignifiance. C'est un renversement qui me plaît bien, que le faux dans la pièce soit du côté de la parole, et le vrai du côté du silence. Je pense aussi à ce passage où Winnie dit : "Il y a si peu qu'on puisse dire. On dit tout. Tout ce qu'on peut. Et pas un mot de vrai nulle part". Et j'aime aussi beaucoup les moments, qui font un peu pendant à celui-là dans mon esprit, où Winnie demande un truc à Willie, qu'il ne répond pas, qu'elle le prend comme un "non" et qu'elle lui dit "c'est très compréhensible, très compréhensible" (ça arrive au moins trois fois dans la pièce). C'est drôle qu'elle fasse du silence même l'indice d'une parole non-dite, qu'elle fasse du refus de parler la marque d'une pensée inexprimée. Comme si elle cherchait à tout récupérer dans les filets du sens, dans les filets de la communication, là où le désespoir de Willie devrait justement "trouer" ces filets, et fêler sa vie par la même occasion. Et j'aime bien que cette pièce, qui porte précisément sur l'absurde, se caractérise tout autant par une surabondance de discours : comme si la surenchère verbale de Winnie visait à masquer un non-sens originel, comme si on parlait toujours pour se cacher la douloureuse nécessité de se taire. Ce n'est pas seulement qu'on parle pour ne rien dire, c'est qu'on parle parce qu'on n'a rien à dire : la parole a toujours pour but de dissimuler un silence originel, c'est toujours sur fond de non-sens que se détachent, que surnagent désespérément nos pensées. Et j'aime aussi la manière dont Beckett met en scène ce basculement de la parole au silence : sous la forme d'une voix qui "se brise" (sic.). Ce n'est sans doute pas un choix, puisque effectivement quand le silence fait subitement effraction dans le discours, que la parole échoue soudain à se prolonger, ça se traduit par une brisure de la voix, mais peu importe, quand je pense au silence ça me questionne pas mal, le fait que quand on se met à pleurer en parlant de quelque chose notre voix se brise. On croyait maîtriser ce qu'on disait, on croyait savoir de quoi on parlait, et soudain on entend, en acte, à l'instant, dans sa propre parole des significations refoulées, des profondeurs qu'on faisait tout pour oublier : soudain on se rend compte que notre parole nous échappe, le poids d'absence qu'elle charrie nous rattrape et là quelque chose s'effondre, discrètement, pendant quelques minutes voire quelques secondes mais quand même. Comment ça se fait que le silence, ce soit toujours une cassure (les pleurs qui nous ôtent les mots de la bouche), un intervalle embarrassant (les "blancs" dans les conversations), une lassitude ou un traînement (quand on ne sait plus quoi dire mais qu'on cherche, cherche, cherche des choses à dire envers et contre tout). Comme se fait-il que le silence soit toujours une inter-ruption ? Et il y a cette brisure du silence, cette déchirure, cette fragmentation, dans l'ensemble de la pièce : les passages où Winnie alterne entre gestes et paroles, au point que son discours s'en trouve complètement saccadé, les didascalies qui marquent des temps de pause entre les paroles, comme pour laisser place à des intervalles de silence, le mutisme de Willie qui refuse de répondre à Winnie... Bref, on est face à un monologue, à une inflation du discours à partir de soi, mais ce discours est perpétuellement déstructuré, intérieurement cassé par des bris de silence : et au milieu de tout ça, persistent des débris de voix, mais qui ne veulent plus rien dire, sont impuissants à faire système, à s'organiser autour d'un centre, d'une fin, d'une origine, peu importe du moment que ça fonctionne comme principe. Et cette dissémination vocale, ces secousses sonores, ce sont de belles traductions, je trouve, de ce qui se passe quand on n'a "plus rien à dire", quand tout ce qu'il y a, c'est la douleur de la perte, perte inconsolable, irrattrapable, dont on n'a rien à dire faute de pouvoir s'en remettre. Parce que la perte est définitive, son sens est indéfini : parce que la perte est irréversible, elle est indicible -- impossible de lui donner quelque sens que ce soit. J'aime beaucoup, aussi, que la voix qui se brise, ce soit un échec soudain, une impuissance qui se trahit elle-même, comme si l'épuisement profond de cet être lâchait vraiment, l'espace d'un instant il se produit (aux deux sens d'une réalisation et d'une manifestation), mais très vite l'épuisement est recouvert, très vite Winnie s'agite de nouveau, fait surabonder de vaines potentialités pour cacher le plus intime impossible : l'impuissance à être, l'inaptitude à vivre. Il y a des existants qui ne savent pas exister : c'est leur profonde sagesse ! Ou alors c'est l'inverse : peut-être que c'est le silence qui est le fond le plus permanent, et que la parole est toujours un sursis, j'en sais rien.
Et j'aime aussi beaucoup ce couple tellement cliché, le mec un peu plus âgé que sa femme, lui qui lit le journal sans écouter ce que lui dit sa pipelette de femme, elle qui passe son temps à se maquiller et à parler comme la dernière des nunuches. C'est assez terriblement vrai cette banalité quotidienne, ces relations de merde entre gens qui n'ont rien à se dire, sont ensemble parce que voilà, il faut bien se trouver un partenaire dans sa vie sinon de quoi on a l'air, et en fait ce couple est un non-couple faute de dialogue authentique. Bizarre ces gens enfermés dans leur trou, complètement seuls, qui ne parlent qu'à eux-mêmes. Et il y a un certain usage de la "fictionnalité" (du fictif comme tel) dans cette pièce, je trouve : d'abord Winnie passe son temps à faire semblant de faire quelque chose, ensuite toute sa conduite est tendue vers le soin de son image (c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la semblance, à la sienne, à son apparence), et enfin elle dit tout le temps à Willie qu'elle s'en fiche qu'il l'écoute du moment qu'elle pense qu'il l'écoute peut-être. Par exemple : "simplement te savoir là à même de m'entendre même si en fait tu ne le fais pas c'est tout ce qu'il me faut". Faute d'un fond, faute d'un être consistant, ou fait semblant qu'il y ait quelque chose, la mise en scène remplace la réalité. Winnie est comme prise dans un constant mouvement d'auto-fiction, dans une recréation fictive de ce qui fait défaut dans le réel. Et peut-être que dans cette obsession du maquillage chez Winnie, il n'y a pas seulement l'envie d'être belle comme autrefois, mais plus largement l'envie d'être soi, d'être quelqu'un : peut-être qu'elle cherche juste à se recréer un ersatz de subjectivité, à se subjectiver tant bien que mal, là où sa vie à ce stade est surtout marquée par la perte de soi, là où son identité se conjugue surtout au passé. Je trouve ça drôle, aussi (même si pour le coup je pense vraiment que je sur-interprète mais peu importe), cette image de la recherche : Winnie passe son temps à "farfouiller" dans son sac. Parce que justement il n'y a rien à trouver, donc qu'est-ce qu'elle cherche ! L'absurde c'est quand il n'y a rien à aller chercher, donc à quoi bon ?
Enfin, je vois aussi dans cette pièce une thématique de la mort, plus largement de la temporalité de l'existence, succession d'habitudes répétées mécaniquement et en pure perte entre la naissance et la mort. Ce qui me frappe beaucoup personnellement, c'est la métaphore scénique de la naissance que je crois voir dans ce corps emprisonné dans un trou, au milieu de ce que Beckett lui-même appelle un "mamelon". Comme si le personnage de Winnie était enfermé dans le corps maternel, n'avait jamais été véritablement "mis au monde". Et si on veut bien suivre cette piste, je trouve intéressant l'itinéraire de Willie dans la pièce : d'abord allongé, puis retournant en rampant dans son trou. Une sorte de régression, de retour à l'état intra-utérin. On a un mouvement qui, soit piétine sur place (Winnie), soit retourne, happé, à la case départ (Willie). Dans l'obsession de Winnie pour le maquillage, je vois la même métaphore : une sorte de préparation incessante à une action qui n'arrive jamais, une manière de se tenir, débordant d'envie, au seuil d'une vie qui ne vient jamais, comme si Winnie courait après un état d'action, de vie, de fécondité, qu'elle n'atteindra pas. Winnie aura passé sa journée à se coiffer devant la glace, jusqu'à ce que la nuit arrive et sans que rien ne se soit produit qui vienne justifier ce moment de préparation : bref, la journée se termine avant même d'avoir commencé. Un peu comme la vie, finalement... Est-ce qu'on ne meurt pas toujours avant d'avoir pu naître ? Est-ce qu'on ne quitte pas la Terre avant d'avoir su l'habiter ? C'est triste tout ça. Et je le trouve très beau ce personnage de Winnie, touchant de naïveté, à se refuser (sans le vouloir) à la tristesse. Indolore douleur ! Douleur de l'indolore ! C'est vraiment elle qui donne à la pièce ce goût doux-amer tellement particulier. Non pas que son attitude recrée de l'espoir ou que sais-je, elle est complètement à côté de la plaque, mais voilà, c'est assez beau cette façon de s'émerveiller du vent, mais en toute sincérité sans doute, enfin peut-être pas, au fond elle sait bien, mais elle ne sait pas qu'elle sait, et cette équivoque d'un savoir qui s'ignore, d'une ignorance parfaitement sincère quoique tout à fait hypocrite, je trouve que c'est le sel de la pièce. Comme tous les moments où elle dit "ça que je trouve si merveilleux" à propos de choses parfaitement banales. En même temps c'est bizarre, c'est un personnage un peu désespérant, très étrange, je crois que Deleuze parle à son propos de la relation entre épuisement et fatigue. Et ce qui est drôle à mes yeux dans ce personnage, c'est ce néant qui attaque la racine même de l'existence, sans pour autant impliquer un évanouissement de toute activité. Ce que j'ai envie d'imaginer dans cette distinction fatigue/épuisement, c'est que l'épuisement atteint la racine, là où la fatigue touche les fruits : que l'épuisement concerne le fondement de l'action, là où la fatigue concerne ses résultats. Être fatigué, c'est être dans un état où nos possibilités sont suspendues momentanément, mais sans être anéanties comme possibilités : c'est ne pouvoir actualiser, mais pouvoir possibiliser. Dans la fatigue, il y a encore de la puissance, juste elle demeure inactuelle, est entravée dans sa réalisation. Dans l'épuisement c'est le contraire : on peut agir éventuellement, mais toutes nos conduites sont le reflet d'une impuissance qui nous frappe au plus intime de nous-mêmes. C'est drôle justement cette motricité de Winnie : elle peut bouger les bras (le haut du corps) mais pas les jambes (le bas du corps) -- autrement dit, il ne reste plus que des mouvements sur place, une mobilité qui ne meut rien, une mobilité impuissante à déplacer ce qu'elle meut. Un mouvement superficiel demeure, il persiste un mouvement du côté des résultats, mais le principe (les jambes !) est paralysé, l'origine est stérilisée, la création rendue impossible. Quand on y pense c'est sombre cette idée : il y a des cas où quoi qu'on fasse c'est foutu, vous pouvez faire ce que vous voulez, votre énergie est putréfiée de l'intérieur, complètement anéantie et toutes vos réactions au problème sont des expressions du problème. C'est le serpent qui se mord la queue. Et puis il y a cette lente détérioration du mouvement, l'inéluctable paralysie de Winnie, qui mord toujours plus de parties de son corps : au début "juste les jambes", puis aussi les bras, et elle fait comme si de rien n'était mais c'est foutu. C'est foutu ! Et puis ça parle aussi de la vieillesse, ce personnage qui regrette ses années de jeunesse où elle était belle, passe son temps à se faire belle alors que personne n'est plus là pour la regarder, surtout pas son époux qui est toujours derrière elle. Un temps qui nous fuit, qui imprime sa marque sur nous malgré nous : une temporalité subie, jamais agie. Impuissance à agir le temps ! Le temps nous échappe toujours car le passage du temps c'est l'échappement même ! Fuite de ce qui passe en tant qu'il passe -- passant, déjà passé ! Passéité du passage ! La vie est ailleurs, vraiment : tantôt derrière nous, tantôt devant nous, jamais là ici maintenant. Soit passée, soit future -- jamais présente.
J’ai aussi beaucoup aimé la petite pièce « Pas moi » qui suit Oh les beaux jours dans l’édition que j’ai achetée. En fait je ne suis pas sûr de très bien comprendre cette pièce mais ce qui me plaît c’est l’approche, les aposiopèses incessantes, on tourne autour du pot sans jamais atteindre le truc, l’événement, ce qui compte. Prolifération du Dire par impossibilité de dire… Parole impuissante à rejoindre son objet, détachement de la voix, qui ne vocalise plus rien que l’impuissance à dire. Et cette répétition, ce retour cyclique aux mêmes phrases ça me plaît bien : on n’accède jamais au truc (c’est ça que j’y vois en tout cas). On a l’impression qu’il s’est passé quelque chose de grave mais on ne l’atteint jamais. Donc dépersonnalisation, impossibilité de se rejoindre, séparation du corps et de la pensée. La voix, d’un côté, la silhouette de l’autre. Je parle de moi, mais « pas moi », ce n’est pas moi, je n’arrive pas à me reconnaître dans ce dont je parle faute de pouvoir y donner un sens. Et puis c’est sympa ce dispositif, j’aime beaucoup la continuité que Beckett donne au texte : la parole commence avant que les rideaux se lèvent et continue jusqu’à ce que la salle se rallume, dans un évanouissement progressif et imperceptible. J’aime bien le fait que la parole ne soit plus un segment mais une droite, un truc continu dont on chope des bribes mais pas l’entièreté, parce que ce n’est pas une rencontre, pas une interaction, on a juste un aperçu de ce que se dit la personne.