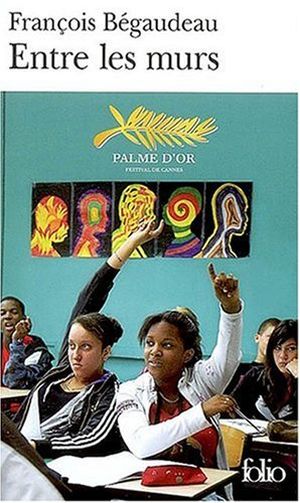L’intérêt principal que j’ai trouvé dans le livre, c’est sa disposition. Bégaudeau opte pour différents passages de vie d’un professeur de collège (qui s’avère être lui-même), sans véritable narration à proprement parler. À l’image des cinéastes naturalistes comme Pialat (que Bégaudeau affectionne tout particulièrement) ou Cantet (qui a réalisé Entre les murs, lauréat de la Palme d’or), il préfère sélectionner des fragments de vie pour faire triompher la forme sur le récit. Ainsi, il ne cherche pas à communiquer avec nous sur une base divertissante, mais directement à travers le langage du médium littéraire.
Nous comprenons ainsi bien mieux ce que l’auteur veut nous faire éprouver au travers de son œuvre que s’il avait établi une narration classique, avec des protagonistes identifiés et des informations destinées à la compréhension.Non, ici, ce sont des épisodes qui n’ont pas d’importance apparente, et cette trivialité générale est là, à mes yeux, pour montrer deux choses :
En premier lieu, Bégaudeau montre que l’histoire racontée n’est pas une histoire. Le médium littéraire en donne l’impression à cause de l’instrumentalisation qu’il a subie : on a souvent décrété qu’un roman devait « raconter une histoire », etc. Ainsi, pour le lecteur, il est déroutant (presque d’un point de vue sensoriel) de découvrir que le roman qu’il lit n’a rien de romanesque. Pire : qu’il constitue une tentative anti-romanesque. Car oui, le fait d’exhiber des moments triviaux dans le médium littéraire crée l’impression que le récit n’avance jamais. Par conséquent, Bégaudeau réussit parfaitement l’opération qu’il tente : dépeindre le réel. Le réel n’avance pas, il est banal, empirique, répétitif. Il est le train de vie d’un professeur trentenaire de la classe moyenne en France.
En second lieu, Bégaudeau démontre toute la subtilité qu’il met à faire de son œuvre une base de non-divertissement. Il choisit de laisser les événements et les situations traduire le réel, plutôt que d’imposer une narration qui, elle, risquerait d’être didactique ou artificielle. Ce récit non linéaire rend plus facile l’interaction du lecteur avec le texte : il nous oblige à réfléchir aux dynamiques à l’œuvre, car celles-ci ne sont jamais explicitement mises en jeu. Nous devons donc faire preuve d’exigence dans notre lecture, et la jouissance intellectuelle en est décuplée — la jouissance de comprendre, d’apercevoir les subtilités de l’œuvre.Par exemple, lorsqu’il lit les présentations des élèves sans contexte : on comprend d’où cela vient, mais rien n’est dit, car ce dernier s’appuie sur notre rationalité vis à vis de ce qu’on lit, qui elle même est bien articulée par notre raison, qui nous permet de tellement penser le texte.
Tout cela laisse présager une œuvre qui cherche à approcher le réel de manière absolue, et ce de façon particulièrement pertinente. Elle consiste à retraduire des événements triviaux pour en extraire des sensations universelles — celles du collège, en l’occurrence. Ces sensations sont d’une précision telle qu’elles traduisent plus que des situations : elles traduisent des sentiments, des essences d’individus, des conditionnements. Ces conditionnements, si précis qu’ils nous paraissent familiers, provoquent une identification immédiate. Et cette identification sert le ton que Bégaudeau veut édifier : le monotone, le banal, le pathétique…Toutes ces sensations que, je crois, nous avons tous vécues, mais dont nous ne pouvons jamais réellement nous souvenir. Bégaudeau, lui, y parvient — grâce à la littérature.
Comme je l’ai déjà dit, l’œuvre se caractérise par un rapport très littéral au réel. Il y a tout un ensemble d’éléments du quotidien qui ne sont pas perceptibles immédiatement lorsque nous vivons les situations. La littérature est un médium qui permet cela : rendre compte du réel en suspendant le flux des événements.
Bégaudeau s’en sert de manière très habile : en rapportant de simples dialogues, il édifie une thèse — que je vais clarifier — de manière tout à fait efficace. Tout en subtilité, il déroule sa vision critique de l’école, sans jamais en faire une thèse explicite. Le simple fait de rapporter des dialogues familiers, tirés de notre propre réel, permet d’abord de les admettre, puis de les disséquer dans un second temps grâce au caractère figé de la littérature. Ainsi, par ce procédé, Bégaudeau met en évidence le caractère oppressif des interactions au sein du collège et de l’école en général — interactions qui nous paraissent pourtant banales, triviales.Cette mise en avant du trivial est la meilleure occasion d’activer la raison du lecteur : il faut comprendre quel effet il cherche à produire. C’est là que réside la subtilité.Sur un plan plus sensoriel, les dialogues rapportés nous paraissent ignobles, malsains, dominateurs, mais en même temps réels — et donc dépourvus d’une emphase émotionnelle. Bégaudeau ne fait pas de chantage à l’émotion : il ne nous « met pas le couteau sous la gorge ». Ce dernier ne fait que transvaser des dialogues simples de hiérarchie prof-élève de la vie courante mais qui simplement en les écrivant et ainsi en les distanciant de contexte, les met d’autant plus en valeur et leur extrait une valeur assez dominatrice dans les relations.
Les dialogues sont également intéressants par leur construction souvent chaotique. Ce biais de représentation introduit une subtilité supplémentaire : celle de laisser le lecteur comprendre par lui-même qui parle. Mieux encore, en reproduisant le langage du réel, Bégaudeau parvient à en tendre l’implicite : il nous fait raisonner sur qui parle réellement, et pourquoi.De même, lorsqu’il intercale des actions ou des micro-événements au moment d’indiquer qui prend la parole, cela renforce l’impression de trivialité et limite le didactisme. Une action est énoncée sans nécessairement induire un dialogue :
« Jean-Philippe a souri depuis le coin salon. »« Tu sais ce que ça veut dire Hadia en arabe ? »
Enfin, en bon auteur marxiste, Bégaudeau intègre une dimension sociologique du réel. Mais il le fait toujours à sa manière, en rapportant simplement les faits, de manière à suggérer une émotion, sans l’imposer. Par exemple :
« Zineb, bandana rose en fichu, boucles d’oreilles en plastique de la même couleur. »Cela ne signifie rien en soi, mais le simple fait de le noter, trivialement, crée une envie de comprendre. Par la subtilité, Bégaudeau nous pousse à raisonner et à saisir que l’école est aussi un objet d’étude des classes sociales. Pourtant, il prend soin de ne pas surligner le propos par des formules trop explicites, comme :« Pantalon troué, de seconde main »,qui rendraient la lecture trop évidente, voire grossière.
Mon exemple préféré reste la répétition constante de :« Mohamed Ali… Teddy 89 Playground. » à la fin de plusieurs phrases. Ce qui, au début, paraît anodin — voire humoristique — finit par interpeller le lecteur. Encore une fois, Bégaudeau montre que le professeur-narrateur fait une fixette sur ce que représentent socialement les individus qui composent son monde.Dans une existence empirique, cette obsession n’aurait aucun impact : elle ne traverserait même pas l’esprit du protagoniste. Mais Bégaudeau comprend que, placée dans un roman, cette observation acquiert un recul, une valeur sociologique — sans jamais être affirmée explicitement. Et c’est précisément là le rôle de l’art.
En somme, Entre les murs se présente comme une œuvre littéraire qui interroge le réel plutôt qu’elle ne le raconte. Par la fragmentation, la trivialité et la précision du langage, Bégaudeau transforme le quotidien le plus ordinaire en matière de réflexion esthétique et sociologique. Loin du divertissement, il fait de la littérature un espace d’observation, où le banal devient révélateur et où la parole, même chaotique, rend compte des tensions invisibles du monde scolaire. Ainsi, son roman accomplit pleinement ce que le médium littéraire peut offrir de plus exigeant : une expérience du réel débarrassée de l’artifice narratif.