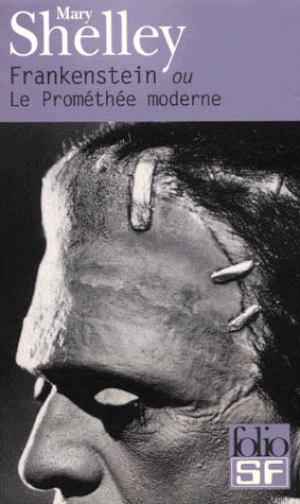Publié en 1818, au lendemain de la mode des premières oeuvres gothiques d’Horace Walpole (Le Château d’Otrante), d’Ann Radcliffe (Les Mystères d’Udolphe) et de Matthew Gregory Lewis (Le Moine), Frankenstein ou le Prométhée moderne est aujourd’hui plus qu’un roman. Pour chacun de nous, que nous en connaissions l’histoire ou pas, son titre évoque monstre et savant fou. D’ailleurs l’amalgame entre le créateur nommé et la créature sans nom a toujours cours. Tout cela a été amplifié par les deux adaptations Universal de James Whale dans les années 30.
Mais le roman de Mary Shelley est bien plus que ça. Ce n’est pas la simple histoire d’un jeune scientifique exalté et d’un monstre au front haut et au cou traversé de deux boulons, qui parle à peine et qui se déplace lourdement comme un zombie ridicule. Ni même d’une ressuscitée à la coupe de cheveux délirante.
Frankenstein ou le Prométhée moderne, c’est le sommet de la littérature gothique, imaginé et écrit par une jeune écrivaine alors en proie à la dépression et au deuil maternel.
Est-il besoin de rappeler la célèbre anecdote de cette nuit de juin 1816 où l’histoire prit forme dans l’esprit de l’auteure ? Alors en vacances à la villa Diodati louée par leur ami le poète Lord Byron sur les bords du lac Léman en Suisse, le couple Percy Shelley et Mary Godwin Shelley ainsi que John Polidori, un étudiant et ami de Byron, eurent la désagréable surprise de voir leur été gâché par des pluies incessantes (l’année 1816 est ainsi connue comme "l’année sans été"). Un soir, alors qu’ils discutaient dans le salon de Byron, ce dernier lança l’idée de réfléchir et d’inventer chacun une histoire fantastique et terrifiante. C’est au cours de cette nuit-là qu’est née l’idée du vampire aristocratique imaginé par Byron puis repris par Polidori dans sa nouvelle Le Vampire (Bram Stoker s’inspirerait largement de son Lord Ruthwen 80 ans plus tard pour imaginer le Comte Dracula). Jusque-là, le vampire était une figure folklorique associée à la sauvagerie et la bestialité. L’idée d’un aristocrate érudit, évoluant dans la haute société tout en semant les victimes exsangues derrière lui était alors inédite.
C’est aussi au cours de cette nuit-là que l’idée germa dans l’esprit de Mary Shelley d’inventer une histoire autour d’un homme qui réanimait un corps mort. Une vague silhouette issue d’un de ses cauchemars, confia-t-elle plus tard. Possiblement, une projection du deuil de sa fille. Bref, cette nuit-là, Mary Shelley jeta sur quelques pages les bases d’une intrigue qui deviendrait non seulement son roman le plus connu, mais aussi un mythe littéraire à travers le temps et aussi, au passage, le tout premier roman véritable de science-fiction.
On connait l’histoire, cent fois adaptée, racontée et "modifiée" à travers les décennies. Un jeune étudiant en science et en anatomie humaine, Victor Frankenstein, obnubilé par l’idée de "vaincre la mort" en ressuscitant les défunts via l’énergie électrique, élabore dans le plus grand secret un projet contre-nature, modèle un corps à partir de plusieurs morceaux de cadavres, et parvient à lui donner vie un soir d’orage. Mais soudain, épouvanté par la vision de ce corps géant et monstrueux se mouvant dans l’ombre en geignant sans pouvoir s’exprimer, Victor prend la fuite et abandonne purement et simplement sa créature dans un monde qui lui est totalement inconnu.
Des mois passent. Victor est rentré en Suisse pour vivre dans le domaine familial et s’apprête à se marier avec Elizabeth, sa soeur adoptive et son amour de jeunesse. Mais le mystérieux assassinat de son petit frère William endeuille sa famille. Bientôt, il revoit venir vers lui la créature qu’il a autrefois abandonné. Ayant appris à parler, celle-ci lui ordonne de la rejoindre, seul, dans les hauteurs de Chamonix durant la nuit. Là, créateur et créature se font face. Un petit Prométhée moderne s’étant pris un instant pour Dieu... et le monstre surhumain, le dépassant en taille et en intelligence, qu’il a créé. Celui-ci livre alors à son créateur son histoire, de son abandon le soir de sa "naissance", à leurs retrouvailles.
Loin d’être un pavé à la prose surannée, Frankenstein se présente comme un long récit épistolaire, toujours aussi passionnant à lire. Il s’agit en fait de trois récits enchassés l’un dans l’autre : celui du capitaine Robert Walton qui, voyant son navire coincé dans les glaces de la banquise, raconte l’étrange passager qu’il a secouru, celui de ce passager, Victor Frankenstein, et celui du monstre que Victor retrouva dans la montagne et qui lui raconta le calvaire qu’il a vécu à errer dans ce monde, sans guide, sans repère, sans savoir où il était ni qui il était, chassé par les humains à cause de son aspect monstrueux mais ayant aussi pu s’instruire, apprendre à lire, à parler, juste en observant, en écoutant et en lisant le journal de son créateur. Dotée d’une intelligence hors du commun, la créature de Frankenstein s’est faite toute seule, a appris par elle-même, et, révoltée par les notes de Victor qu’elle a lu dans son journal, a très vite développé une haine viscérale pour celui qui l’a créé sans pouvoir en assumer ensuite la responsabilité.
Le récit du monstre achevé, Victor Frankenstein prend à nouveau la parole, narrant la suite d’une confrontation qui s’acheminera vers le pôle Nord et se concluera avec le récit du Capitaine Walton.
Frankenstein, c’est donc l’histoire non pas d’un savant fou mais d’un scientifique maudit, se dérobant à ses responsabilités puis se retrouvant contraint d’y faire face. C’est aussi l’histoire d’un être sans racines et sans nom, absolument seul, et qui ne cherche qu’une chose : être aimé par un être semblable à lui, qui saurait l’accepter pour ce qu’il est et le comprendre. Pour ne plus être la seule anomalie de l’espèce humaine, pour ne plus se sentir abandonné et esseulé. Ni bon, ni mauvais, le monstre de Frankenstein éprouve simplement des sentiments bien humains : la peur, la tristesse, l’égarement, la solitude, le besoin de reconnaissance, d’aimer et d’être aimé, mais aussi la colère, la haine, la soif de vengeance suite aux tourments qu’il a enduré. Venu au monde alors qu’il n’avait rien demandé. Abandonné alors qu’il n’avait rien fait. Rejetté par une humanité qui l’abhorre et le craint pour son apparence. Le courroux du "monstre" sera d’autant plus terrible quand son créateur, conscient du péril qu’encourt l’humanité par sa faute, se refusera d’accéder à sa seule et unique requête. Et le cycle de la vengeance étant ce qu’il est, qui du créateur ou de la créature sera là, à la fin de l’histoire, pour pleurer l’autre ?
Avec Frankenstein, Mary Shelley se faisait non seulement prêtresse du romantisme noir mais aussi philosophe, questionnait les notions d’humanité, de responsabilité, d’intégrité et d’empathie. Elle se faisait l’écho de la désespérance de l’être dénué d’amour. Surtout, elle abolissait les barrières de créateur et de créature, condamnait l’hubris humain par la création de sa plus formidable nemesis. Bref, elle se projettait déjà loin vers une science sans conscience dont on pourrait encore, par la métaphore, tirer les leçons aujourd’hui. Les cheveux longs, la peau jaune laissant transparaître les muscles, d’une stature indépassable, insensible au froid, dôté d’une force surhumaine et d’une intelligence surpassant celle de son "père", la créature est le châtiment infligé à un lâche qui a subitement réalisé le pêché qu’il commettait, l’affront qu’il faisait à la nature, l’immoralité de son oeuvre. À travers lui, Shelley parvenait peut-être à faire le deuil de son défunt enfant, acceptant la mort comme une chose inévitable contrairement à son personnage-titre, révolté par la finitude humaine, et dont elle condamne l’ambition et plaint la destinée.
Nombreuses sont les adaptations et les variations qui ont été faites de ce classique littéraire éternel. Hormis les deux antiques films cultes de James Whale, Kenneth Branagh eut l’ambition en 1995, de porter (un peu) plus fidèlement le roman de Shelley à l’écran. Sans parler des quelques libertés de son scénario (la résurrection d’Elizabeth, le destin de Clerval laissé en suspens, la créature plus inquiétante mais toujours peu ressemblante à celle, impressionnante, imaginée par Shelley), le film de Branagh pâtissait d’une mise en scène lourde et outrancière, qui ne retrouvait en rien le grandiose d’un Coppola adaptant Dracula.
Sans parler d’adaptations officielles, une grande partie du cinéma de science-fiction paye depuis toujours son tribut à l’imagination de Mary Shelley. Les histoires de monstres et de créateurs perdant le contrôle sur leurs créatures sont aujourd’hui légion : Metropolis, Blade Runner, Robocop, Frankenweenie, Edward aux mains d’argent, Re-animator (adapté de Lovecraft), Universal soldier, Mimic, Jurassic Park/World, Alien Resurrection, Prometheus, Alien Covenant, V pour vendetta, Criminal, Upgrade, les mangas Gunnm et Pluto, le jeu vidéo Bioshock 2 (entre autres)... Même le film dramatique Ni dieux, ni démons en était une sorte de variation.
Au final, une des plus belles versions de l’oeuvre de Shelley reste celle illustrée par Bernie Wrightson, sublimée par des dessins confinant au génie pictural. Après la modernisation de Bernard Rose et la version de la série Penny Dreadful, c’est désormais Guillermo Del Toro qui relève le défi de transposer à l’écran toute la splendeur funèbre du chef d’oeuvre de Mary Shelley à travers sa propre identité de cinéaste. Lui qui a toujours aimé les monstres, il était logique qu’il en vienne un jour à magnifier le plus emblématique de tous, celui par qui toute l’histoire de la science-fiction et de l’horreur a vraiment débuté. Celui qui reste l’éternel marginal, hantant les terres lointaines et glacées, arpentant les confins d’un monde dont il ne fera jamais partie. Car condamné à la solitude par un père qui, dans son inconséquence, ne lui aura jamais donné de nom.