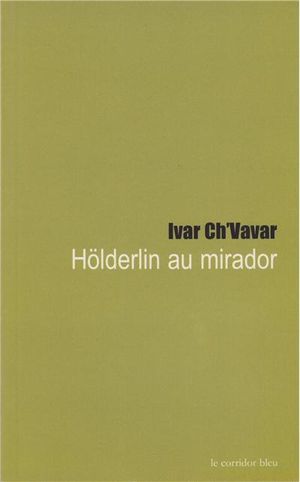On considère parfois qu'on peut déterminer si un livre est devenu un "classique" au bout d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on peut sans doute considérer "Hölderlin au mirador" comme un classique dans la poésie contemporaine. J’entre dans l’œuvre d’Ivar Ch’Vavar à petits pas, car elle est entourée d’une certaine aura : les deux auteurs par lesquels je suis entré dans la poésie contemporaine de langue française, à savoir Yves di Manno et Pierre Vinclair, ont écrit sur cette œuvre pour la porter aux nues. Aussi l’exercice interprétatif voit-il ses enjeux changés : il ne s’agit plus d’entrer dans un massif inconnu et de défricher, mais dans d’aller dans une constellation bien identifiée, sur laquelle il va s’agir de ne pas raconter n’importe quoi, alors que le livre a déjà sa postérité et ses interprètes.
La quatrième de couverture indique ce qui a frappé dans l’ouvrage. Le titre, d’abord, est formidable. Comme il est affirmé qu’il n’a pas de signification, je n’étalerai pas ici toutes les impressions qu’il provoque chez moi, et qui sont nombreuses. Oralité, dimension collective, vers arithmonyme (tous les vers contiennent onze mots) ; un prologue suivi de vingt-sept chants ; refus des convenances ; voilà pour la présentation générale.
Nous avons tous, enfoui quelque part au fond de la mémoire, le souvenir des obscénités que nous proférions avec nos potes de collège ou de lycée. Parfois, on l’oublie ; la plupart des adultes font au moins semblant. De mon côté, oublier est impossible, déjà parce qu’il y a bon nombre de souvenirs amusants là-dedans, mais aussi parce que je travaille en collège : aussi, dès que je jette une oreille dans un couloir, le nombre d’obscénités que j’entends frise le démentiel. De cette matière-là, qu’on pourrait juger « antipoétique », Ivar Ch’Vavar compose ses chants. Il y a bien sûr un effet de gageure : intégrer la vie obscène au sein du poème. L’auteur répond à cette gageure par l’absence complète de pudeur ou de jugement de valeur : les paroles sont là, c’est tout. Elles n’ont ni à se justifier, ni à être surmontées de quoi que ce soit. Elles sont projetées ici, débrouillez-vous avec. Si on devait faire une histoire de la littérature cherchant à rompre les règles de bienséance, Hölderlin au mirador tient une place singulière : là où Flaubert, Zola, Proust ou Nabokov habillaient la sexualité d’un style léché qui frappait par sa distance avec l’élément montré, où Sade enrobait le tout de prétentions philosophiques, où Lautréamont travaillait parodiquement, Ch’Vavar profère, laisse couler, ou du moins fait bien semblant.
Je dis « fait semblant », parce qu’il faut à ce moment de la réflexion justifier les raisons qui en font une œuvre d’importance. Le dispositif poétique, l’attitude et la gageure obscène n’y suffiraient pas. Le travail se fait en profondeur. Des éléments de poétique plus classiques, ou des références culturels, sont présents, mais souterrainement, parfois on laisse passer le vers sans les remarquer. Les amateurs de figure de style seront comblés, mais ils devront néanmoins les chercher : ce n’est pas la métaphore filée des romantiques, mais telle ou telle personnification ou paronomase ou que sais-je encore qui surgit au détour, sans jamais être clinquante. C’est la musique qui accompagne l’ensemble ; presque chaque chant mentionne un album, souvent de musique ancienne. La syntaxe se défait à la marge ; pas trop, ce n’est jamais lourd, ça apparaît comme ça, crée un effet poétique là où il y en a besoin.
Il y a dans ce livre une forme de générosité, car plusieurs poèmes proposent des scènes vives (oui, l’occasion rêvée de replacer le mot d’hypotypose). On revient sur un sol qu’on croit solide, mais c’est le sol humide de la Picardie, la nuit est tombée, la bande de potes est indistincte, les mecs errent sans savoir quoi faire de leurs érections, tandis que les filles les regardent avec ironie. Tout d’un coup tout passe très vite, on a l’impression d’une course, puis c’est un dialogue, ou un type fait une connerie, ou alors une méditation sous le ciel étoilé. Il y a ce plaisir fondamentale anticlassique : à chaque vers, on ne peut pas imaginer ce que va donner le suivant. [Paul Valéry définit quelque part le plaisir classique comme le fait de voir le mot attendu arriver parfaitement au moment attendu.]
« Je n’arrive plus à sentir la terre bien sous moi.
Je me sens de biais par rapport aux lignes de perspective
représentées par les sillons de ce champ, dont je suis censé
tenir les corneilles éloignées (?) -en me, m’agitant, en frappant dans
mes mains -mais dès que je m’agite ou claque dans
mes mains – c’est pire, je perds / l’équilibre, du moins
est-ce comme si, je perdais l’équilibre (en fait il
s’avère que je reste assez confortablement, solidement assis même aux
moments où je crois / le plus, que je vais tourner-bouler). Le
champ lui-même est comme une bosse, et automatiquement les sillons
dévient et subissent une torsion. Le cri des corbeaux est tordu
aussi et va en tire-bouchon ; sans compter cette sorte d’écho
larvaire qui raccourt en arc de cercle des franges tourdilles de
l’horizon ; raccourt avec de l’effet, de la dérive. -Avec
ça le soleil qui n’ondoie pas qu’un peu me
palpe vigoureusement le foie : « ALERTE : je vais dégobiller ! » que je m’
entends crier tout en sachant que je ne m’entends pas
vraiment, crié n’ai pas, et rien personne entendu n’a – »
Ce passage peut raconter une histoire simple : une bande de potes fume un joint, le narrateur raconte ses pensées avant de gerber. Pourtant les mentions de la terre, de la perspective et des sillons, remettent la scène dans le jeu d’un rapport au monde plus profond ; la présence des corbeaux rappelle un certain nombre de topoï poétiques, bien qu’à distance. (Juste avant cette scène, avant de fumer un joint, la bande de potes est en train de lire à haute voix des poèmes de Verlaine.) La rupture de syntaxe, dans les vers consacrés aux mains, épouse la rupture d’équilibre. Le vers tourneboule comme l’instance lyrique. Difficile de ne pas voir, dans les échos, les arcs, la dérive, les sillons, quelque chose de métapoétique ; et pourtant cela reste une scène entièrement familière. L’alerte en majuscule nous ramène au réel, à la dimension malséante : le vomi va sortir. La conclusion est paradoxale : il n’y a eu ni vomi, ni parole, personne n’a crié ni entendu, d’ailleurs la syntaxe est là aussi déconstruite et épouse l’échec de la transmission. C’est le paradoxe qui est laissé au lecteur : ai-je lu une scène sur une bande d’ados qui fumait un joint ? Un apologue en forme d’art poétique ? Une blague pour intellos, le genre de celles qu’on fait entre anciens lycéens qui fumaient des joints en lisant du Verlaine et font désormais, dans leurs poèmes et leurs critiques, semblant d’être des gens sérieux ? Tout cela, et évidemment plus.
Aussi les tenants du lyrisme à la papa et les intellectualisants seront-ils laissés au seuil ou bousculés, comme l’amateur de Pink Floyd se retrouvant au-milieu d’une foule qui scande « Bande organisée ». Ils nous laisseront entre nous et se retrouveront dans la position de Carlo le Calamar regardant par la fenêtre Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer s’amuser dans les champs. Ou alors, hypothèse plus heureuse : chacun comprendra qu’on peut aimer le lyrisme à la papa et l’intellectualisme et Pink Floyd et la musique pop récente et la poésie classique et la poésie contemporaine et que, pour faire une œuvre intéressante, il est bon de mélanger tout cela, -en s’amusant, c’est-à-dire en accomplissant l’action la plus sérieuse qui soit.