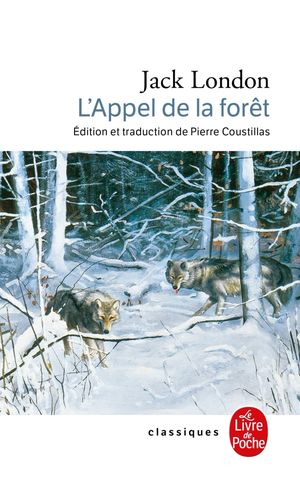Parmi la tonne de trucs à lire qui m'intéressent, il fallait que ça tombe sur Jack London — ça risque bien de prendre du temps car j'ai deux Pléiades à compulser.
Pour le profane que j'étais, London était une sorte de Saint-Exupéry bis., un auteur à ranger dans la catégorie des « auteurs pour enfants » (c'était dire mon niveau)… sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Cette réputation que peut avoir London provient en partie des premières traductions du livre dont il est question ici, de la part de la comtesse de Galard, puis des romans illustrés, ceux-ci ayant été raccourcis, édulcorés, afin de plaire aux plus jeunes lecteurs, mais aussi de ses premières adaptations, toutes aussi édulcorées afin de plaire à un public plus jeune. Car sans être un bouquin déprimant, le livre dont l'adaptation française nous a donné un titre différent plus de fois que New York a changé de nom est loin d'être dénué de toute violence.
Revendu par l'aide-jardinier d'une grande maison suite à une grosse perte à la loterie chinoise, Buck sera très vite conduit de force au Grand Nord afin d'être exploité comme chien d'attelage, tout en passant d'un bourreau à un autre durant son trajet. Le monde qu'il apprendra à connaître lui présentera des chiens qui s'entretuent, sombrent dans la folie, ou sont abattus suite à « l'orgueil de la piste », « cet orgueil qui fait aller les chiens jusqu'au bout de la souffrance ». Un monde où l'anomie, la loi du plus fort règne.
Il fallait être vainqueur ou vaincu : faire preuve de miséricorde était un signe de faiblesse. La pitié n'existait pas dans la vie primitive. Elle était prise pour de la peur, et une telle méprise impliquait la mort. Tuer ou être tué, manger ou être mangé, telle était la loi ; et à ce commandement, venu du fond des Temps, il obéissait.
La manière d'écrire de London, son côté « cynique », cette volonté de ne pas revenir en arrière, se fera sentir dans cet Appel du monde sauvage, avec des éléments présentés à la toute dernière minute (ici, Tchekhov peut aller se faire foutre avec son fusil), et autres revirements. En effet, tout juste après avoir pris la place de l'ancien chien-chef par la force, en éliminant ce dernier, le récit, qui n'en est pas encore à sa moitié, partira dans une toute autre direction, trahissant une certaine absence de plan (et non d'intention) de la part de son auteur. Changeant de mains, passant d'un propriétaire à un autre, du chapitre (IV) au suivant (V), Buck se rendra très vite compte que la seule finalité le concernant, du moins s'il continue comme ça, sera celle qu'emprunta Dave, chien de barre stakhanoviste, doté de cette « orgueil » comme déjà évoqué plus haut, qui obligera l'un de ses propriétaires à le fusiller pour abréger ses souffrances. Allant de mal en pis, de ce qui s'apparente à une digression à une autre, les derniers propriétaires du traineau auraient de quoi prêter à rire si leur incompétence ne conduisait pas, petit à petit, à la mort de l'entièreté de l'équipage. C'est ici que le roman prendra encore une nouvelle, et dernière, direction. Sauvé in extremis par John Thornton, c'est auprès de ce dernier que Buck connaîtra l'amour « authentique et passionné » pour la première fois, ce qui le poussera à mettre sa vie en danger plus d'une fois afin de venir en aide à son maître. Un Buck qui devra toutefois choisir entre son nouveau maître et cet appel, l'appel du monde sauvage, qui l'attirera de plus en plus. Un choix qui se fera à l'insu de son plein gré, le groupe de Thornton s'étant fait éliminer lors d'une incursion de Buck vers ce monde sauvage.
Ces ombres lui adressaient des signes si péremptoires que, chaque jour, l'humanité et ses exigences disparaissaient toujours un peu plus à ses yeux. Au plus profond du monde sauvage retentissait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait, plein d'un palpitant mystère qui l'attirait, il se sentait obligé de se détourner du foyer et de la terre battue alentour pour s'enfoncer dans la forêt et galoper, galoper, sans savoir ni où ni pourquoi ; il ne se posait pas ces questions, l'appel résonnait impérieux au cœur de cette nature sauvage.
Débuté comme une nouvelle fin 1902, pourchassant le format qu'avait suivi London jusque-là et qui ne lui avait pas réussi (en particulier la nouvelle Bâtard), L'Appel du monde sauvage passera de 4 000 à 32 000 mots en l'espace d'un mois, soulignant la cadence de l'écrivain. En résulte un format hybride, une sorte de nouvelle très longue ou de court roman, où se mêlent philosophie, lyrisme, réalité et fiction, et plus si affinités. Les trois premiers chapitres ne sont pas écrits de la même manière que les autres, l'auteur semblant avoir pris conscience de la toute autre portée de son roman.
Il y a une sorte d'ambivalence teintée de fatalisme dans Call of the Wild, une certaine ironie, comme si un rien ne tenait entre le choix et le non-choix, entre la réussite et l'échec. Parti dans le Klondike pour y trouver de l'or, London reviendra de là avec des projets d'écritures. Des projets, ou plutôt un projet, qui, s'il lui permettra d'entrer dans la légende, tout comme Buck rentre dans la légende indienne, ne lui permettra toujours pas de repartir avec l'or tant convoité. En effet, pour ce Call of the Wild qui deviendra et restera son ouvrage le plus tiré, London signa sans nul doute le contrat le plus catastrophique de toute sa carrière, cédant l'intégralité des droits de l'œuvre contre seulement 2000 $. Impossible de ne pas dresser un parallèle entre le personnage principal et l'écrivain, Buck abandonnant le corps sans vie de son maître, mort littéralement près d'une mine d'or, tout comme London dut passer (temporairement du moins) à côté d'une mine d'or pour connaître le succès qu'on lui connait.
Buck fait son entrée dans la légende noire des Indiens Yeehats (une tribu fictive), tout comme London fera son entrée dans la légende littéraire. Quoiqu'encore à ce niveau-là, on retrouve encore une certaine ambivalence : il manque quelque chose à Buck tout comme quelque chose de l'ordre d'une maîtrise de l'écriture paraît « échapper » à London selon ses propres dires, considérant son œuvre comme « une histoire tout à fait fortuite, un coup tiré à l'aveuglette et qui, par chance, a mis en plein dans le mille ». De nombreuses analogies sont possibles entre la neige et la page blanche, entre Buck qui suit cet énigmatique, et pourtant captivant, appel sauvage, et l'auteur qui, tout comme son personnage semble être guidé par un bien curieux hasard.
À bien des égards, Buck suit le monomythe, le voyage du héros de Joseph Campbell, mais ce de manière désordonnée : de la sortie du monde ordinaire à la présence d'un guide, du combat contre la mort à l'entrée dans un monde extraordinaire. Une étape manque toutefois, l'ultime étape, le retour dans le monde ordinaire. Ici, l'accomplissement du protagoniste s'effectue par le retour à l'état sauvage. En retour à un état sauvage qui ne peut s'accomplir qu'en prenant « exemple » sur l'homme, en tuant un semblable. Que ce soit pour son auteur ou le protagoniste, il manque encore une étape avant d'atteindre cette complétude tant souhaitée.
Le pays du soleil se perdait dans le lointain, et de tels souvenirs n'exerçaient aucun pouvoir sur lui. Bien plus puissants étaient ceux hérités de ses aïeux, qui donnaient une apparence familière à des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant ; et aussi les instincts (simples souvenirs ancestraux transformés en habitudes) qui, après s'être émoussés au cours des époques précédentes, venaient de se réveiller en lui.
Roman prônant le retour aux origines avec pour thématique centrale l'atavisme, L'Appel du monde sauvage n'a donc que peu à voir avec les autres histoires d'animaux. Même Croc-Blanc, pourtant rédigé par le même auteur, prendra une direction diamétralement différente, mais pas sans lien avec L'Appel, entre la réutilisation d'une appellation souhaitée par London, « Le Loup qui dort », comme titre du tout dernier chapitre, ainsi qu'un passage dans la vallée de Santa Clara, lieu où débute le livre dont il est question ici et où se conclura Croc-Blanc.
Ainsi, si London appuie tant sur le confort de la civilisation, toutefois présenté comme une sorte de paradis pour son protagoniste lors des toutes premières pages du livre, ce n'est que pour appuyer davantage sur son artificialité par la suite, pour encenser le retour à l'état primitif, la décivilisation et la compétition, après avoir fait gouter à Buck la dure loi des crocs et des gourdins. Les allers-retours sur la piste peuvent se lire comme des traces de l'hésitation de Buck, comme une marque de la contradiction de London qui ne sait lui-même pas où conduire son récit : la page blanche encore une fois. Buck abandonnera donc l'humain lors des toutes dernières pages, le langage, pour laisser place au « chant de la horde », à l'ultime régression vers les origines, vers cet inconscient collectif jungien, loin d'être dénué de sens pour le monde sauvage.
On pourrait comparer Buck à l'humain, dresser de nombreux parallèles entre son asservissement, son exploitation, et ceux que subissent de nombreux autres êtres humains que London ne s'épargnera pas de dénoncer par la suite. Mais plus que de le comparer à son créateur, encore plus que d'assimiler Buck et l'humain, ce serait oublier l'animal derrière, sa nature, son incapacité à se fondre dans un monde rempli d'humains. Buck a beau être un chien prodigieux sur bien des aspects, doté d'une force et d'une intelligence hors norme pour un canidé, il reste un animal tout juste capable de comprendre l'humain, qui ne peut véritablement dialoguer avec lui. Ce ne sont pas ses mots que London nous transmet, comme on pourrait le lire dans de nombreux autres romans avec des animaux plus ou moins anthropomorphisés, mais ses émotions. En concluant son roman sur cet appel, sur le retour à cette animalité la plus primaire, London ne fait que rappeler la place échue à son personnage principal.
À ce sujet, je suis persuadé qu'une œuvre n'appartient jamais totalement à son auteur, ne serait-ce que pour la part interprétative que lui prêteront certains lecteurs. Ceci dit, je ne peux m'empêcher de partager un passage d'un court article que London publia plus de 5 ans après Call of the Wild, intitulé « The Other Animals », et revenant sur l'humanisation de l'animal :
Je suis coupable d’avoir publié deux histoires de bêtes, deux livres sur les chiens. En réalité ces deux romans étaient une protestation contre le procédé qui consiste à humaniser les animaux et dont il me semblait que certains écrivains avaient trop abusé. À maintes reprises j’ai écrit à propos de mes héros-chiens. « Ils ne réfléchissent pas à leurs actes, ils se bornent à les exécuter etc. » J’ai employé souvent cette phrase, ce qui retardait l’action et contrariait mes règles artistiques : je le faisais pour mieux faire comprendre à mes lecteurs que mes personnages n’étaient pas dirigés par des raisonnements abstraits mais par l’instinct, la sensation, l’émotion et le raisonnement simple. De plus, je m’efforçais d’accorder mes écrits avec les principes de l’évolution et en conformité avec les données scientifiques. Et un beau jour je me vis classé parmi les maquilleurs de la nature.
J'ai eu beau qualifier London d'auteur « cynique », reste qu'il faut quand même être sacrément talentueux pour produire un tel ouvrage, pour se tenir à cette méthode de travail qui l'oblige à respecter ce qu'il a écrit, assumer ses choix, abandonner certains personnages aussi vite que le lecteur les a rencontrés. Certes, cette méthode nuit objectivement au roman lors de plusieurs passages bien précis, principalement au chapitre IV où l'attelage est revendu à un « sang-mêlé, indien et écossais », avant d'être revendu une nouvelle fois durant les premières pages du chapitre suivant. Quelques pages « de trop » durant lesquelles les rares événements impactant (la mort de Dave) auraient pu être retranscrits avant.
Aussi, on sent que London connaît bien ses lieux. Les descriptions sont détaillées, la topographie relativement précise (malgré quelques errements). Ce qui confère à ce Call of the Wild, en sus du roman pastoral, des envolées lyriques et des retombées philosophiques, un certain aspect semi-autobiographique.
Il est une extase qui marque le point culminant de l'existence, que celle-ci ne peut dépasser. Or, voici, le paradoxe : cette extase survient lorsqu'on a la sensation de vivre le plus pleinement possible, et qu'on oublie en même temps que l'on est en vie.
Difficile de dire ce qu'est exactement Call of the Wild. C’est un roman qui avance comme Buck : par contraintes, à-coups, instincts, revirements, éclairs de lucidité. On peut pointer ses maladresses, ses brusques bifurcations, son architecture brinquebalante ; pourtant, cette manière de se chercher et de se heurter à ses propres limites fait corps avec ce qu’il raconte. Buck répond à l’appel du sauvage ; London, lui, répond à l’appel de l’écriture. Les deux n’aboutissent pas au même endroit, mais tous deux vont là où ils sont destinés à être.