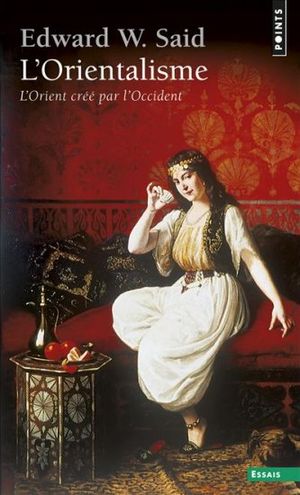Difficile exercice que d'écrire une critique sur un livre qui a eu une telle descendance. Saïd, c'est comme Frantz Fanon. Un penseur dont il faut garder la pensée dans toute sa nuance. Au sujet duquel j'ai tout de même quelque réserve.
Rédigé pour la première fois en 1978, l'essai compte une postface de 1994 intéressante, car elle revient sur l'impact qu'a eu l'ouvrage et les critiques qui ont pu lui être faites. Il y a également une préface de 2003 qui est marquée par l'actualité des doubles invasions de l'Afghanistan et de l'Irak.
Edouard Saïd est un élève de Foucault, et ça se sent. Il aime en reprendre les concepts, et pardon de le dire, mais parfois cet attachement au mot, à la définition, est un peu une pose. Avec toujours cette suspicion : cet apparat théorique ne sert-il pas à étayer un présupposé ?
Heureusement non. Car globalement la thèse de l'ouvrage est simple. Je m'excuse par avance, je rédige cette critique trois semaines après avoir fini l'ouvrage, ce sera donc fait de mémoire, mais pour résumer : l'orientalisme est un domaine d'étude créé par l'Occident pour objectifier les populations orientales. Il a pris diverses formes à travers le temps mais véhicule toujours le même bingo de stéréotypes dans lesquelles les diverses populations concernées se débattent. L'auteur a restreint son corpus aux XIXe-XXe siècles, et à l'espace géographique du Moyen-Orient, avec tout de même quelques incursions plus à l'est à titre de comparaison. il se concentre sur l'orientalisme français et anglo-saxon. Il délaisse l'orientalisme dans l'art pour se centrer sur les études archéologiques, philologiques etc.. liées à "L'Orient".
Soyez prévenu que certaines idoles tomberont, de Renan à T. E. Lawrence. Nerval et Flaubert sont quelque peu épargnés.
Le plan de l'ouvrage est globalement chronologique, même s'il n'en donne pas l'impression. Le premier orientalisme cherche en Orient la trace des extraits de la Bible. Il progresse d'abord par le biais de la philologie. Saïd part de l'ouvrage fondateur qu'est La description de l'Egypte pour aller jusqu'à Renan. Son ouvrage est une suite de monographies sur une série d'érudits et la manière dont, tels des entomologistes, ils mettent l'Orient dans des cases. Puis vient l'impérialisme de la fin du XIXe, avec le rôle des géographes, ethnologues etc... Plus loin, un chapitre décrit la crise de l'orientalisme et comment ce discours de pouvoir sur l'Orient s'est adapté face aux mouvements d'émancipation à partir des années 1930.
Ce qui est certain, c'est que vous ne lirez plus un livre sur "L'Orient" avec la même innocence, tant vous y rechercherez des traces de présupposé orientaliste. Et ce sont un peu toujours les mêmes : l'idée d'une grandeur passée de l'Orient, qu'évidemment seul l'orientaliste peut comprendre car il a étudié les textes avant de visiter. Cet Orient auquel on attribue une richesse spirituelle mystérieuse, qui est en général le portrait en négatif de l'Occident. Et ce discours dénigrant sur les populations, qui seraient inconscientes de cet héritage (construit par l'Occident). Insérez ici tous les stéréotypes sur les Arabes : cruauté, fourberie, activité sexuelle débridée, folie maniaque etc...
Et bien sûr l'islam, source de crainte après sa période de folle expansion. Sur ce terrain, j'attendais Saïd au tournant (le piège de l'excuse du "culturel" pour relativiser les valeurs humanistes), mais Saïd ne se lance jamais dans une défense de l'islam. Il se borne à noter, avec justesse, comme ce dernier est essentialisé, dépourvu de ses nuances et contradictions. Et le fait est que l'applomb avec lequel un nombre incalculable de généralités sont proférées sur ce sujet laisse pantois.
La postface est intéressante, car Saïd se défend des attaques de ses détracteurs (finalement Huttington est assez vite évacué), mais aussi de ceux qui le surinterprètent. Il se pose pour ce qu'il est : le défenseur d'une société multiculturelle, consciente que les cultures sont le fruit d'apports extérieurs et de transferts. Oui, rien d'original ni même de transcendant. On notera qu'il se dédouane d'une mésinterprétation, en se défendant de dire qu'il faut être arabe pour parler du Moyen-Orient. C'est le discours à sens unique, et le fait qu'il ait été appuyé par des instituts censés lui donner une légitimité que dénonce Saïd.
L'orientalisme découragera sans doute des hommes de bonne volonté, par son érudition et sa prose foucaldienne. Il n'en reste pas moine un panorama impressionnant de la manière dont, par un jeu d'autoréférence, un corpus d'oeuvres se renforcent les unes les autres pour fournir un discours reposant au départ sur de simples stéréotypes.
C'est déjà pas mal.