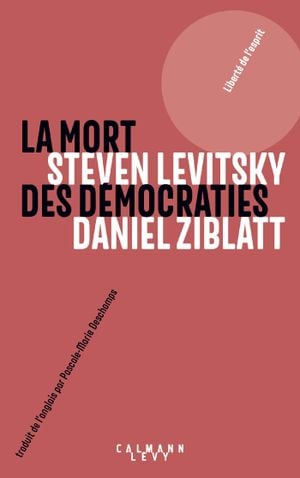La Mort des Démocraties est écrit par deux chercheurs en sciences politiques, tous deux affiliés à Harvard. Ce livre puise dans l’histoire des démocraties des XIXe et XXe siècles pour identifier des régularités dans les épisodes de glissement vers l’autoritarisme. C’est surtout l’histoire de l’Europe des années 1920-1930 (Daniel Ziblatt en étant un spécialiste) et celle de l’Amérique latine au XXe siècle (le domaine d’étude de Steven Levitsky) qui sont mobilisées au service d’une analyse se voulant générale, mais dont la visée particulière est l’examen du cas américain.
La définition que proposent les auteurs de la « démocratie » est celle d’un système politique dans lequel tous les adultes d’un pays votent régulièrement, au cours d’élections libres et équitables. Un système de gouvernement dans lequel les droits civiques fondamentaux — comme la liberté d’expression et d’association — sont globalement garantis. Pour la sauvegarde de ce système institutionnel, les auteurs insistent sur l’importance de deux paramètres :
• Les membres de partis opposés doivent se respecter mutuellement, en faisant le « pari de l’intelligence » : reconnaître que l’autre agit lui aussi dans l’intérêt des citoyens.
• Les individus occupant des fonctions officielles doivent respecter les règles non écrites de l’exercice du pouvoir — autrement dit, ne pas seulement se conformer à la lettre de la loi, mais aussi à son esprit.
À partir de ce cadre, les auteurs analysent l’histoire de démocraties dont les institutions se sont affaiblies. Dans le cas spécifique des États-Unis, ils montrent comment, selon eux, les Républicains surtout, ont abandonné ces principes, entraînant le pays sur une pente dangereuse. Les Démocrates ne sont toutefois pas exempts de toute responsabilité.
C’est un livre difficile à classer : s’agit-il d’un ouvrage de science politique ou d’un essai politique partisan ? Je pencherais plutôt pour le second, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que la définition que les auteurs adoptent de la démocratie est minimale — le droit de vote et des libertés fondamentales — et ne permet pas véritablement de rendre compte des mécanismes normatifs (respect mutuel et de l’esprit de la loi) qui sont au cœur de leur analyse. Ensuite, parce qu’une large part du livre porte sur la démocratie américaine du XIXe et du début du XXe siècle, qui, selon leur propre définition, n’en était pas une : une grande partie de la population en était exclue, qu’il s’agisse des femmes avant 1919, ou des personnes racisées jusqu’aux années 1960.
Il faut donc lire La Mort des Démocraties comme un essai d’avertissement plus que comme une démonstration scientifique. Un livre inquiet, qui affirme que la démocratie américaine se meurt : parce que les partis ont renoncé à leur rôle de filtre des candidates les plus démagogues, parce que Républicains et Démocrates se perçoivent désormais comme des ennemis et non plus des rivaux, et parce que les dirigeants successifs affaiblissent les institutions en méprisant leur dimension symbolique.
Avant de critiquer ce livre, reconnaissons-lui de multiples qualités.
D’abord, d’un point de vue de la forme, le livre est bien écrit et brille par sa clarté. L’analyse est si bien faite que ses étapes s’impriment sans difficultés dans la mémoire. Enfin, le livre fournit un cadre flexible qui permet de lire les événements politiques sous un prisme structuré.
Ensuite, sur le fond, le cadre analytique que proposent Levitsky et Ziblatt — fondé sur les normes non écrites et la retenue institutionnelle — a un pouvoir explicatif remarquable. Leur intuition centrale, selon laquelle une démocratie ne tient pas seulement par ses lois mais aussi par la manière dont elles sont appliquées, reste d’une actualité brûlante. Ce cadre dépasse le seul cas américain : il éclaire la fragilité de nombreuses démocraties contemporaines, où l’on voit des dirigeants user des institutions jusqu’à la corde tout en respectant formellement la légalité. L’exemple français en fournit une illustration frappante. Rien n’est écrit dans la loi sur la nécessité pour les responsables politiques de s’entourer de collaborateurs irréprochables, et pourtant, la succession des scandales judiciaires — vingt-six mises en examen de proches du président ou de ministres en huit ans — érode la légitimité de l’ensemble du système politique. De même, l’usage répété de l’article 49.3 par la Première ministre Élisabeth Borne, employé vingt-trois fois en deux ans, illustre cette tension entre le respect formel de la Constitution et la violation de son esprit. Dans les deux cas, la lettre de la loi survit, mais l’esprit démocratique s’affaiblit.
Si cette idée de « respect mutuel » a le mérite de souligner la nécessité d’un dialogue civilisé entre adversaires, elle apparaît singulièrement naïve. Les auteurs semblent croire que le danger pour la démocratie réside avant tout dans la dégradation du ton du débat public, dans la brutalité du langage ou l’irrespect des formes. Or, le péril démocratique est d’une autre nature : il tient moins à la manière dont on débat qu’au contenu des valeurs que défendent une part croissante des acteurs politiques. Le problème n’est pas l’absence de courtoisie, mais la montée dans l'opinion de valeurs suprémacistes, racistes, machistes, transphobes ou homophobes, qui sapent les fondements mêmes du pluralisme démocratique.
Cette confusion conduit Levitsky et Ziblatt à entretenir une ambiguïté majeure : devons-nous respecter, comme de simples rivaux politiques, des acteurs qui œuvrent ouvertement à la destruction de la démocratie ? Le livre semble répondre par l’affirmative, au nom d’un idéal de débat sans exclusion. Mais cette position soulève deux difficultés. D’abord, une difficulté performative : est-il utile de débattre de manière avec des acteurs qui rejettent les principes mêmes du débat démocratique ? Ensuite, une difficulté morale : faut-il accorder la même légitimité politique à ceux qui cherchent à subvertir le régime ? Les auteurs ne distinguent jamais clairement ces deux plans, et finissent par confondre le respect de la diversité des opinions avec l’acceptation des ennemis de la démocratie dans l’espace public.
Je me permets une critique plus générale du livre, qui touche à son contenu idéologique et ses angles morts. Tout au long de l’ouvrage, transparaît une forme d’extrême centrisme : une confiance absolue dans les élites modérées et une méfiance constante envers toute expression de radicalité politique. Les auteurs regrettent par exemple que les cadres des partis américains ne puissent plus filtrer eux-mêmes les candidats, et doivent désormais s’en remettre aux électeurs à travers le système des primaires — mécanisme qu’ils jugent propice à la montée de démagogues. De même, leur méfiance vis-à-vis de tout discours dénonçant « l’oligarchie » ou la concentration du pouvoir économique s’exprime clairement : ceux qui s’attaquent à ces inégalités structurelles sont systématiquement considérés comme des menaces pour la démocratie.
Enfin, les auteurs restent silencieux sur d’autres causes structurelles qui fragilisent les démocraties contemporaines. Ils insistent sur les comportements des dirigeants, mais négligent d’autres facteurs à mon sens plus déterminants : la capture médiatique par les grandes fortunes (de droite et d’extrême droite), l’entre-soi de notre classe politique, sa corruption et ses violations de la loi, la multiplication des conflits d’intérêts en son sein... Leurs analyses ne disent presque rien de ces tendances, pourtant à mon sens centrales dans l’érosion du consentement démocratique. En refusant d’examiner ces causes profondes, ils finissent par réduire la survie de la démocratie à une affaire de vertu personnelle : tout reposerait sur la modération et la courtoisie d’une poignée d’élus raisonnables, ainsi que sur leur capacité à ne pas sacrifier leurs idéaux démocratiques à leurs succès électoraux.