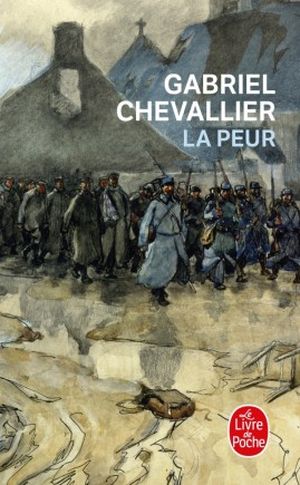Dans le prolongement de mes lectures sur la Première Guerre mondiale, après Le Feu d’Henri Barbusse, j’ai choisi La Peur de Gabriel Chevallier, publié en 1930. Ce roman autobiographique, moins célèbre mais à mes yeux plus bouleversant, plonge directement dans l’esprit d’un soldat confronté à l’absurdité du conflit. Contrairement à Barbusse, Chevallier privilégie une narration introspective : le lecteur se retrouve immergé dans les pensées, les émotions et les révoltes du narrateur.
Dès les premières pages, il démonte l’enthousiasme naïf des peuples en 1914, une euphorie collective bâtie sur des mythes nationaux et héroïques, au mépris des cicatrices de 1870. Il souligne la fracture entre l’avant et l’arrière : ceux qui combattent et ceux qui commentent. Les officiers apparaissent comme des figures arrogantes, apprenant la guerre en sacrifiant leurs hommes.
Le récit est traversé par une philosophie du désespoir : le héros n’éprouve ni haine ni exaltation, seulement la volonté de survivre. La guerre devient un combat contre l’ennui, la douleur et surtout contre la perte de sens. La peur, omniprésente, détruit l’estime de soi, oblige parfois à accepter la mort pour continuer à avancer, mais toujours de manière provisoire. Les bombardements, le hasard des obus et la brutalité quotidienne évoquent, par analogie, ce que l’on peut ressentir aujourd’hui sous la menace invisible des drones.
Chevallier dénonce aussi la propagande : celle de la presse, des écrivains (Barrès notamment) et des prêtres qui sacralisent le sacrifice. À l’hôpital, un chapitre marquant distingue trois catégories de blessés , morts en sursis, mutilés « utiles », guéris terrorisés et montre l’absurdité du conflit jusque dans la chair des hommes. Le narrateur y affirme que sa seule patrie est intérieure, dans ses idées, et démonte la vision idéalisée des soldats entretenue par des infirmières nourries à la propagande.
La relation avec le père illustre un autre conflit : celui des générations. Obsédé par le grade de son fils, le père ne cherche jamais à comprendre son expérience, laissant apparaître l’incompréhension entre ceux qui vivent la guerre et ceux qui la jugent de loin.
Grâce à son poste d’agent de liaison, le narrateur offre une vue d’ensemble des horreurs : mutilations volontaires, mensonges des gradés, gendarmes qui surveillent sans combattre, groupes francs dignes de bandits, économie de guerre occultée. L’arrivée des Américains n’y change rien : l’absurdité demeure intacte.
Parce qu’il a été écrit plus tard, le roman bénéficie d’un recul qui lui permet d’être encore plus critique que Le Feu. Là où Barbusse devait contourner la censure en pleine guerre en utilisant ses personnages pour faire passer ses messages, Chevallier peut aller au bout de sa lucidité.
La conclusion : « La bêtise humaine est incurable. Raison de plus, rigole ! » condense l’esprit du livre : un pessimisme clairvoyant, teinté d’ironie.
La Peur est une œuvre puissante, profondément humaine, qui dépasse la simple dénonciation pour interroger la nature de l’homme, de la société et de la mémoire. Par son humour noir, son style direct et sa lucidité, Chevallier livre un témoignage essentiel, toujours actuel, loin des discours héroïques et des mythes patriotiques.