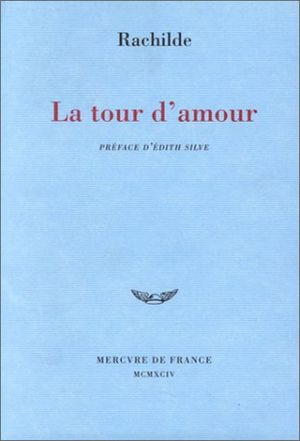Le roman retrace l’expérience d’initiation au métier de gardien de phare de Jean Maleux, un jeune homme ayant travaillé en Chine, auprès du vieux gardien-chef Mathurin Barnabas au phare d’Ar-men en Bretagne. L’histoire prend place dans un cadre métaphoriquement puis complètement décadent. La rencontre et les premiers pas de Jean Maleux avec Mathurin Barnabas s’avèrent pleins de mystères et d’inquiétudes du fait de ce qui entoure le vieil homme, à la fois taiseux, répugnant physiquement et moralement, et parfois, de prime abord, incohérent dans ses propos.
La Tour d’Amour présente une narration et un point de vue étudiés, notamment par un sociolecte très réaliste et incarné, tout cela sans perdre les spécificités de la langue décadente par ses expressions rares et ses métaphores déroutantes ou encore une justification pertinente et signifiante de la narration et de son entreprise à l’issue du roman. Au fil du roman, l’énonciation parfois se trouble, nous déstabilise pour mieux marqué le brouillage des frontières entre la pleine possession de ses moyens et la folie.
Effectivement, comme d’habitude, Rachilde met en scène cette vision fin-de-siècle de la société et de la vie avec cette porosité entre les oppositions traditionnelles qu’elle déconstruit : féminin/masculin ; humain/animal ; norme/abjection ; vivant/mort ; etc. Cela est évidemment mis en scène principalement par la conception phallique du phare et l’impalpabilité voire l’intangibilité de la mer, ce féminin devenu violent et vicieux.
La mer délirante bavait, crachait, se roulait devant le phare, en se montrant toute nue jusqu’aux entrailles. La gueuse s’enflait d’abord comme un ventre, puis se creusait, s’aplatissait, s’ouvrait, écartant ses cuisses vertes ; et, à la lueur de la lanterne, on apercevait des choses qui donnaient l’envie de détourner les yeux. Mais elle recommençait, s’échevelant, toute en convulsion d’amour ou de folie. Elle savait bien que ceux qui la regardaient lui appartenaient. On demeurait en famille, n’est-ce pas ?
Dans ce récit d’apparence masculine au vu du personnel romanesque (l’attention du roman est très resserrée sur les deux hommes et ce phare), le féminin est omniprésent voire domine la situation (la désillusion de l’amour notamment avec l’histoire de la vie de Barnabas et des vices qu’il a développé). En effet, en plus du rapport à la mer, violente, dangereuse voire mortelle, il faut dire qu’à nouveau, la ressemblance physique entre la (trop) jeune Marie, l’ancien amour de Jean et la proximité comportementale entre elles et l’ex femme de Barnabas dit, encore une fois, que pour ces hommes toutes les femmes sont pareilles et trahissent invariablement, la mort, elle, ne trompant pas.
L’androgynie avec Rachilde n’étant jamais très loin, on retrouve également ce brouillage des genres surtout dans le personnage de Barnabas, un vieil homme répugnant qui chante comme une demoiselle, si ce n’est comme une sirène. L’animalité et le sauvage sont de même convoqués dans le personnage de Barnabas corrompu par une vie de solitude, de dégradation psychologique et mentale qui va de l’illettrisme aux vices les plus insoutenables. Barnabas en va même à devenir une chimère décadente et monstrueuse, animale et malfaisante, à l'image de son intériorité.
Il avait l’aspect d’un crabe énorme. Son dos bombait, ses jambes râclaient la pierre, et les pinces de ses doigts tâtaient les endroits glissants.
En termes de composition, c’est l’un des romans les plus aboutis de Rachilde où elle se montre dans ses intentions beaucoup plus subtiles que d’habitude. Par ailleurs, son travail et l’aspect réaliste du roman, notamment par l’inspiration de faits réels (journalistiques ou personnels) sont d’autant plus à saluer.
Enfin, je dirai que le roman murit beaucoup mieux dans mon esprit, particulièrement aussi par la lecture des diverses interprétations, que pendant la lecture du roman à proprement parler : je m’attendais à quelque chose qui ressemble davantage à The Lighthouse d'Eggers et pendant un moment j’étais un peu déçue. Toutefois, la fin du roman est vraiment très réussie et m’a rattrapée. En effet, le Maleux commence à être corrompu par le vieux, par ses expériences (inconstance de sa promise et des femmes en général) et par son mode de vie (mutisme, l’enracinement au phare), ce qui était très réussi et pertinent, autant en termes de sens qu’en termes de narration. D'où l'idée de "vertige de la répétition" qu'a suggéré Camille Islert dans sa préface.
Marie, ma chère petite Marie… Devant Dieu, s’il m’écoute, je jure de ne jamais revoir la terre.