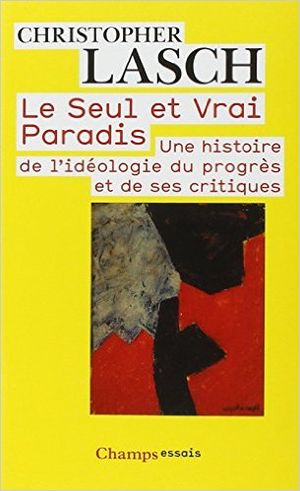Il semblerait que l'homme moderne — ce féru de précision, de certitude, de justesse, d'objectivité — soit tragiquement peu conscient de sa propre histoire, surtout celle qui est récente, qui le précède tout juste, sans parler de celle qu'il vit actuellement.
Il faut des personnes comme Christopher Lasch — des déchireurs de voiles — pour en prendre pleinement conscience : le passé proche est saturé de mythes rassurants, de beaux récits fondant une sorte de consensus collectif. On baigne dans une fausse conscience historique à peu près totale.
Le Seul et Vrai Paradis est particulièrement intéressant à ce titre : c'est un livre d'histoire. Non pas simplement un livre d'histoire des idées, comme on pourrait attendre de son titre, mais un livre qui essaye d'articuler les idées et les faits historiques dans une narration globale, porteuse de sens, qui concerne principalement les États-Unis.
D'ailleurs, pour Lasch la notion de Progrès doit moins à une sécularisation de l'eschatologie chrétienne, comme il est souvent affirmé, ou à une tradition philosophique particulière, mais plus simplement au sentiment que les progrès de l'économie, à la fin de l’Époque Moderne, étaient en train d'entraîner un véritable Progrès de la civilisation, une marche en avant sans retour possible, une amélioration nécessaire et en tous points positive de la vie humaine — voire même de l'homme dans son humanité.
Il estime d'ailleurs que les valeurs portées par le christianisme — une forme d'ascèse, de contrition — sont contraires à celles portées par l'idée de progrès : le progrès entame une profonde transformation anthropologique qui, à vrai dire, ne se heurte pas seulement qu'au christianisme, mais à un ensemble de valeurs « traditionnelles » ou « populaires » jusque-là communément admises.
Il s'agit avant tout, fondamentalement, d'une nouvelle attitude face à l'histoire : le progrès se caractérise par le sentiment d'optimisme tandis qu'était commun le sentiment d'espérance. L'optimisme s'appuie sur la certitude que la civilisation n'aura pas de fin, qu'elle croîtra éternellement ; l'espérance naît du sentiment que les civilisations naissent, grandissent et meurent inéluctablement, que rien n'est éternel, que tout est périssable, que le mal et le pire rôdent toujours mais que, pourtant, le mieux est possible.
Si nous distinguons l'espérance de l'attitude plus conventionnelle connue sous le nom aujourd'hui d'optimisme — si nous l'envisageons comme un trait de caractère, une prédisposition de tempérament, plutôt que comme une appréciation de la direction du changement historique —, nous pouvons comprendre pour quelles raisons elle nous est plus utile, au milieu des flots déchaînés de la marche en avant, qu'une croyance dans le progrès. Elle ne peut nous prévenir d'attendre le pire. Le pire est toujours ce à quoi ceux qui espèrent se sont toujours préparés. Leur croyance en la vie ne serait pas très valable si elle n'avait pas survécu aux déceptions du passé, tandis que le fait de savoir que le futur porte des déceptions supplémentaires témoigne de la permanente nécessité de l'espérance. Ceux qui croient au progrès, au contraire, bien qu'ils aiment se penser comme le parti de l'espoir n'en ont actuellement que peu besoin, depuis qu'ils ont l'histoire de leur côté. Mais ce manque leur interdit toute action intelligente. L'imprévoyance, une foi aveugle dans le fait que les choses ne peuvent se dérouler que pour le mieux, fournit un substitut indigent à la disposition qui consiste à mener les choses à bien, y compris lorsque les difficultés qu'elles posent nous semblent insurmontables. (p.100)
L'espérance n'est donc en rien une fuite dans le passé ou dans l'éternelle immuabilité des choses — la nostalgie, cultivée particulièrement dès les années 20 sur le thème du « paradis perdu » après la Grande Guerre, est, selon Lasch, au contraire un produit de la croyance dans le progrès — ; il s'agit plutôt de vivre dans une attitude volontaire et courageuse à l'égard de l'avenir : une promesse de défis, de tragédies, à surmonter du mieux que possible pour transmettre un noyau d'équilibre, de liberté, d'harmonie à nos descendants — un héritage.
L'espérance trouve sa forme politique la plus aboutie dans l'idéal civique, dans la tradition républicaine qui, de Cicéron à Machiavel, est, selon Lasch, restée continuellement présente, en mineur ou en majeur, dans les esprits. Cet idéal suppose une célébration des vertus publiques, un sens du devoir à l'égard de la Cité, un sens du service civique et de l'héroïsme et du courage.
Le libéralisme, au contraire, naît avec l'idée que « les vices privés font la vertu publique » (Mandeville) : l'égoïsme des individus fait la « richesse des nations » (Smith). Il n'y a donc aucune raison d'en avoir honte !
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une crise de production du capitalisme commence à se faire sentir. Est alors estimé que, pour résoudre cette crise du capitalisme, il fallait inciter à plus de consommation : la consommation entraînant plus de production, elle augmenterait la richesse globale qui finirait bien par ruisseler sur l'ensemble de la société. C'est ce que théorise Keynes et ce que met en pratique Ford : l’État doit mettre en place des réformes devant stimuler la consommation, notamment en améliorant les revenus des salariés.
Pour des personnes comme Keynes, l'enjeu va bien au-delà : non seulement le confort matériel sera augmenté mais, estime-t-on, celui-ci permettra également une authentique amélioration morale des individus. À la fin de sa vie, Keynes prendra conscience qu'il s'était trompé, qu'il avait « mésestimé la nature humaine. » L'homme, en effet, ne peut se réduire à un agent économique ; ses espérances ne peuvent se résumer au confort et à la prospérité : il a besoin que la vie lui résiste, il a besoin de croire en quelque chose de plus que l'aisance matérielle.
Bien que le libéralisme originel reposait sur l'idéal d'un monde de petits propriétaires autonomes — qui était, en fait, à gros traits le monde de leur époque —, son application s'est concrètement manifestée par une hausse grandissante de la part du salariat dans la société, bientôt difficile à cacher derrière l'espoir que les salariés puissent devenir propriétaires, avant que le salariat finisse par être communément accepté à la fin du XIXe siècle.
Pourtant, le salariat fut très tôt remis en cause, d'abord et avant tout par les travailleurs eux-mêmes. Dès les années 1840, d'importants mouvements contestataires se font jour en Europe et en Amérique (les canuts de Lyon constituent un exemple célèbre en France). Mais contrairement à l'idée qu'a imposée la vulgate marxiste, ces révoltes étaient moins motivées par des intérêts économiques que par la défense d'un mode de vie.
Les nouveaux historiens du travail ont montré qu'un mode de vie entier était en jeu dans la lutte contre l'industrialisme. Les travailleurs n'étaient pas en train de défendre seulement leurs intérêts économiques, mais leurs métiers, leurs familles, et leur environnement. Reconnaître que des intérêts économiques ne suffisent pas à inspirer une agitation radicale ou révolutionnaire, ni à faire accepter aux individus les risques qu'elle implique, suggère une conclusion plus générale. La résistance au progrès est, me semble-t-il, un élément important, sans doute incontournable, de l'action révolutionnaire, de même qu'une propension à identifier le progrès au bouleversement, par des forces de l'extérieur, de l'équilibre de très anciennes communautés. Au XXe siècle, les révolutions ont adapté la forme typique de guerres de libération nationales, et quelque chose du même ordre, peut-on avancer, sous-tend le radicalisme de la classe ouvrière au XIXe siècle. Les travailleurs envisageaient leurs oppresseurs, les « capitalistes » et prêteurs, comme des étrangers, plus souvent qu'ils ne les considéraient comme des membres de leur communauté — des agents d'un pouvoir étranger, en fait, d'un « système papier », ou d'une « banque monétaire » internationale qui privaient les Anglais ou les Américains de leurs droits d'héritage, et menaçaient de les réduire en esclavage.
L'appel au passé impliquait également, en d'autres termes, un appel à une solidarité locale, régionale ou nationale face à une invasion de l'extérieur — un élément bien plus substantiel que l'hypothétique solidarité du prolétariat international. (p. 255)
C'est dans ce contexte que naît le mouvement Populiste aux États-Unis : il s'agit de défendre l'idée d'une démocratie locale, d'un idéal d'humanisme civique, d'un idéal d'autonomie, de petite propriété, d'un héroïsme austère face à la vie, d'une vision de la « vie bonne » dans sa simplicité, dans sa frugalité, enracinée dans les solidarités locales et non dans l'atomisation cosmopolite.
Le Populisme se heurte au Progressisme qui, non seulement estime la petite propriété obsolète et devant être nécessairement remplacée par les systèmes de production à grande échelle, mais considère avec le plus grand mépris l'enracinement paysan et ses idéaux civiques.
L'originalité de l'interprétation de Goodwyn (Lawrence, un historien) réside dans son rejet du postulat convenu qui veut que le progrès apporte la Démocratie. Il pense, bien au contraire, qu'une croyance dans les lois inexorables du développement va généralement de pair avec un certain mépris pour les gens ordinaires et leurs idées et coutumes ancestrales. Dans les années 1890, le « peuple » et la « société progressiste », avance-t-il, constituaient des symboles qui n'étaient pas complémentaires, mais bien opposés et rivaux.
Cette rivalité se perçoit encore dans le mouvement syndicaliste qui, fortement imprégné par les idées de Sorel, reprend à son compte les idéaux d'héroïsme, le goût de la vie comme affrontement, et un souci de croyances au-delà des préoccupations matérielles.
Et qu'en est-il du socialisme, auquel on rattache souvent Lasch ? Pour lui, le socialisme, parasité par les idées libérales de Marx, se présente bien avant tout comme un immense échec, déjà perceptible au début du XXe siècle. Son adhésion au Progrès, aux grands systèmes de production, et à la vision de l'homme comme simplement motivé par des intérêts matériels place le socialisme en vis-à-vis avec le peuple et ses convictions. Le communisme ne devient qu'un capitalisme comme un autre, qui ne fait que remplacer les maîtres — du patron vers l’État — sans abolir l'esclavage lui-même. L'aliénation, chez les marxistes, est atténuée comme simple confiscation de la plus-value, comme si ces petites frustrations comptables constituaient l'entier problème du capitalisme et de la société marchande ! Le discours socialiste, acquis sans réserves à un économisme froid déployé en austères projets de réformes économiques conformes à une soit-disant rigoureuse scientificité, devenait, dès le début du XXe siècle, incapable de susciter l'adhésion des foules. Et que dire des anarchistes, mouvement bourgeois par excellence acquis à toutes les excentricités individualistes et avant-gardistes, dont le rapprochement avec les syndicalistes fut, aux États-Unis, plus néfaste qu'autre chose ?
Les tentatives de mettre en œuvre une redistribution des revenus, d'égaliser les chances de diverses manières, d'incorporer les classes laborieuses au sein d'une société de consommateurs, ou d'encourager la croissance économique et l'expansion outre-mer en lieu et place d'une vaste réforme social, peuvent toutes être considérées comme des solutions de substitution, au XXe siècle, à la possession de la propriété, mais aucune de ces politiques n'a créé le type de citoyens actifs et entreprenants qu'espéraient les Démocrates du XXe siècle. Pas plus que ne l'a fait la solution apparemment plus audacieuse adoptée en Union Soviétique et en Europe de l'Est, qui revendiquait abolir l' « esclavage du salariat », et qui, en réalité, le consolida sous une forme nouvelle et bien plus insidieuse, remplaçant l'employeur privé par l’État et privant même, par conséquent, les travailleurs du droit de grève (p. 266-267).
Le socialisme est une déception. Tout comme la Démocratie libérale, incapable de créer la société parfaite qui était promise : le constat qu'une campagne électorale fondée sur les moyens de propagande était plus efficiente qu'un discours « éclairé » — pire ! le constat que les Américains votaient mal — distillait un profond sentiment de déception chez les élites libérales. Très vite, le mépris pour l'Américain ringard, ce paysan indécrottable à moitié sauvage (les États-Unis s'étaient pourtant fondés sur cet idéal du paysan autonome, du fermier modeste et humble, isolé dans sa ferme aux confins du monde) devenait une véritable mode littéraire chez des personnes qui se sont mises à se considérer comme étant « une minorité civilisée. »
La question se posait ainsi : comment se pouvait-il qu'il puisse exister, dans une société civilisée et éclairée, des manifestations d'obscurantisme, d'irrationalité, d'archaïsme ? Pour Adorno, penseur marxiste, la réponse est simple : de telles anomalies ne peuvent qu'être des maladies sociales. C'est sous sa direction qu'est publiée La personnalité autoritaire, en 1950, un livre de psychologie et de sociologie que Lasch présente comme illustrant particulièrement ces nombreuses études de l'après guerre qui souhaitaient débusquer l'origine sociale de l'obscurantisme — étant entendu que la Deuxième Guerre mondiale incitait à tenter de comprendre comment le fascisme et les haines raciales (considérés, pour quelque très étrange raison, comme des reliquats du passé) ont pu dominer dans une société progressiste.
Des études à la méthodologie plus que douteuse, souhaitant absolument traquer le fasciste qui se cache derrière chaque Américain (le mot « fasciste » adoptant une définition extrêmement large : tout ce qui n'est ni parfaitement libéral, ni parfaitement marxiste), dont les croyances en progrès sont en vérité superficielles : derrière le vernis se cache toujours le monstre des siècles obscurs...
Mais toute maladie a son remède : la sociologie et la psychologie sont devenues non seulement des « sciences » du dépistage de la peste brune, mais également des disciplines capables d'élaborer les remèdes adéquats. Ils sont principalement au nombre de deux : confier la politique aux Experts d'une part, « éduquer » la population d'autre part afin de lui inculquer enfin les saines valeurs individualistes et libérales.
Et pourtant, malgré tous ces efforts...
La réapparition de la droite, non seulement aux États-Unis mais à travers une grande partie du monde occidental, a plongé la gauche dans la confusion et a remis en question l'ensemble de ses anciennes suppositions quant à l'avenir : le fait que le cours de l'histoire favorisait la gauche ; que la droite ne se remettrait jamais des défaites qu'elle avait subies au cours de l'ère libérale et de l'ascendant social-démocrate ; qu'une certaine forme de socialisme, tout du moins un type d’État-providence plus volontaire, remplacerait bientôt le capitalisme de marché. Qui aurait prédit, il y a vingt ans (le livre a été publié en 1991), qu'au moment où le XXe siècle passerait à son terme, ce serait la gauche qui partout battrait en retraite ? (p. 23)
C'est sur ce constat que s'ouvrait le livre de Lasch : l'impulsion croissante du libéralisme contre le peuple — qui passe également par la croissance toujours plus grande de la propriété privée monopolistique, la disparition quasi totale de la petite propriété privée, l'essor accru des métiers peu qualifiés aliénants, ainsi que par un déclin rapide du niveau de vie des classes moyennes et de leur sécurité existentielle, dès les années 1970 — produit un vaste sentiment d'exaspération et de contestation. Une exaspération, notamment, due à la disparition des vertus civiques, à la disparition du sentiment de confiance (!) et de sécurité apporté par les anciennes solidarités locales ou de quartier (plus personne ne laisserait sa maison tout le temps ouverte aujourd'hui, par exemple).
Mais Lasch ne pense pas que le salut viendra de la droite qui mêle populisme et libéralisme (libéralisme qui n'est plus vraiment unanime à droite aujourd'hui, en France en tout cas) : il espère plutôt un renouveau d'une forme de Populisme capable de renouer avec les valeurs de l'humanisme civique, avec une vision tragique et héroïque de la vie et de l'histoire, avec les valeurs d'autonomie, de responsabilité, de production locale et d'enracinement — par ailleurs tout-à-fait conformes, précise-t-il, aux enjeux écologistes qui commençaient à se dessiner à son époque.
Lasch a très bien cerné, bien avant beaucoup de monde, les enjeux de ce début de XXIe siècle : sa clairvoyance est chaque jour mieux mise en lumière par l'actualité (surtout à la date où cette critique a été publiée).