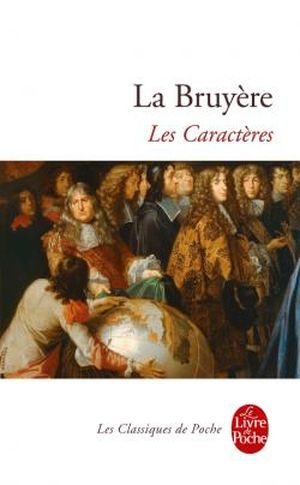Second ouvrage lu de cette année 2025, je mets un temps fou à finir mes livres désormais même si l’on peut reconnaître que celui-ci aux éditions « Livre de Poche » fait la bagatelle de 630 pages. Les Caractères de La Bruyère est une sorte de retour aux sources, sa relecture fut un voyage dans le passé sans escale jusqu’au lycée en 2005-2006. En effet, j’ai découvert ce livre du célèbre moraliste français dans un contexte pédagogique et scolaire, comme beaucoup d’adolescents en France en terminale « L ». Depuis cette étude scolaire de quelques sentences de La Bruyère, où l’objet était finalement de démontrer une fois de plus aux élèves les inégalités entre les Hommes, entre les « Grands » (les Nobles ayant de très hautes fonctions militaires ou politiques) et le reste de la population ou encore de mettre en lumière la fausseté de la noblesse de cour qui se pare de toutes les vertus alors qu’il n’en est rien dans les faits, j’ai beaucoup grandi. A l’époque le livre m’avait beaucoup marqué. Sans dire d’âneries, je crois qu’il s’agissait de mon premier livre en français classique du XVIIème siècle, avec son phrasé, son vocabulaire, sa structure. Déjà, j’étais fasciné à l’idée de voir « parler », de comprendre la psychologie, les habitudes, les turpitudes, les passions des hommes ayant vécu dans l’entourage du roi Louis XIV. Car ce livre est un témoignage transversal mais direct des modes et travers des gens de cette époque et, lire Les Caractères, en quelque sorte, est un moyen de leur redonner vie plusieurs siècles a posteriori. Avec le recul, ce livre est un moyen parmi tout un arsenal soigneusement choisi par la République depuis des décennies et sa horde de hussards noirs pour décrédibiliser l’Ancien Régime et les hommes de son temps. On vient jouer la corde sensible sur les inégalités, on expose au grand jour la vacuité de la cour et de ses préoccupations ringardes, on dénonce la décadence morale d’une minorité privilégiée au détriment d’un peuple toujours accablé par la faim. Si on ne peut nier les vérités assénées par La Bruyère, grand observateur de son siècle, durant les seize chapitres que composent Les Caractères, il est vain de résumer la société française du XVIIème siècle à ces maximes sorties de leur contexte au moment où nous, adolescents du XXème siècle, les avons étudiés. Si la morale et les vertus sont au cœur des préoccupations du moraliste, et donc de ce livre, qui peut nier qu’il s’agit également d’un exercice littéraire pluriséculaire inspiré de l’Antiquité ? Il en reste que près de 20 ans plus tard, avant la relecture de cette œuvre sublime, j’avais en tête des passages culte sur les « Grands » comme pour témoigner de cette impression que laisse les cours maudits de la « Gueuse » comme disait Charles Maurras. Les Caractères de La Bruyère, au-delà de l’auteur, du contenu du livre, est, pour moi, l’histoire d’une mémoire violée, d’un passé fantasmé et déformé, d’un régime autoritaire, la République, ayant pratiquement tout pris à son peuple jusqu’aux conditions de son existence (cf. l’actualité, la dilution culturelle et ethnique du pays en 2025, mais aussi la défaite en 1940, etc.). Rien ne nous aura été épargné, rien. Et c’est dans cet esprit de revanche douce, empreinte de nostalgie lycéenne et de lucidité politique, que je suis retourné vers La Bruyère, non comme un devoir de mémoire scolaire, mais comme une arme retrouvée, un miroir acéré tendu à notre époque.
Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples.
Issu de la petite noblesse de robe, précepteur du petit-fils du Grand Condé, Jean de La Bruyère (1645-1696) est un homme à cheval entre les salons des Grands et la solitude propice à l’écriture. Ambiguë, il appartient à ce monde qu’il observe et qu’il juge. Ecrivain moraliste, il reprend une tradition héritée des Anciens (le Discours sur Théophraste et ses Caractères inclus dans cette édition) qui s’est épanouie tout au long du XVIIème siècle. Un moraliste n’est ni théologien, ni politique, ni historien, c’est un observateur de la vie des Hommes qui tente d’en tirer une vérité générale à partir de cas particuliers, souvent cocasses, parfois pathétiques. Il dénonce toutes les tares connues de la vie mondaine de l’époque : les courtisans serviles, les faux savants prétentieux, les bigots de façade, les ambitieux ridicules, les soldats de salon et toute une élite qui confond gloire et paraître. Par l’analyse des comportements La Bruyère, comme tous les moralistes dignes de ce nom, tente d’écrire des maximes, des caractères valables en tout temps et en tous lieux. Intemporelles sont la morale et la vertu, intemporel doit être le travail du moraliste, et c’est en (re)lisant Les Caractères que l’on s’aperçoit finalement que l’auteur parle de nous. Oui, nous les héritiers ingrats et apostats d’un monde bien supérieur au nôtre et pourtant que l’on a méprisé et que l’on méprise encore. Et, c’est d’autant plus vrai lorsqu’on compare nos deux époques : la décadence morale, la perte de toute vertu, l’inconstance, l’inversion des valeurs, la perte de sens, l’attrait pour le mal sont les mamelles nourricières de notre époque très avancée, pourtant éclairée par la douce philosophie des Lumières, la liberté, l’égalité et la sacro-sainte Science, avec « S » majuscule. Mais il suffit de gratter trois secondes pour comprendre que notre époque est tout aussi obsédée par le statut, l’image, la réussite sans mérite. La cour du Roi-Soleil n’a rien à nous envier. La force de ce livre réside dans sa justesse incroyable, plusieurs siècles plus tard. Ainsi, si votre angle d’attaque à la lecture de cet ouvrage est de confirmer vos certitudes sur l’Ancien Régime comme incarnation officielle d’inégalités et de décadence morale, notamment par opposition de la République, alors vous ne trouverez aucune réponse. Désolé. Monarchie, République : les deux produisent des hommes ingrats et fats. Ce livre n’a jamais été le procès ou le pamphlet d’un régime ou d’une époque, il est un témoignage lucide des turpitudes des hommes quel que soit le siècle, quel que soit le statut social. Constat évident m’amenant à cette question pascalienne : sommes-nous mus par le vice ? Dès lors j’en conclus une chose : l’école républicaine a utilisé Les Caractères de La Bruyère, grande œuvre littéraire, comme un outil de conditionnement idéologique. Pendant toutes ces années, après 20 ans, le seul chapitre dont je me rappelais était « Des Grands », ridiculisant la haute noblesse de l’Ancien Régime. Je n’avais pas de détails en mémoire, rien, juste une vague idée sur le fait que la haute noblesse de l’Ancien Régime était pourrie jusqu’à l’os : l’histoire d’une mémoire violée.
Les Caractères, malgré les siècles, est un chef d’œuvre qui n’a rien perdu de sa force. Il faut même dire qu’il n’a jamais été autant d’actualité. Car à bien des égards, nous vivons dans une société qui perpétue, sous d’autres noms les mêmes travers que La Bruyère dénonçait à Versailles : obsession du paraître, conformisme moral, hypocrisie bien-pensante, ostentation des vertus notamment quand il s’agit d’immigration ou de wokisme, etc. Hier, c’étaient les dévots de cour et les flatteurs en perruque, aujourd’hui, ce sont les experts médiatiques, les influenceurs, les communicants, tous ces grands prêtres de la Vérité. Rien n’a changé, si ce n’est le vocabulaire mais on nage tous dans la même fosse septique. Et c’est peut-être pour ça que ce livre m’est si cher : parce qu’il n’épargne personne, pas même ceux qui se croient du bon côté de l’Histoire (ils seront jugés). Parce qu’il rappelle, sous ses maximes ciselées, que la grandeur ne se décrète pas, qu’elle se mérite. Et que l’époque actuelle, qui a tout sacrifié au présentisme, au confort et à l’égalitarisme forcené, n’a rien à envier aux vanités d’Ancien Régime. Elle les a même dépassées. En les démocratisant. Que Dieu ait notre âme.