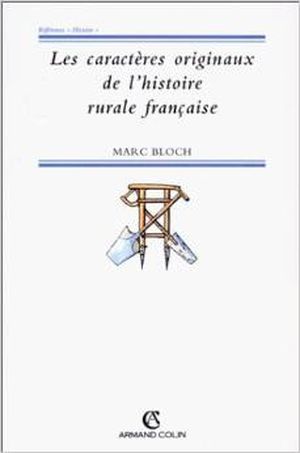Peu à peu s'est dessiné dans mon esprit ce second livre comme il aurait dû être. Je pourrais te le raconter presque tout entier.
Dans les profondeurs du Finis Africae où son adversaire le toise d'un souverain mépris, Guillaume de Baskerville énonce à voix haute les premières pages du livre perdu de La Poétique, du moins l'idée qu'il a pu s'en faire, aidé par ce que d'autres livres ont déjà raconté de lui. Glanés dans l'épaisse postérité du Philosophe, ces échos lointains du maître prennent chair, soudain, dans la parole vive du franciscain. Le voilà, faussaire virtuose, tressant ses paragraphes comme on projette sur un mur des ombres familières, amusé lui-même par sa propre subtilité. La mienne, bien sûr, n'atteint pas ces sphères, mais combien je comprends, à ce moment-là qu'Aristote est à Guillaume ce que Marc Bloch peut être aussi au passionné d'histoire. Comme il n'est point de philosophie médiévale, et point de philosophie du tout sans l'un, il n'est guère d'histoire au sens actuel sans l'autre. Je connaissais Marc Bloch avant de le lire, d'une connaissance médiatisée, certes, par ses nombreux successeurs, mais d'une connaissance profonde malgré tout, comme dérobée par accident, parce que d'autres l'avaient peu à peu constitué dans mon esprit. Il n'est que d'ouvrir un titre, n'importe lequel, de Georges Duby, Pierre Toubert, Laurent Feller, Fernand Braudel, et parcourir les chapitres au hasard, alors les mêmes catégories défilent : le grand domaine carolingien, l'ordre féodal, la paysannerie alleutière, le faire-valoir direct, le droit et la coutume, l'assolement triennal, la révolution agricole, les tenures et le servage... Toutes déjà étaient posées, en 1934, dans Les Caractères originaux de l'histoire rurale française, premier fondement véritable de l'historiographie de nos campagnes.
Œuvre dépassée, certes, faut-il le dire, pour avoir charrié à sa suite tant d'énergies conquérantes, mais quel historien n'en a pas caressé le rêve ? N'y a-t-il pas là le signe que Marc Bloch avait, de son temps, posé les bonnes questions ? Fernand Braudel eut beau jeu, plus tard, de nuancer la carte des assolements français, écornant ce tableau bien trop sage d'une agriculture du Nord et du Midi, il n'en oubliait pas moins de rendre un juste hommage à celui qui, le premier, avait posé sur la plaine de Caen, la vallée du Rhin, le bassin du Rhône, un regard si plein de fertiles interrogations. Pareillement, on a pu, ici et là, rediscuter l'ancienneté des fameux « champs laniérés » du bocage normand, l'origine encore fort mystérieuse de l'araire et de la charrue, rendre au fer la place qu'il méritait dans les plus vieilles sociétés paysannes, on n'oubliait pas, là encore, que toute correction portée aux Caractères n'en lustrait que d'avantage leur qualité de matrice première. Combien d'ailleurs, de considérations générales plus durables dans le temps ? Il n'est pas, à ma connaissance, un seul historien ni géographe pour balayer d'un revers de main les trois grands types de paysages que Marc Bloch avait dégagé de ses observations : l'openfield du nord et de l'est, le bocage de l'ouest et du centre, les champs irréguliers du Midi, sans compter les multiples nuances que l'auteur apportait déjà à son propre modèle. Point de révolution non plus, me semble-t-il, sur les raisons de la dégradation de l'esclavage antique et l’avènement du servage. Que d'obscurité, même encore aujourd'hui, sur la définition du serf et la nature de ses liens de dépendance !
C'est donc avant tout, le plaisir de voir déployées sous nos yeux les forces vives d'un brillant intellectuel, qui guide la lecture d'une synthèse presque centenaire désormais, le plaisir encore d'y voir courir cet esprit « comme le feu parmi les brandes ». L'on reste surtout frappé par cette capacité du maître à ne pas seulement décrire des espaces, des pratiques et des techniques, mais à les lier à des mœurs, des mentalités, des cultures, à ce qu'il nomme lui-même des « civilisations agraires ». Sous la vieille opposition entre assolement biennal et triennal, Marc Bloch sent déjà obscurément leur cœur palpiter :
Le cycle à deux temps est le vieil assolement méditerranéen, pratiqué par les Grecs et les Italiotes, chanté par Pindare comme par Virgile. Le triennal couvre la majeure partie de l'Angleterre, et toutes les grandes plaines de l'Europe du Nord. Leur opposition, dans notre pays, traduit le heurt de deux grandes formes de civilisation agraire, que l'on peut, faute de mieux, appeler civilisation du Nord et civilisation du Midi, constituées toutes deux, sous des influences qui nous demeurent encore profondément mystérieuses.
De la même façon, l'ordre et la forme des paysages lui parlent avant tout des hommes et des aspérités charnues de leur existence. Ainsi des champs ouverts déjà évoqués, longues et fines lanières serrées les unes contre les autres, en bataillons rangés, comme pour décourager par avance toute velléité d'enclore. L'ouverture, l'assolement et la vaine pâture y forment une triade sacrée, que brassiers et laboureurs défendaient encore âprement au tournant du XVIIIe siècle, sous le feu nourri des réformateurs royaux. Marc Bloch dénote dans ces régimes, et depuis leur obscure naissance, un sens du collectif particulièrement aiguisé, puisque l'ouverture servait avant tout la dépaissance du troupeau commun sur les parcelles moissonnées, ou sur les pâquis détenus en partage. Assurés de conserver aux bêtes l'herbe et la paille qui leur étaient nécessaires, les habitants du finage, gros ou menus propriétaires, se conservaient à eux-même les deux moyens les plus importants de leur subsistance, le pain et le moteur animal du train de labour. Dans ce nord français, où domine plus qu'ailleurs le collectivisme agraire, sont ainsi maintenues dans le marbre des coutumes cette harmonie des pratiques, comme les rouleaux dans l'arche sacrée. Il en résulte que la forme d'un finage n'est jamais chez Marc Bloch un fait géographique brut, mais toujours le produit d'une technique de faire-valoir, d'un type d'exploitation, d'une organisation sociale du travail, d'une conception également particulière de la propriété, et l'on reste toujours ébloui par ses démonstrations.
Lorsqu'il décrit la mutation au XVIe siècle de la seigneurie foncière, cette même capacité à saisir l'esprit d'une époque irradie les pages du livre. Dés lors qu'au sortir de la Guerre de Cent Ans, le seigneur d'antique lignage, pris à la gorge par ses dettes, écrasé par la tache énorme de restaurer un finage dévasté par les bandes, retourné en partie à la friche, vidé de ses bras, dés lors que ce seigneur est forcé de vendre ces terres à cette jeune bourgeoisie des villes, piquée d'ambition et de profits, alors le visage de la seigneurie se transforme. Elle n'est plus guère ce grand domaine partagé entre tenure et réserve, où l'ancien maître pouvait encore être qualifié d'exploitant à part entière, gageant à son service les jours de corvée qu'il pouvait exiger de ses gens. Partout le bourgeois fraîchement anobli, donnant en métayage toute l'ancienne réserve, se garde bien loin d'une terre qu'il n'a plus guère envie de côtoyer, et dès lors l'ancien seigneur-exploitant se mue en faiseur d'argent. Là encore, la lettre impeccable de Bloch surpasse tous les maladroits pastiches :
Toute la force bourgeoise – de la haute bourgeoisie du moins et de ceux qui aspirent à s'y hausser – s'est portée au secours de l'édifice seigneurial. Mais à hommes nouveaux, esprit nouveau. Ces commerçants, ces fermiers du fisc, ces prêteurs des rois et des grands, habitués à gérer avec soin, avec astuce, avec hardiesse aussi, des fortunes mobilières, en se faisant les successeurs des anciens rentiers du sol, ne modifient ni leurs habitudes intellectuelles, ni leurs ambitions. Ce qu'ils apportent avec eux, dans l'administration des biens récemment acquis, ce que leur exemple apprendra à ceux des gentilshommes de plus authentique noblesse qui, par aventure, ont conservé les richesses héréditaires (...) introduisent au sein des anciennes familles, qui si souvent virent leur patrimoine sauvé par quelque maîtresse femme, c'est une mentalité de gens d'affaires, accoutumés à calculer les gains et les pertes, capables, à l'occasion, de risquer les dépenses, provisoirement infructueuses, dont dépendent les bénéfices futurs : tranchons le mot, une mentalité de capitalistes. Tel fut le levain qui devait transformer les méthodes de l'exploitation seigneuriale.
J'aimerais, si j'en avais le temps et l'assurance, recueillir par le menu tous les joyaux de ce livre, comme à la ruche un miel doré, mais tant d'autres, déjà, ont offert à Marc Bloch toute la postérité qu'il mérite. Il n'est que de s'y plonger avec toute l'envie que j'aurais peut-être suscité dans ces quelques lignes. La générosité de son œuvre aura tenu surtout dans ses manières de travailler. Quand l’École Nationale des Chartes des années 1930 donnait encore la vieille diplomatique pour seul lait nourricier des enfants de Clio, Marc Bloch ne laissait point l'histoire faire de lui le serf du document. C'est avec les yeux et les pieds qu'il façonnait son objet d'étude, en regardant les paysages de son temps pour y aiguiser sa prodigieuse intelligence des milieux, instruit des leçons profondes qu'il puisât avidement dans la Géographie humaine de Paul Vidal de la Blache. De manière plus générale, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre lui permettait de s'aboucher à l'homme d'autrefois ne devait point le laisser insensible. Lucien Fébvre retrouvait naguère, dans les notes de son ami, quelques considérations fugaces, mais ô combien symboliques, sur quelques miniatures des Très Riches Heures du Duc de Berry :
Quand il trouve les moissons haut coupées à la faucille et, dans une campagne de Creuse, aujourd'hui, les moissons coupées bas, à la faulx, il note aussitôt : « Coupe haute, mentalité communautaire, le chaume abandonné à la pâture banale », ou bien : « coupe basse, mentalité moderne, strictement individualiste : à chacun son bien. Deux techniques ? Oui. Mais par elle, révélé, un conflit – non pas de mécaniques, mais de mentalité.
C'est là du Bloch à l'état brut, et l'on se prend à rêver quelquefois, très naïvement, à tous ces livres promis qu'un soir funeste de 1944 a brusquement dérobé au patrimoine commun de l'esprit, quelque part sur les chemins de Trévoux au nord de Lyon, et qui ne demandaient qu'à s'épanouir aux lumières dont Marc Bloch fut lui-même l'étincelle première.