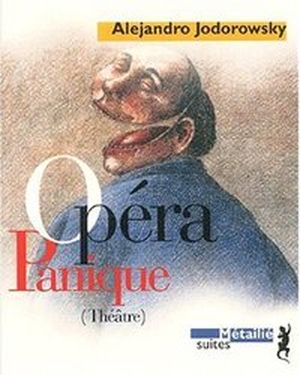Jodorowski, que je connaissais seulement en réalisateur, s’est dévoilé à ma surprise dramaturge. Opéra panique est composé d’une myriade de saynètes. Il s’appuie sur l’absurde camusien et s’inspire du virtuose dramatique Beckett. C’est en réalité un doux équilibre entre ces deux auteurs.
Le style de Jodorowski est limpide, simple, sans détour. Il écrit comme on parle. Il est profondément prosaïque. Pourtant, sa composition de mots « justes » est chargée d’une richesse philosophique. Alejandro n’entre dans aucune case : des inspirations nihilistes de Nietzsche, l’absurde comme dit plus haut, mais une vision pourtant optimiste. Il fait ce qu’il veut, comme un « foutons ça en l’air ». Insolent, il écrit « avoir ou ne pas avoir », moqueur, railleur. Obscène par moments, amoral à d’autres. Son humour noir n’est pas vain, il critique la faculté d’exister. C’est un vertige, un non-sens qui touche l’aspect ontologique le plus viscéral. Vanité, vanité, tout est vanité. Une finitude enjolivée.
Une éloge absolue serait creuse : il manque à Jodorowski l’aspect graphique de son art. On parle là d’un virtuose de la mise en scène, d’un grand cinématographe. Tout y passe : la couleur autant que la scénographie. Quand l’artiste est privé d’une part importante de son art, c’est… comment dire ? Déroutant. Sans prétendre accéder aux méandres de sa pensée, je trouve cela sensible et visible. Dans sa dramaturgie, parfois, on s’y perd : personnages peu marqués, enchaînements de répliques trop absurdes. Il sait me perdre autant qu’il sait me retrouver.
Très succinctement, il y a dans cette pièce un petit quelque chose d’agréable. Parfois maladroit, quelque peu poétique. Il fait ce qu’il fait, et il le fait bien. Un peu comme l’entreprise de Philippe Claudel dans Inhumaines : faisons ensemble quelque chose de notre fini
tude.