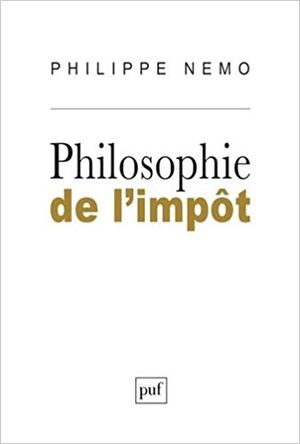Philippe Nemo est à nouveau de retour avec cette fois un livre très parlant, sur un sujet qui divise énormément dans notre société française - et dans la société occidentale en général - et même dans le milieu libéral dont l'auteur est issu, à savoir la question des impôts. Cette question revient très souvent dans le débat public, l'élection présidentielle l'as assez bien montrée, et des livres sortent régulièrement sur le sujet (j'ai moi-même feuilleté le livre de Jean-Marc Daniel Les Impôts. Histoire d’une folie française et j'ai lu en entier le très satyrique et provocant Tyrannie de la redistribution de Thierry Afschrift).
Cependant, le livre de Philippe Nemo m'intéressait, car il est une synthèse de sa très pertinente rétrospective sur la fiscalité dans l'émission qu'il anime sur Radio Courtoisie : Le monde de la philosophie, dont je prends beaucoup de plaisir à écouter les différents épisodes quotidiennement. Philippe Nemo est aussi un philosophe et un historien des idées que j'admire énormément par son immense travail et la très grande justesse de ses analyses.
Le livre se veut donc être une réflexion sur la fiscalité, au-delà de tout les dogmes libéraux que l'on trouve sur le sujet (le fameux "l'impôt c'est du vol"). En effet, Philippe Nemo ne pense pas qu'une société sans impôts serait quelque chose d'envisageable du point de vue de la réalité, que dans une société d'hommes libres, l'impôt sert principalement à financer les domaines régaliens de l’État, pour cela il se réfère surtout à Hayek - dont il est un grand spécialiste - dans Droit, Législation et Liberté.
Étant donné que Philippe Nemo aime beaucoup l'histoire, il ne manque pas du tout l'occasion de nous faire un rappel sur l'histoire de l'impôt en France. D'abord une très longue partie consacrée à l'évolution des impôts à partir de l'Ancien régime jusqu'au modèle français d'après le Seconde guerre mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Non pas tellement une froide accumulation des différents impôts qu'a connu le pays mais plutôt une explicitation des différentes visions de l'impôt par les différentes idéologies et leur application en France, ainsi que leur utilité. Pour cela, Nemo reprend les analyses de Peter Sloterdijk
qui démontrent que le prélèvement d'impôts a augmenté considérablement en Allemagne et dans les autres pays européens, par rapport aux autres époques, après la Seconde guerre mondiale. L'emprise de l'idéologie social-démocrate et keynesienne étant à son apogée à cette époque.
L'analyse de l'impôt par Philippe Nemo se poursuit ensuite sur le rôle réel de l'impôt, où il se réfère cette fois à Friedrich Hayek et réfléchit sur la notion "d'intérêt général". Il est clair que l'intérêt général en tant que tel n'existe pas, il existe en réalité plusieurs intérêts généraux et que le marché est le moyen de faire converger ces divers intérêts. Le livre est très utile alors car il réfléchit alors au rôle de l'impôt comme garantissant l'ordre public, le fourniture des biens et des services et la réduction des inégalités sociales. Nemo fournit une analyse très intéressante de ces biais.
Ceci amène notamment à considérer les différentes conceptions d'impôts dans l'histoire des idées économiques et politiques. Le livre met brillamment en lumière la différence entre la conception libérale et hayekienne et la conception socialiste qui est sans contre-partie, basé en grande partie sur le solidarisme, tout en nous faisant comme à son habitude une très claire histoire du socialisme et de son rapport à l'impôt. Enfin, la partie se conclut par la description de la conception keynesienne, qui est la plus répandue.
La quatrième partie est la plus intéressante car elle répond à ces conceptions de l'impôt confiscatoire, socialiste, marxiste et keynesienne.
Je me suis gardé de détailler les développements de Philippe Nemo dans son livre pour le lecteur. Mais ce livre est très efficace pour comprendre la portée politique et philosophique de l'impôt.
Globalement on peut en retenir que :
1) L’homme est constitué par un être et par un avoir. L’avoir ne conditionne pas l’être, mais l’informe. L’homme qui possède un bateau est un marin. Si vous le privez de son « avoir-bateau », vous le privez simultanément de son « être-marin ». Ainsi, la fiscalité prédatrice, en s’attaquant à la propriété privée, s’en prend à l’être du propriétaire. Opposer frontalement l’être et l’avoir est une lecture simplificatrice et/ou une radicalisation mystique du message évangélique.
2) L’argument utilitaire de la fiscalité redistributrice (enlever le superflu au riche pour donner le nécessaire au pauvre) est un sophisme car, en théorie économique marginaliste, les différentes utilités ne se comparent pas entre elles : la valeur de l’utilité est subjective, conférée par l’agent économique. De plus, l’utilité d’un revenu n’équivaut pas à l’utilité d’un bien, car le revenu est le moyen d’acquérir des biens et non un bien en tant que tel.
3) Le logiciel idéologique de la gauche française est le solidarisme, qui a peu à peu pris la place du marxisme après que celui-ci a perdu de sa superbe suite aux révélations sur les goulags. Ce courant de pensée (initié par Léon Bourgeois et Célestin Bouglé, entre autres) est majoritaire dans les loges maçonniques. Il postule que l’homme naît endetté, jouissant de biens et de techniques qui ont été inventés par ses prédécesseurs et que cette dette doit être remboursée via l’impôt. Le riche est autant redevable que le pauvre, ce qui nous amène à tendre insensiblement vers l’égalité des conditions matérielles.
4) L’impôt dans le domaine de l’éducation doit servir à financer l’éducation de base et non l’éducation supérieure. Car l’éducation de base profite à tous les citoyens et garantit la fluidité des échanges et des interactions entre les individus (il faut que le commerçant ait des notions de droit pour se livrer à ses activités, que l’administrateur parle correctement la langue de l’Etat pour ne pas induire en erreur ses administrés, etc,) tandis que l’étudiant qui se lance dans des études supérieurs attend un remboursement personnel du temps passé à étudier ( sous forme de son futur salaire). Hayek le fait remarquer dans sa Constitution de la Liberté.