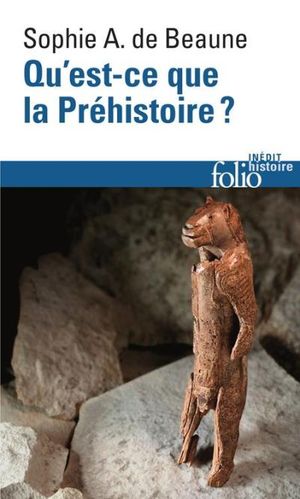La Préhistoire du titre a beau porter une majuscule, c’est bien de la préhistoire comme discipline qu’il est ici question. Et si la Préhistoire peut se révéler passionnante, l’étude de la préhistoire n’est pas en reste. Or, en évoquant l’ensemble des outils à disposition du préhistorien – c’est peu ou prou, le sens de l’organisation du volume –, Qu’est-ce que la préhistoire ? fait d’un silex plusieurs coups.
L’ouvrage expose ainsi, au fil de son développement, les principaux écueils qui guettent le préhistorien, en particulier « les deux risques majeurs […] : celui de la généralisation et celui de l’extrapolation » (p. 150), qui produisent quelquefois « une interprétation si consensuelle qu’elle [finit] par devenir une connaissance tacite » (p. 84). Si l’on y ajoute – pour s’en tenir aux abus qui guettent les chercheurs sérieux – que « les préhistoriens et les paléoanthropologues sont tributaires de leur propre catégorisation » (p. 106), on aura à peu près fait le tour. Il reste à ajouter quelques défauts extrinsèques à la discipline : « les préhistoriens sont facilement enclins à considérer leur sujet de recherche comme un bien personnel inaliénable » (p. 67, ce qui n’est pas propre à ce domaine de la recherche…), et « la plupart des préhistoriens ne savent pas écrire » (p. 263) ! Dans tous les cas, Sophie A. de Beaune rend ses exemples suffisamment clairs et éloquents pour que le lecteur non-spécialiste ne soit pas frustré.
Mais Qu’est-ce que la préhistoire ? n’est pas une manière de bêtisier ou de dossier à charge qui tournerait au règlement de comptes ; il ne s’agit pas de bons points ou de coups de règles sur les doigts à distribuer. D’ailleurs, si l’auteure elle-même échappe aux pièges qu’elle évoque, c’est parfois pour tomber dans d’autres panneaux : dire, sur la foi d’empreintes d’enfants trouvées dans des grottes, qu’elles « étaient fréquentées par des adultes qui y emmenaient parfois de très jeunes enfants » (p. 247), c’est déjà tirer des conclusions abusives, car rien ne dit que « de très jeunes enfants » n’ont pas visité les grottes seuls… Ou encore, lorsque Sophie A. de Beaune réfute la thèse de « la contemporanéité de la grotte Chauvet (dont je rappelle qu’elle est datée de 31 000 à 32 000 ans) avec celle de Lascaux (plus jeune de 15 000 ans) » (p. 141), elle se garde en effet du « modèle évolutionniste de l’art » défendu par les partisans de la thèse en question, mais elle confond la datation des grottes avec la datation des peintures qui les ornent. De même, en lisant que « si l’absence d’un tel indice aurait indéniablement eu un caractère de preuve – négative en l’occurrence – sa présence ne constitue pas une preuve, mais tout au plus un indice » (p. 192), on se retrouve avec une belle tautologie – je laisse au lecteur de cette critique le soin de la dénicher.
Mais l’ouvrage ne perd jamais de vue que l’erreur – ou l’errement – peut engendrer la connaissance. Ainsi de l’« apport “négatif” » de Leroi-Gourhan, qui « a rendu certaines interprétations définitivement caduques » (p. 185) : il n’est pas ici question de tailler un costume au « Patron », mais de lui donner une place, incontournable, en l’occurrence, dans l’histoire d’une discipline. Cela corrobore l’objectif exposé en l’introduction : « faire prendre conscience […] que tout ce que l’on peut dire sur le passé lointain résulte de constructions plus ou moins élaborées et ingénieuses qui se veulent les plus vraisemblables possibles » (p. 22).
Il s’agit en définitive d’insister sur le caractère essentiellement lacunaire de la préhistoire, plus généralement des sciences historiques, et plus généralement encore des sciences humaines : s’« il arrive que le préhistorien trouve des éléments de réponse à des questions qu’il ne se posait pas » (p. 110), on peut sans doute en dire tout autant de l’historien, de l’ethnologue, de l’anthropologue, etc. L’ouvrage dresse régulièrement des parallèles avec ces disciplines, au point que les dernières pages concernent la préhistoire comme un récit dans lequel s’imbriquent « une phase d’observation, qui serait objective » et « une phase d’interprétation, qui serait plus subjective » : « derrière l’œil qui voit, il y a l’œil qui pense, et cet œil-là ne pense que dans la mesure où il se raconte un peu des histoires », p. 167. (On pourrait d’ailleurs rapprocher la démarche de Qu’est-ce que la préhistoire ? de la réflexion menée par Éric Chauvier sur l’anthropologie : « les ethnographes n’étudient pas des cultures, ils en écrivent », p. 144.)
Le dernier mérite – et non le moindre – du livre est de parler, comme en creux, des hommes préhistoriques : en traitant d’une discipline, Qu’est-ce que la Préhistoire ? traite par ricochet de l’objet de cette discipline, si bien que le lecteur versé dans l’épistémologie apprendra des choses sur la Préhistoire, et inversement. « Les techniques inefficaces ou dangereuses finissent certes par être abandonnées et sont donc peu visibles, mais elles n’en constituent pas moins dans l’histoire des techniques des étapes parfois indispensables à l’émergence d’une nouveauté » (p. 207) : cette phrase concerne les techniques utilisées par les hommes du passé, mais prise hors contexte, elle s’applique tout aussi bien au préhistorien.