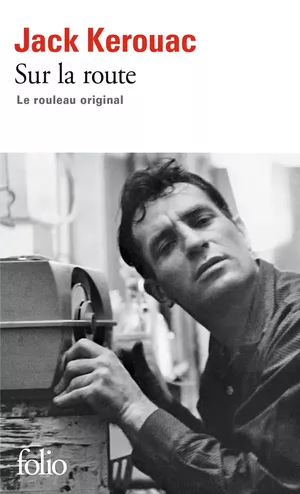Petite précision avant de me lancer dans cette critique : je n'ai pas lu la première édition, donc mon expérience de lecture est altérée par rapport à quelqu’un qui aurait lu les deux versions. Je me suis donc lancé dans l'inconnu, même si la réputation de cette œuvre ne m'est pas totalement méconnue. En effet, l'influence du livre sur le cinéma américain de la contre-culture de la fin des années 1960 et des années 1970 est sans précédent. Kerouac a inventé le genre du road-movie, et son style, avec ses accents libertaires, son lyrisme à la fois vibrant et rugueux, ses syncopes et ses envolées, cette prose spontanée et cette façon de s'inscrire dans le Mythe américain tout en le réinventant, font forcément écho à tout un pan du cinéma, celui du Nouvel Hollywood : d’Easy Rider, en passant par Vanishing Point et Macadam à deux voies.
La première chose passionnante dans l'œuvre de Kerouac, c'est sa façon d’avoir écrit tout son récit sur un long rouleau, donnant l'impression qu’il a écrit d’un seul trait, même si la réalité est plus complexe. Une fois déroulé, le rouleau ressemble à une route dont l'écriture n'a jamais lâché la cadence, car à chaque nouvelle page, ce n’est jamais la même chose. Le lecteur lit comme il suivrait la route, sans jamais vraiment comprendre quel est le but et la destination, et sans savoir ce qu’il y aura au prochain virage ou au bout de l'horizon. Le livre est donc ponctué d’anecdotes comme prises sur le vif, proches du mot le plus authentique (jusqu’à citer les vrais noms des personnes que le narrateur côtoie), où Kerouac parle principalement de son amitié avec Neal Cassidy, mais aussi de ses expériences liées à l’amour, au sexe, aux drogues, à ses boulots temporaires, ses rencontres hasardeuses avec des autostoppeurs, tous les États et les villes qu’il traverse dans de nombreux allers-retours, allant de New York jusqu’en Californie, de Denver au Texas, et même jusqu’au Mexique, ou encore toutes les boîtes et les bars qu’il fréquente à écouter du bop et du jazz tout en buvant jusqu’au bout de la nuit.
On suit donc avec enthousiasme, mais aussi parfois dans une atmosphère sombre composée de doutes, de désespoir et de mélancolie, puis dans un mouvement perpétuel, le mode de vie du vagabond désargenté qui sillonne l’Amérique sans rien savoir du lendemain, en vivant toujours dans le moment présent, à la manière d’un Charlot qui n’a besoin que de quelques sous pour vivre, contrairement à « la folie, la frénésie absolue de cette foire d’empoigne, où des millions et des millions de New-Yorkais se disputent le moindre dollar, une vie à gratter, prendre, donner, soupirer, mourir, tout ça pour un enterrement de première classe dans ces abominables villes-mouroir, au-delà de Long Island. Les hautes tours du pays, l’autre bout du pays, le lieu où naît l’Amérique de papier. »
Howard Cunnell, l’éditeur du rouleau original de Sur la route, compare le crépitement de la machine de Kerouac aux coups de pinceaux furieux de Jackson Pollock et des chorus de Charlie Parker à l’alto. Un style d’après-guerre que l’on juge sur la sueur, l’immédiateté et l’instinct, même si, encore une fois, la réalité est plus nuancée, car Kerouac a maintenu un processus élaboré avant de parvenir à ce rouleau. Mais ce dernier a révolutionné la littérature en déconstruisant la rigueur du roman classique pour « libérer son champ de conscience sur la page » (John Holmes). Inspiré par des auteurs comme Céline et Dostoïevski, dont on retrouve une forme de fièvre littéraire et de rythme effréné où le déroulement des pensées est toujours en avance sur la parole, puis cet argot poétique et cet art de l’oralité qui peuvent décrire une réalité des plus triviales à un mysticisme exalté, Kerouac se met totalement à contre-courant de la culture de la guerre froide, où primait une forme d’autosurveillance, d’autocensure et de conformisme où tout devait être politiquement correct. L’auteur veut retrouver un idéal américain élémentaire et primaire, parler de ce qui est à la marge, chercher cette foi en un lieu et une géographie qui se trouverait au bout de la route pour trouver un foyer et sa place dans la société, comme le faisaient les pionniers.
Kerouac tente également de réconcilier les peuples : des Afro-Américains qui cultivent durement la terre, aux Indiens qui étaient là bien avant eux, ou encore aux Mexicains autochtones qui s’éloignent de la vie consommatrice des Américains. Holmes décrit très bien cette idée en disant que « Kerouac, comme tous les Américains, est un nostalgique de l’Ouest, pour lui synonyme de santé, d’ouverture d’esprit, avec son rêve immémorial et d’allégresse. » Neal dit également à Jack : « Dieu existe, au-delà des états d’âme. Sur cette route où nous roulons, je suis convaincu que nous sommes pris en charge, et que toi, toi qui conduis la peur au ventre (j’avais horreur de conduire, je roulais prudemment), tu ne risques pas de partir dans le décor, la voiture roule toute seule, je peux dormir tranquille. En plus, on connaît l’Amérique, on est chez nous, ici. Partout où je vais, en Amérique, j’arrive à mes fins, parce que c’est partout pareil, je connais les gens, je sais ce qu’ils font. C’est un échange incessant, il faut louvoyer dans la douceur et la complexité incroyable du monde. » L’Amérique, sous la plume de Kerouac, devient un espace mystique où l’on peut échanger à l’infini, poussé par un souffle quasi divin et surnaturel et une sorte de frémissement à la jouissance pure.
Cette liberté folle que veut nous décrire l’écrivain se fait notamment par le biais de son ami bizarre et insaisissable, vivant de pépin, d’extase et de vitesse, Neal Cassidy. On peut comparer ce dernier au frère perdu et retrouvé de l’auteur, un cinglé semblable à un héros de western aventureux, une incarnation pure de l’éternelle jeunesse, un Dionysos ivre de la route, mais dont la philosophie folle de la vitesse en fait un destructeur incapable de maîtriser sa pulse, comme les tarés de jazz qui soufflent dans leur sax jusqu’à en crever d’épuisement. Le narrateur est fasciné par cet homme, il en éprouve une réelle amitié, mais son égoïsme ravageur en fait un être que Kerouac veut aussi fuir. En cela, cette relation peut faire penser à celle entretenue entre Ismaël et le capitaine Achab dans Moby Dick, car Ismaël tente de saisir à travers sa plume l’esprit fou d’Achab.
Neal est comme Achab : il poursuit un monstre, un monstre plus abstrait que le cachalot, mais le cachalot dans Moby Dick est un objet poétique qui représente toutes les questions métaphysiques possibles. Achab, dans sa furieuse vengeance, se poursuit finalement lui-même, et Neal, dans son ivresse chaotique et son énergie incandescente, se poursuit lui-même tout autant. Kerouac, à l’image d’Ismaël qui écrit une œuvre-monstre, tente donc également, avec son écriture très mobile, de faire le portrait impossible de Neal. C’était d’ailleurs l’une des raisons de ce livre : vouloir raconter ses virées avec Cassidy, car il voyait en lui un futur grand écrivain. Kerouac avait surtout l’intention de raconter le « vrai » (« parlé vrai, du fond de l’âme, parce que la vie est sacrée, et chaque instant précieux ») dans un style intime, discursif, rêveur et débridé, où se mêlent une innocence sincère et une empathie tendre. C’est comme si Kerouac se laissait affecter par les pulsions autodestructrices de Neal, à l’image de François dans Le Grand Meaulnes. Comme dans le livre d’Alain-Fournier (qui est cité dans Sur la route), Neal disparaît et réapparaît comme Meaulnes, et les itinérances de Kerouac se font au gré de celles de Neal, même quand il n’est pas avec lui directement.
On pense que Meaulnes est le héros du roman, mais finalement, c’est la quête intérieure de François qui est importante. Cela est similaire dans Sur la route, car c’est la quête de Jack qui est au cœur du roman et qui pose les questions fondamentales de l’œuvre : Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qu’être vivant alors que la mort est sans cesse présente ?* Peut-on être épanoui sans foyer et sans domicile fixe ? Qu’est-ce que la liberté ? Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu’il montrera son visage ? Peut-on vivre sans rêve ? Peut-on être heureux malgré les ténèbres et les traumatismes qui nous poursuivent, ainsi que par les fantômes qui nous traquent ? Comment se mesurer à la vastitude d’un monde trop grand pour nous et qui nous engloutit dans sa voûte ?Les réponses peuvent peut-être se trouver dans les paysages américains et sa magie (« lire le paysage américain en mouvement »), qui illuminent et amplifient la quête intérieure du personnage et son voyage initiatique, car « la route est la voie de la vie, la vie elle-même est une route. »
Mais il n’y a peut-être pas de réponse non plus, car c’est la quête de toute une vie que de chercher les réponses à nos questions. C’est pourquoi, sans le vouloir, Kerouac va devenir le chantre de toute une contre-culture qu’on appelle la Beat Generation (« les hipsters sordides de l’Amérique » pour citer l’écrivain), dans laquelle on retrouve des auteurs comme Allen Ginsberg ou William S. Burroughs, qui sont d’ailleurs dans Sur la route. Beat peut signifier plusieurs choses : être à bout de souffle, la pulsation de la musique jazz ou encore le battement du cœur, et c’est ce battement du cœur qui rythme cette ode sur la beauté de l’éphémère et de la liberté, et sur cette quête éternelle où « il reste toujours quelque chose de plus, un peu plus loin à aller », car « il n’y a pas de fin ».
*« Quelque chose, quelqu'un, un esprit, nous poursuivait tous à travers le désert de la vie, et nous rattraperait immanquablement avant que nous arrivions au Ciel. Naturellement, en y repensant aujourd'hui, je vois bien que c'est la mort et rien d'autre ; c'est la mort qui nous rattrapera avant qu'on monte au Ciel. La seule chose qu'on souhaite ardemment, tous les jours de la vie, celle qui nous fait soupirer, gémir, éprouver toutes sortes de bouffées de douceur écœurante, c'est la souvenir de la béatitude perdue qu'on a dû connaître dans le ventre maternel, et qui ne peut retrouver - mais on ne veut pas l'admettre - que dans la mort. Mais qui veut mourir ? »