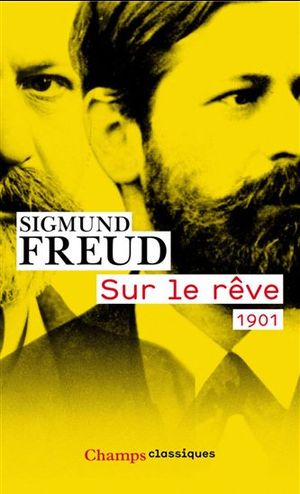La France est sans doute un des derniers pays où la « science » développée par Freud et appelée psychanalyse est encore considérée comme un domaine de la médecine. Est-ce parce qu’il allait entre la France et l’Autriche ? Parce qu’il était sûrement francophile à une époque où ses co-nationaux ne l’étaient sûrement pas beaucoup ? Je n’en ai pas la moindre idée et je ne crois pas que cela soit un chemin vers lequel j’ai envie d’aller.
Dans ce petit fascicule, Freud nous partage une synthèse d’une œuvre majeure bien plus dense, « l’interprétation du rêve ». Cet opuscule n’est qu’une entrée dans l’analyse freudienne d’un grand mystère que l’humanité a depuis son origine tentée d’expliquer : le rêve. Que dit Freud du rêve ?
Il n’existe plus de manière d’analyser les rêves à l’orée du XXe siècle, car à cette époque scientifique, imprégnée de positivisme, on ne peut plus accepter une explication mythologique du rêve. Il faut alors se tourner du côté de la science pour expliquer le contenu onirique. Il faut rappeler que la fin du XIXe siècle est un âge d’or pour la science. On parle de « fée électricité », les grandes expositions universelles nous montrent les moyens de locomotion de demain, l’aviation est en plein essor, les lendemains semblent être chantants.
On pourra associer l’écriture automatique des surréalistes dont le procédé consiste à écrire des mots à la suite d’autres selon la « volonté » de la conscience de l’auteur à l’approche d’analyse du rêve proposée par Freud. Sa technique était de demander une association d’idée et de mot à partir d’une peur et de tout noter, même les associations paraissant fantaisistes.
Ecriture d’une déception
Je dois avouer que j’ai eu beaucoup de mal à terminer ce court livre. Il est difficile de juger de la prose d’un auteur quand elle n’est qu’une traduction de celle-ci, mais c’est surtout sur la méthode de travail de Freud que je bute.
Ne le connaissant que pour sa théorie sexuelle et ses mythes, notamment celui d’Œdipe, très connus, j’avais peur que nous tombions rapidement dans des explications sexuelles des rêves. Il faut attendre le chapitre XII, ajouté en 1911, pour que Freud nous parle des désirs érotiques exprimés dans les rêves. C’est rassurant de voir qu’il n’a pas abordé l’entièreté de l’analyse onirique à la lumière de l’érotisme, mais ce chapitre est superflu. Voir dans une armoire un organe génital féminin me semble étrange. Bien entendu, quand on a envie de confirmer sa théorie, on va tenter de lui trouver des applications, peu importe que cela soit vrai ou non.
Ce livre m’a laissé un goût amer, la lecture a été très laborieuse, par mon aversion bien avant la lecture de la psychanalyse. D’autre part, parce que je n’ai eu aucune résonance avec cette lecture.
Quand l’on plonge dans un livre, que cela soit un roman, un essai ou autre, on éprouve des sentiments. Peu importe que ces sentiments soient positifs ou négatifs, mais la lecture doit laisser une trace, quelque chose. Or, cette lecture ne me laisse rien, absolument rien.
Cette critique littéraire n’en est pas vraiment une, c’est plutôt l’écriture d’une déception. Je ne m’attendais pas à grand-chose, sachant que j’ai un a priori très négatif de la psychanalyse, et je me désole d’entendre cette pseudoscience sur France Culture les dimanches soir. Mais n’étant pas responsable de la programmation, je ne peux que pester.
Aller y, ce n’est qu’un fascicule d’une centaine de pages et quelques. Entrez dans la théorie de Freud et si vous l’appréciez, vous aurez un pied dans son « À propos du rêve », qui lui sera bien plus conséquent.