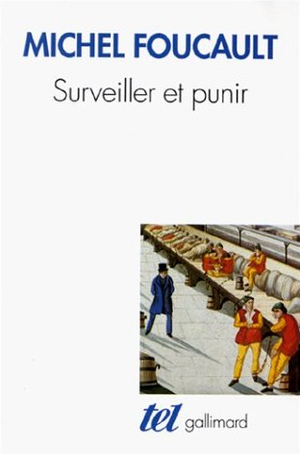Surveiller et punir, FOUCAULT
« Depuis 150 ou 200 ans que l’Europe a mis en place ses nouveaux systèmes de pénalité, les juges, peu à peu, mais pas un processus qui remonte fort loin, se sont donc mis à juger autre chose que les crimes : l’« âme »des criminels. » p.26
« La torture judiciaire, au XVIIIe siècle, fonctionne dans cette étrange, économie ou le rituel qui produit la vérité, va de pair avec le rituel qui impose la punition. Le corps interrogé dans le supplice, constitue le point d’application du châtiment et le lieu d’extorsion de la vérité. Et tout comme la présomption est solidairement un élément d’enquête et un fragment de culpabilité, la souffrance réglée de la question est à la fois une mesure pour punir et un acte d’instruction. » p.53
« L’économie des illégalismes s’est restructurer avec le développement de la société capitaliste. L’illégalisme des biens a été séparé de celui des droits. Partage qui recouvre une opposition de classe, puisque, d’un côté, l’illégalisme qui sera le plus accessible aux classes populaires sera celui des biens–transfert violent des propriétés ; que d’un autre, la bourgeoisie se réservera, elle, l’illégalisme des droits : la possibilité de tourner ses propres règlements et ses propres lois […]. Et cette grande redistribution des illégalismes se traduira même par une spécialisation des circuits judiciaires : pour des illégalismes de biens – pour le vol –, les tribunaux ordinaire et châtiment ; pour les illégalismes de droit –fraude, évasion, fiscal, opération, commercial, irrégulière,–, des juridictions spéciales, avec transaction, accommodements, amendes, atténuer, etc. » p.103-104
Les trois manières d’organiser l’article pouvoir de punir à la fin du XVIIIème siècle p.154-155
« En résumé, on peut dire que la discipline fabrique à partir des corps qu’elle contrôle […] une individualité qui est doté de quatre caractères : elle est cellulaire (par le jeu de la répartition spatiale), elle est organique (le codage des activités, elle est génétique (par le cumul du temps, elle est comminatoire par la (composition des forces). Et pour ce faire, elle met en œuvre quatre grandes techniques: elle construit des tableaux; elle prescrit des manœuvres; elle impose des exercices; enfin, pour assurer la combinaison des forces, elle aménage des « tactiques ». » p.196
« Finalement, l'examen est au centre des procédures qui constituent l'individu comme effet et objet de pouvoir, comme effet et objet de savoir. C'est lui qui, en combinant surveillance hiérarchique et sanction normalisatrice, assure les grandes fonctions disciplinaires de répartition et de classement, d'extraction maximale des forces et du temps, de cumul génétique continu, de composition optimale des aptitudes. Donc, de fabrication de l'individualité cellulaire, organique, génétique et combinatoire. Avec lui se ritualisent ces disciplines qu'on peut caractériser d'un mot en disant qu'elles sont une modalité de pouvoir pour qui la différence individuelle est pertinente. » p.225
« Les disciplines marquent le moment où s’effectue ce qu’on pourrait appeler le renversement de l’axe politique de l’individualisation. Dans des sociétés dont le régime féodal n'est qu'un exemple, on peut dire que l'individualisation est maximale du côté où s'exerce la souveraineté et dans les régions supérieures du pouvoir. Plus on y est détenteur de puissance ou de privilège, plus on y est marqué comme individu, par des rituels, des discours, ou des représentations plastiques.
Le « nom » et la généalogie qui situent à l'intérieur d'un ensemble de parenté, l'accomplissement d'exploits qui manifestent la supériorité des forces et que les récits immortalisent, les cérémonies qui marquent, par leur ordonnance, les rapports de puissance, les monuments ou les donations qui donnent survie après la mort, les fastes et les excès de la dépense, les liens multiples d'allégeance et de suzeraineté qui s'entrecroisent, tout cela constitue autant de procédures d'une individualisation « ascendante ». Dans un régime disciplinaire, l'individualisation en revanche est « descendante »: à mesure que le pouvoir devient plus anonyme et plus fonctionnel, ceux sur qui il s'exerce tendent à être plus fortement individualisés; et par des surveillances plutôt que par des cérémonies, par des observations plutôt que par des récits commémoratifs, par des mesures comparatives qui ont la « norme » pour référence, et non par des généalogies qui donnent les ancêtres comme points de repère; par des « écarts » plutôt que par des exploits. Dans un système de discipline, l'enfant est plus individualisé que l'adulte, le malade l'est avant l'homme sain, le fou et le délinquant plutôt que le normal et le non-délinquant. C'est vers les premiers en tout cas que sont tournés dans notre civilisation tous les mécanismes individualisants; et lorsqu'on veut individualiser l'adulte sain, normal et légaliste, c'est toujours désormais en lui demandant ce qu'il y a encore en lui d'enfant, de quelle folie secrète il est habité, quel crime fondamental il a voulu commettre. Toutes les sciences, analyses ou pratiques à radical « psycho », ont leur place dans ce retournement historique des procédures d'individualisation. Le moment où on est passé de mécanismes historico-rituels de formation de l'individualité à des mécanismes scientifico-disciplinaires, où le normal a pris la relève de l'ancestral, et la mesure la place du statut, substituant ainsi à l'individualité de l'homme mémorable celle de l'homme calculable, ce moment où les sciences de l'homme sont devenues possibles, c'est celui où furent mises en œuvre une nouvelle technologie du pouvoir et une autre anatomie politique du corps. Et si depuis le fond du Moyen Age jusqu'aujourd'hui « l'aventure » est bien le récit de l'individualité, le passage de l'épique au romanesque, du haut fait à la secrète singularité, des longs exils à la recherche intérieure de l'enfance, des joutes aux fantasmes, s'inscrit lui aussi dans la formation d'une société disciplinaire. Ce sont les malheurs du petit Hans et non plus « le bon petit Henri » qui racontent l'aventure de notre enfance. Le Roman de la Rose est écrit aujourd'hui par Mary Barnes; à la place de Lancelot, le président Schreber.
[…] L'individu, c'est sans doute l'atome fictif d'une représentation « idéologique » de la société; mais il est aussi une réalité fabriquée par cette technologie spécifique de pouvoir qu'on appelle la « discipline». Il faut cesser de toujours décrire les effets de pouvoir en termes négatifs : il « exclut », il « réprime », il « refoule », il « censure », il « abstrait », il « masque », il « cache ». En fait le pouvoir produit; il produit du réel; il produit des domaines d'objets et des rituels de vérité. L'individu et la connaissance qu'on peut en prendre relèvent de cette production.
Mais prêter une telle puissance aux ruses souvent minuscules de la discipline, n'est-ce pas leur accorder beaucoup?
D'où peuvent-elles tirer de si larges effets? » p.225 à 227
« En outre, la solitude doit être un instrument positif de réforme. Par la réflexion qu'elle suscite, et le remords qui ne peut pas manquer de survenir : « Jeté dans la solitude le condamné réfléchit. Placé seul en présence de son crime, il apprend à le haïr, et si son âme n'est pas encore blasée par le mal, c'est dans l'isolement que le remords viendra l'assaillir. » » p.274
« avec le travail « la règle s'introduit dans une prison, elle y règne sans effort, sans l'emploi d'aucun moyen répressif et violent. En occupant le détenu, on lui donne des habitudes d'ordre et d'obéissance; on le rend diligent et actif, de paresseux qu'il était. avec le temps, il trouve dans le mouvement régulier de la maison, dans les travaux manuels auxquels on l'a assujetti.. un remède certain contre les écarts de son imagina-ton'». Le travail pénal doit être conçu comme étant par lui-même une machinerie qui transforme le détenu violent. agité, irréfléchi en une pièce qui joue son rôle avec une parfaite régularité. La prison n'est pas un atelier: elle est, il faut qu'elle soit en elle-même une machine dont les détenus-ourmers sont à la fois les rouages et les produits; elle les « occupe » et cela « continuellement füt-ce dans l'unique but de remplir leurs moments. Lorsque le corps s'agite, lorsque Tespnt s'applique à un objet déterminé, les idées importunes s’éloignent, le calme renait dans l'âme? ». » p.281
« L'utilité du travail pénal? Non pas un profit; ni même la formation d'une habileté utile; mais la constitution d'un rapport de pouvoir, d'une forme économique vide, d'un
un appareil de production. » p.282
« La longueur de la peine ne doit pas mesurer la « valeur d'échange » de l'infraction; elle doit s'ajuster à la transformation « utile » du détenu au cours de sa condamnation. Non pas un temps-mesure, mais un temps finalisé. » p.283
« dès le départ, exercer un rôle technique positif, opérer des transformations sur les individus. Et pour cette opération l'appareil carcéral a eu recours à trois grands schémas : le schéma politico-moral de l'isolement individuel et de la hiérarchie; le modèle économique de la force appliquée à un travail obligatoire; le modèle technico-médical de la guérison et de la normalisation. La cellule, l'atelier, l'hôpital. La marge par laquelle la prison excède la détention est remplie en fait par des techniques de type disciplinaire. Et ce supplément disciplinaire par rapport au juridique, c'est cela, en somme, qui s'est appelé le « pénitentiaire ». » p.288
« Le corrélatif de la justice pénale, c'est bien sans doute l'infracteur, mais le corrélatif de l'appareil pénitentiaire, c'est quelqu'un d'autre; c'est le délinquant, unité biographique, noyau de « dangerosité», représentant d'un type d'anomalie. Et s'il est vrai qu'à la détention privative de liberté qu'avait définie le droit, la prison a ajouté le « supplement » du pénitentiaire, celui-ci à son tour a introduit un personnage en trop, qui s'est glissé entre celui que la loi condamne et celui qui exécute cette loi. Là où a disparu le corps marqué, découpé, brûlé, anéanti du supplicié est apparu le corps du prisonnier, doublé de l'individualité du « délinquant », de la petite âme du criminel, que l'appareil même du châtiment a fabriquée comme point d'application du pouvoir de punir et comme objet de ce qui est appelé aujourd'hui encore la science pénitentiaire. On dit que la prison fabrique des délinquants; c'est vrai qu'elle reconduit, presque fatalement, devant les tribunaux ceux qui lui ont été confiés. Mais elle les fabrique en cet autre sens qu'elle a introduit dans le jeu de la loi et de l'infraction, du juge et de l'infracteur, du condamné et du bourreau, la réalité incorporelle de la délinquance qui les lie les uns aux autres et, tous ensemble, depuis un siècle et demi, les prend au même piège. » p.295-296
« Car tout de suite la prison, dans sa réalité et ses effets visibles, a été dénoncée comme le grand échec de la justice pénale. […] la critique de la prison et de ses méthodes apparaît très tôt, dans ces mêmes années 1820-1845 […] Les prisons ne diminuent pas le taux de la criminalité : on peut bien les étendre, les multiplier ou les transformer, la quantité de crimes et de criminels reste stable ou, pis encore, augmente […] La détention provoque la récidive; après être sorti de prison, on a plus de chance qu'auparavant d'y retourner; les condamnés sont, en proportion considérable, d'anciens détenus […] La prison ne peut pas manquer de fabriquer des délinquants. Elle en fabrique par le type d'existence qu'elle fait mener aux détenus: qu'on les isole dans des cellules, ou qu'on leur impose un travail inutile, pour lequel ils ne trouveront pas d'emploi, c'est de toute façon ne pas « songer à l'homme en société; c'est créer une existence contre nature inutile et dangereuse »; on veut que la prison éduque des détenus, mais un système d'éducation qui s'adresse à l'homme peut-il raisonnablement avoir pour objet d'agir contre le vœu de la nature ? […] La prison rend possible, mieux, elle favorise l'organisation d'un milieu de délinquants, solidaires les uns des autres, hiérarchisés, prêts pour toutes les complicités futures […] Les conditions qui sont faites aux détenus libérés les condamnent fatalement à la récidive : parce qu'ils sont sous la surveillance de la police; parce qu'ils sont assignés à résidence, ou interdits de séjour; parce qu'ils « ne sortent de prison qu'avec un passeport qu'ils doivent faire voir partout où ils vont et qui mentionne la condamnation qu'ils ont subie'». La rupture de ban, l'impossibilité de trouver du travail, le vagabondage sont les facteurs les plus fréquents de la récidive. […] Enfin la prison fabrique indirectement des délinquants en faisant tomber dans la misère la famille du détenu: « Le même arrêt qui envoie le chef de famille en prison réduit chaque jour la mère au dénuement, les enfants à l'abandon, la famille entière au vagabondage et à la mendicité. C'est sous ce rapport que le crime menacerait de faire souche […] Depuis un siècle et demi, la prison a toujours été donnée comme son propre remède; la réactivation des techniques pénitentiaires comme le seul moyen de réparer leur perpétuel échec » p.308-312
« les sept maximes universelles de la bonne « condition pénitentiaire ».
1. La détention pénale doit donc avoir pour fonction essentielle la transformation de comportement de l'individu. […] Principe de la correction.
2. Les détenus doivent être isolés ou du moins répartis selon la gravité pénale de leur acte, mais surtout selon leur âge, leurs dispositions, les techniques de correction qu'on entend utiliser à leur égard, […] Principe de la classification.
3. Les peines, dont le déroulement doit pouvoir se modifier selon l'individualité des détenus, les résultats qu'on obtient, les progrès ou les rechutes. […] Principe de la modulation des peines.
4. Le travail doit être une des pièces essentielles de la transformation et de la socialisation progressive des détenus. Le travail pénal « ne doit pas être considéré comme le complément et pour ainsi dire comme une aggravation de la peine, mais bien comme un adoucissement dont la privation serait on ne peut plus possible ». […] Principe du travail comme obligation et comme droit.
5. L'éducation du détenu est de la part de la puissance publique à la fois une précaution indispensable dans l'intérêt de la société et une obligation vis-à-vis du détenu. […] Principe de l'éducation pénitentiaire.
6. Le régime de la prison doit être, pour une part au moins, controle et pris en charge par un personnel spécialise possedant les capacités morales et techniques de veiller à la bonne formation des individus. […] Principe du contrôle technique de la détention.
7. L'emprisonnement doit être suivi de mesures de contrôle et d'assistance jusqu'à la réadaptation définitive de l'ancien détenu. […] Principe des institutions annexes. »
p.314-315
« Au constat que la prison échoue à réduire les crimes il faut peut-être substituer l'hypothèse que la prison a fort bien réussi à produire la délinquance, type spécifié, forme politiquement ou économiquement moins dangereuse - à la limite utilisable - d'illégalisme; à produire les délinquants, milieu apparemment marginalisé mais centralement contrôlé; à produire le délinquant comme sujet pathologisé.
La réussite de la prison : dans les luttes autour de la loi et des illégalismes, spécifier une « délinquance ». » p.323
« A cela s'ajoutait une longue entreprise pour imposer à la perception qu'on avait des délinquants une grille bien déterminée : les présenter comme tout proches, partout présents et partout redoutables. C'est la fonction du fait divers qui envahit une partie de la presse et qui commence à avoir ses journaux propres*. Le fait divers criminel, par sa redondance quotidienne, rend acceptable l'ensemble des contrôles judiciaires et policiers qui quadrillent la société; il raconte au jour le jour une sorte de bataille intérieure contre l'ennemi sans visage; dans cette guerre, il constitue le bulletin quotidien d'alarme ou de victoire. Le roman criminel, qui commence à se développer dans les feuilletons et dans la littérature à bon marché, assume un rôle apparemment inverse. Il a surtout pour fonction de montrer que le délinquant appartient à un monde entièrement autre, sans relation avec l'existence quotidienne et familière. Cette étrangeté, ce fut d'abord celle des bas-fonds (Les Mystères de Paris, Rocambole), puis celle de la folie (surtout dans la seconde moitié du siècle), enfin celle du crime doré, de la délinquance de « haut vol » (Arsène Lupin). Les faits divers joints à la littérature policière ont produit depuis plus d'un siècle une masse démesurée de « récits de crimes » dans lesquels surtout la délinquance apparaît à la fois comme très proche et tout à fait étrangère, perpétuellement menaçante pour la vie quotidienne, mais extrêmement lointaine par son origine, ses mobiles, le milieu où elle se déploie quotidienne et exotique.
Par l'importance qu'on lui prête et le faste discursif dont on
'accompagne, on trace autour d'elle une ligne qui, en l'exaltant, la met à part. Dans cette délinquance si redoutable, et venue d'un ciel si étranger, quel illégalisme pourrait se reconnaître?... » p.334-335
« Dans cette société panoptique dont l'incarcération est l'armature omniprésente, le délinquant n'est pas hors la loi; il est, et même dès le départ, dans la loi, au cœur même de la loi, ou du moins en plein milieu de ces mécanismes qui font passer insensiblement de la discipline à la loi, de la déviation à l'infraction. S'il est vrai que la prison sanctionne la délinquance, celle-ci pour l'essentiel se fabrique dans et par une incarcération que la prison en fin de compte reconduit à son tour. La prison n'est que la suite naturelle, rien de plus qu'un degré supérieur de cette hiérarchie parcourue pas à pas. Le délinquant est un produit d'institution. Inutile par conséquent de s'étonner que, dans une proportion considérable, la biographie des condamnés passe par tous ces mécanismes et établissements dont on feint de croire qu'ils étaient destinés à éviter la prison. Qu'on trouve là, si on veut, l'indice d'un « caractère » délinquant irréductible : le reclus de Mende a été soigneusement produit à partir de l'enfant correctionnaire, selon les lignes de force du système carcéral généralisé. Et inversement, le lyrisme de la marginalité peut bien s'enchanter de l'image du « hors-la-loi », grand nomade social qui rôde aux confins de l'ordre docile et apeuré. Ce n'est pas dans les marges, et par un effet d'exils successifs que naît la criminalité, mais grâce à des insertions de plus en plus serrées, sous des surveillances toujours plus insistantes, par un cumul des coercitions disciplinaires. En un mot, l'archipel carcéral assure, dans les profondeurs du corps social, la formation de la délinquance à partir des illégalismes ténus, le recouvrement de ceux-ci par celle-là et la mise en place d'une criminalité spécifiée. » p.352-353
« Mais inversement, si les juges acceptent de plus en plus mal d'avoir à condamner pour condamner, l'activité de juger s'est multipliée dans la mesure même où s'est diffusé le pouvoir normalisateur. Porté par l'omniprésence des dispositifs de discipline, prenant appui sur tous les appareillages carcéraux, il est devenu une des fonctions majeures de notre société. Les juges de normalité y sont présents partout. Nous sommes dans la société du professeur-juge, du médecin-juge, de l'éducateur-juge, du « travailleur social »-juge; tous font régner l'universalité du normatif; et chacun au point où il se trouve y soumet le corps, les gestes, les comportements, les conduites, les aptitudes, les performances. Le réseau carcéral, sous ses formes compactes ou disséminées, avec ses systèmes d'insertion, de distribution, de surveillance, d'observation, a été le grand support, dans la société moderne, du pouvoir normalisateur. » p.355-356
« Si nous sommes entrés, après l'âge de la justice « inquisitoire », dans celui de la justice « examinatoire », si d'une façon plus générale encore, la procédure d'examen a pu si largement recouvrir toute la société, et donner lieu pour une part aux sciences de l'homme, un des grands instruments en a été la multiplicité et l'entrecroisement serré des mécanismes divers d'incarcération. Il ne s'agit pas de dire que de la prison sont sorties les sciences humaines. Mais si elles ont pu se tormer et produire dans l'épistémê tous les effets de bouleversement qu'on connaît, c'est qu'elles ont été portées par une modalité spécifique et nouvelle de pouvoir : une certaine politique du corps, une certaine manière de rendre docile et utile l'accumulation des hommes. Celle-ci exigeait l'implication de relations définies de savoir dans les rapports de pouvoir; elle appelait une technique pour entrecroiser l'assujettissement et l'objectivation; elle comportait des procédures nouvelles d'individualisation. Le réseau carcéral constitue une des armatures de ce pouvoir-savoir qui a rendu historiquement possibles les sciences humaines. L'homme connaissable (âme, individualité, conscience, conduite, peu importe ici) est l'effet-objet de cet investissement analytique, de cette domination-observation. » p.356-357
« Ceci explique sans doute l'extrême solidité de la prison, cette mince invention décriée pourtant dès sa naissance. Si elle n'avait été qu'un instrument de rejet ou d'écrasement au service d'un appareil étatique, il aurait été plus facile d'en modifier les formes trop voyantes ou de lui trouver un substitut plus avouable. Mais enfoncée comme elle est au milieu de dispositifs et de stratégies de pouvoir, elle peut opposer à qui voudrait la transformer une grande force d'inertie. Un fait est caractéristique : lorsqu'il est question de modifier le régime de l'emprisonnement, le blocage ne vient pas de la seule institution judiciaire; ce qui résiste, ce n'est pas la prison-sanction pénale, mais la prison avec toutes ses déterminations, liens et effets extra-judiciaires; c'est la prison, relais dans un réseau général des disciplines et des surveillances; la prison, telle qu'elle fonctionne dans un régime panoptique. » p.357
Conclusion :
« En 1836, un correspondant écrivait à La Phalange : « Moralistes, philosophes, législateurs, flatteurs de la civilisation, voici le plan de votre Paris mis en ordre, voici le plan perfectionné où toutes choses semblables sont réunies. Au centre, et dans une première enceinte : hôpitaux de toutes les maladies, hospices de toutes misères, maisons de fous, prisons, bagnes d'hommes, de femmes et d'enfants. Autour de la première enceinte, casernes, tribunaux, hôtel de police, tom dure des a usine, es pides Aux destre a faud, chambre des députés, chambre des pairs, Institut et Palais du Roi. En dehors, ce qui alimente l'enceinte centrale, le commerce, ses fourberies, ses banqueroutes; l'industrie et ses luttes furieuses; la presse, ses sophismes; les maisons de jeu; la prostitution, le peuple mourant de faim ou se vautrant dans la débauche, toujours prêt à la voix du Génie des Révolutions; les riches sans cœur... enfin la guerre acharnée de tous contre tous '. »
Je m'arrêterai sur ce texte sans nom. On est fort loin maintenant du pays des supplices, parsemé de roues, de gibets, de potences, de piloris; on est loin aussi de ce rêve que portaient les réformateurs, moins de cinquante ans auparavant : la cité des punitions où mille petits théâtres auraient donné sans cesse la représentation multicolore de la justice et où les châtiments soigneusement mis en scène sur des échafauds décoratifs auraient constitué en permanence la fête foraine du Code. La ville carcérale, avec sa « géopolitique » imaginaire, est soumise à des principes tout autres. Le texte de La Phalange en rappelle quelques-uns parmi les plus importants : qu'au cœur de cette ville et comme pour la faire tenir, il y a, non pas le « centre du pouvoir », non pas un noyau de forces, mais un réseau multiple d'éléments divers - murs, espace, institution, règles, discours; que le modèle de la ville carcérale, ce n'est donc pas le corps du roi, avec les pouvoirs qui en émanent, ni non plus la réunion contractuelle d’où naîtrait un corps à la fois individuel et collectif, mais une répartition stratégique d’éléments de nature et de niveau divers. Que la prison n'est pas la fille des lois ni des codes, ni de l'appareil judiciaire; qu'elle n'est pas subordonnée au tribunal comme l'instrument docile ou maladroit des sentences qu'il porte et des effets qu'il voudrait obtenir; que c'est lui, le tribunal, qui est par rapport à elle, extérieur et subordonné. Qu'en la position centrale qu'elle occupe, elle n'est pas seule, mais liée à toute une série d'autres dispositifs « carcéraux », qui sont en apparence bien distincts - puisqu'ils sont destinés à soulager, à guérir, à secourir - mais qui tendent tous comme elle à exercer un pouvoir de normalisation. Que ce sur quoi s'appliquent ces dispositifs, ce ne sont pas les transgressions par rapport à une loi « centrale », mais autour de l'appareil de production -- le « commerce » et l'« industrie» -, toute une multiplicité d'illégalismes, avec leur diversité de nature et d'origine, leur rôle spécifique dans le profit, et le sort différent que leur font les mécanismes punitifs. Et que finalement ce qui préside à tous ces mécanismes, ce n'est pas le fonctionnement unitaire d'un appareil ou d'une institution, mais la nécessité d'un combat et les règles d une stratégie. Lue, par conséquent, les notions d'institution de répression, de rejet, d'exclusion, de marginalisation, ne sont pas adéquates pour décrire, au centre même de la ville carcérale, la formation des douceurs insidieuses, des méchancetés peu avouables, des petites ruses, des procédés calculés, des techniques, des « sciences» en fin de compte qui permettent la fabrication de l'individu disciplinaire. Dans cette humanité centrale et centralisée, effet et instrument de relations de pouvoir complexes, corps et forces assujettis par des dispositifs d'« incarcération» multiples, objets pour des discours qui sont eux-mêmes des éléments de cette stratégie, il faut entendre le grondement de la bataille. »
p.358-360