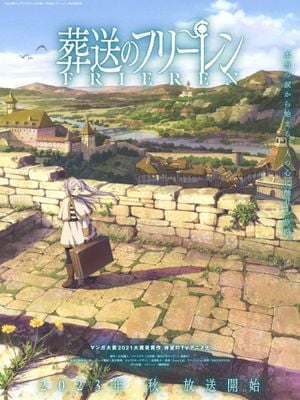Citation de Jacques Bénigne Bossuet : “Qu'est-ce que mille ans, puisqu'un seul moment les efface?”
Il est amusant de voir la relation presque oxymorique entre Sousou no Frieren et le genre de la fantaisie dont elle fait partie. On en viendrait presque à se demander si l’indifférence de Frieren pour la magie ne déteindrait pas sur le monde qui l’entoure ou tout du moins dans notre rapport à l’œuvre. Il est donc intéressant de parler de Sousou no Frieren en le mettant en perspective du genre qu’elle embrasse. Cette analyse sera donc segmentée par les grandes thématiques de la fantaisie, énumérée par le site internet « BnF fantasy » qui détermine 4 grands axes avec lesquels il est nécessaire de composer pour créer le récit de fantaisie.
I. Le héros, la quête, le monstre
Autrefois les hommes chantaient en coeur autour d'une table ; maintenant c'est un seul homme qui chante, pour la raison absurde qu'il chante mieux. Si la civilisation l'emporte, bientôt un seul homme rira, parce qu'il rira mieux que les autres.
Gilbert Keith Chesterton
1. Le héros
Si le principe de créer un personnage avec des traits héroïque n’est pas propre à la fantaisie, il suffit de remarquer avec les Isekais (qui transportent un être humain de notre monde dans celui d’un héroïque-fantaisie, généralement pour faciliter l’identification du spectateur ; enfin c’est surtout culturel, personnellement ça me sort de l’histoire plus qu’autre chose), qui font généralement de leur personnage un héros, qui se distinguera des autres par sa puissance, sa bonté et/ou sa bravoure (c’est d’ailleurs cette facilité scénaristique qui gangrène le genre de la fantaisie et fait de l’Isekai un genre souvent peu apprécié).
Non content de ne pas faire de Frieren le héros (dans le sens fantastique) de l’histoire, Sousou no Frieren va en plus créer un autre héros pour empêcher Frieren de prendre sa place. Dès le début du premier épisode on comprend que c’est Himmel qui va endosser la figure héroïque. Les épisodes suivant nous montrent bien que c’est lui qui passe les âges et non Frieren, qui malgré sa présence sur certaine statue n’est quasiment jamais reconnue. On aurait pu penser que le montrer rapidement vieux puis mort (Il est le premier des 4 à mourir) allait permettre de ne faire d’Himmel qu’un point d’accroche qui lancerait une autre légende, peut-être même plus grande, mais non. Peu importe où l’histoire nous mène, et même des lustres après sa mort, on se rappelle encore les agissements d’Himmel le brave. C’est d’ailleurs la mort d’Himmel qui marque la chronologie de l’œuvre (on compte en année après sa mort), tant bien même l’histoire est (directement tout du moins) plus impactée par d’autres personnages comme Heiter. Tous les flash-backs n’aident pas particulièrement à amener Frieren au même niveau d’héroïsme qu’Himmel car on découvre finalement qu’elle ne fait que marcher dans ses pas, cassant le caractère mystérieux de la quête (Frieren ayant déjà fait le chemin) et donc son côté épique. De plus ces mêmes flash-backs permettent au spectateur de découvrir une version plus intime d’Himmel qui malgré des défauts (notamment son arrogance) et ses échecs (comme avec les démons) et sous son air naïf et débonnaire, montre en réalité une curiosité, une sagesse, une bonté mais aussi une force et une bravoure sans faille. Himmel est le héros, car même dans son être profond il se montre digne du respect que lui porte Frieren. Mais ce qui fait d’Himmel un héros absolu et inégalable reste les révélations quant à son épée. En effet son épée légendaire, «l’Epée du Héros » est en réalité une fausse, le héros n’étant apparemment pas digne de sortir la vraie du rocher. Himmel n’est pas le plus grand des héros parce que c’était écrit mais parce qu’au constat que ça ne l’était pas, il a décidé de rester d’être un héros. C’est à se demander si ce n’était finalement pas l’épée qui se trouvait indigne d’Himmel. Cette idée du héros vient en opposition à la technique facile de l’élu d’une ancienne prophétie et fait d’autant plus rayonner Himmel le Brave qui accompagne presque de par son aura, le second voyage de Frieren.
A côté de ça, Frieren est limite en opposition avec ce qu’incarne le héros. Elle n’a pas vraiment de progression (tout du moins sur le plan physique) lors de ses voyages, étant déjà au début de la quête d’Himmel sans doute la deuxième plus grande mage de tous les temps. BnF Fantasy décrit l’archétype du héros d’héroïque-fantaisie comme « un peu naïfs, plein de bons sentiments, confiants de nature, peu à même d'abuser de leur autorité » (Dans l’article : Des héros forgés par leur quête par Florian Besson). Frieren est tout ce qu’il y a de plus opposé à cette description. Elle est cynique, souvent indifférente, peu sentimentale, universitaire mais aussi curieuse et mature. De plus, l’œuvre appuie sur les codes du genre pour nous le faire ressentir, le héros est plus souvent un chevalier, et le rôle du mage est plus souvent délégué au second plan. Mais d’un autre côté, elle n’occupe pas non plus le rôle du vieux maître, de par son comportement limite enfantin (ex : ce n’est pas une lève tôt, elle propose des cadeaux peu orthodoxes, elle est gênée pour des futilités…), et ses compétences (Sa plus grande faiblesse étant une erreur de jeunes mages, sa faculté à toujours se prendre les mimics sur la route et paradoxalement sa longévité peut être source de faiblesse, comme on le voit dans le dernier épisode elle apprend moins vite de nouveaux sorts que les jeunes qui ont baigné dans ces nouveaux sorts construits au fil des siècles). Elle occupe plus le rôle de spectateur du monde que l’on découvre, qu’elle étudie pour ne pas s’ennuyer à passer les lustres. Elle n’est pas non plus insensible à ce qui se passe, mais son rapport avec le reste du monde est calme et mature. La relation qui unit les deux est également peu conventionnelle. L’auteur Kanehito Yamada n’est pas tombé dans la facilité de réalisé une romance calquée sur une princesse en détresse et son chevalier servant. Frieren de par sa race d’Elfe est la plus vieille, la plus expérimentée et la plus mature des deux. Elle sauve Himmel grâce à la magie quand il était encore un enfant perdu dans la forêt, et cet acte tue d’une certaine façon autant la dame en détresse que le chevalier servant. C’est pourtant Himmel qui révèlera les failles émotionnelles de Frieren à sa mort lui faisant prendre conscience de l’importance de la vie et du monde qui l’entoure. Frieren et Himmel ont chacun occupé ce rôle de chevalier servant vis-à-vis de l’autre mais en dehors du voyage qu’ils ont vécu en commun. Cette position qu’on peut estimer novatrice même si ce n’est pas la première œuvre à présenter une femme comme indépendante et forte. De plus cette position permet à Frieren d’exister en tant que femme (ou elfe mais on se comprend) à part entière et non en tant que personnage féminin remplaçant un rôle masculin. Si bien que je ne me suis rendu compte (de manière plus intellectuel) tout de suite que le personnage central de l’œuvre était une femme. Frieren offre une belle représentation de la femme (en réalité tous ses personnages féminins mais je n’aborderai pas l’œuvre à travers ce prisme car ça risquerai de demander une troisième partie) car il rend sa position de protagoniste central de l’œuvre normal et non exceptionnelle.
Frieren n’est pas la seule à sortir des codes attendus. De par sa nature elfique, l’espérance de vie de notre protagoniste tend vers l’infini. Ce qui donne l’occasion de présenter pleins de personnages différents à des époques différentes. On peut même dire qu’elle est, à l’instar d’un Astérix, l’occasion de mettre une panoplie de personnages en valeur. A commencer par Himmel qui comme dit précédemment est assez arrogant et peu émotif malgré sa sagesse et sa bienveillance. Deux éléments plutôt assimilables à un faux héros trop sûr de lui qui serait remis à sa place par un vrai héros, plus puissant et plus humble. Heiter joue le rôle d’un prêtre pêcheur, ici par ses soucis d’alcool. Son comportement et les commentaires pinçant de Frieren (« prêtre de pacotille »), ne l’a pas empêché de recueillir et d’élever la jeune Fern, chose attendu de l’église qui s’occupe des plus faibles. Fern joue elle le rôle de l’apprenti, du premier apprenti de Frieren même. Elle combine à la fois curiosité et maîtrise de la magie avec un sale caractère et une difficulté à exprimer ses sentiments, rendant presque Frieren plus « Humaine ». Elle est également très gourmande et un peu en forme, mais cet élément n’est jamais fétichisé. On peut même dire que la série ne sexualise pas ses personnages. Il est d’ailleurs amusant que l’un des rares moments « érotique » proviennent d’elle (voyeurisme) et non de Stark qu’elle accuse souvent d’être un dépravé. La question du rapport élève-maître est vite balayé. Fern bien que moins puissante au comportement le plus mature de la bande (surtout si on enlève son sale caractère). A la fin de la saison 1, étant donné les derniers combats, on perçoit qu’il y a plus ou moins un rapport égal à égal entre les deux, même si Frieren restera toujours le maître de par sa longévité et surtout par l’écart de niveau démontré par son doublé à la fin de la série. C’est d’ailleurs amusant de les avoir fait suivre un même schéma narratif, les deux étant trop occupées à la magie pour s’occuper de ceux qu’elles aiment (Himmel comme Heiter). Pour les complété on ne retrouve pas un chevalier qui de par sa posture aurait fait tache ou un prêtre qui aurait fait redite avec la magie mais un guerrier avec une grosse hache qui ne serait en réalité pas beaucoup plus maniable que l’épée de Cloud. Malgré sa position de héros, Stark est menteur, fainéant et peureux. Son statut de garde du corps est d’ailleurs assez étrange. La majorité des combats se passent (pour l’instant) entre mage et sans qu’il n’exerce une influence majeure sur la réussite des opérations. Il est cependant paradoxalement indispensable à l’histoire et à l’équipe, en démontre le parallèle de l’épisode 6 ou le dragon qu’il combat se révèle aussi terrifié que lui de l’affronter.
Comme dit précédemment, excepté Himmel (et encore) qui est mort bien avant le déroulement de l’histoire. Il n’y a pas de personnage qui retient plus l’attention qu’un autre. La légère exception étant Frieren car c’est son personnage qui relie tous les autres. Malgré leurs défauts réels et apparents, les personnages cités plus hauts, sont tous plutôt appréciés par le public pour leur bonté sincère et naturelle. Cela permet à la série de nous proposer des personnages sortant des archétypes attendus, tout en les rendant attachant. Ce point parfaitement maîtrisé de la série est important. A l’inverse de beaucoup d’histoire de fantaisie la série se concentre plus sur ses personnages que le monde l’entourant.
2. La quête
Le tour de force de la série est bien sûr de faire de Frieren une elfe, qui est une race dont l’espérance de vie tend vers l’infini. La série aime bien dire que l’aventure de 10 ans avec le groupe d’Himmel a duré moins d'un centième de sa vie. C’est en réalité beaucoup, beaucoup moins d’un centième, Frieren ne semblant avoir pris qu’un ou 2 ans tout au plus en 1000 ans. Cela permet à l’histoire, en utilisant des flashbacks, de s'étendre sur plus d’un millénaire. Jouant donc autant sur le déplacement géographique des personnages que sur leur déplacement temporel. Si on excepte les passages avec les mages Serie et Flamme (qui marquent le début des apprentissages de la magie de Frieren), l’histoire se concentre sur le parallèle entre le premier et le second voyage de Frieren à l’extrémité septentrionale du continent.
La quête des deux groupes de Frieren est sensiblement la même : se rendre sur les terres du roi démon et l’achever. La première quête (celle d’Himmel et de ses compagnons) a cependant un aspect beaucoup plus héroïque que la deuxième, qui ressemble plus à un épilogue pour en finir pour de bon et au passage, essayer de revoir l’âme d’Himmel. Dans les deux cas, la quête du roi démon est un MacGuffin. Elle est l’excuse du départ à l’aventure, qui n’est certes pas apparu dans la fantaisie mais qui s’est véritablement institutionalisé au sein du genre. Je soupçonne même l’auteure d’avoir volontairement gardée un nom aussi cliché (qui déteint avec l’émancipation des codes opérés par l’œuvre) un peu pour exposer au spectateur la "futilité" de l’objectif de cette quête. L’utilisation du terme "roi démon" a également dans la sphère culturelle nipponne une valeur similaire au Graal dans les livres de fantaisie moyenâgeux. C’est un peu l’objectif ultime. La série d’animation Konosuba (un pastiche d’Isekai, un sous genre de fantaisie surreprésenté dans la sphère culturelle nipponne) en joue d’ailleurs beaucoup avec des personnages qui, une fois riches, abandonnent leur fameuse quête de tuer le roi Démon pour se reposer sur leurs lauriers.
La série joue sur 2 aventures, la première se terminant au premier épisode et la deuxième commençant au deuxième. Outre la mélancolie apportée par la fin de cette première aventure que nous n’avons pas connue, le premier épisode apporte également les regrets d’une Frieren dont le comportement détaché a fini par se retourner contre elle. On aurait pu craindre que le climax émotionnel du personnage principal de l’œuvre se passe dès le premier épisode. Il n’en est rien. Ce sont les pleurs de Frieren qui lui font commencer son parcours initiatique, celle-ci n’ayant pas su complètement porter l’importance de ses compagnons et de l’importance de leur voyage durant la quête d’Himmel. Toute la suite de l’œuvre va avoir pour objectif de nous faire comprendre pourquoi un personnage si indifférent au monde qui l’entoure s’est mis à pleurer le jour de la mort d’Himmel le Brave. Bien plus que le roi démon, c’est le fantôme d’Himmel qui trace sa route, au propre comme au figuré, son âme se trouvant à l’extrémité septentrionale du royaume au même titre que la demeure du seigneur démon. Le parallèle temporel entre les 2 quêtes est refoncé par la façon dont ils sont racontés. Plus le temps passe plus la quête d’Himmel se donne des airs de légende, s’inscrivant dans une mythologie partiellement connue de tous. Himmel arrive à s’inscrire ainsi dans une mythologie en prenant la place d’un héros accomplissant ce que tout le monde pensait jusque-là impossible. Il faut cependant ne pas omettre que même dans sa quête, Himmel se détache des codes de l’héroïque fantaisie. Dans l’article : « Des héros forgés par leur quête » de Florian Besson il explique bien que les héros « n'ont pas choisi de s'embarquer dans ce voyage au long cours, périlleux et éprouvant, mais ne peuvent s'y dérober, vu l'importance des enjeux ». Ce n’est pas le cas de la troupe d’Himmel qui choisit de partir, car malgré la présence du danger celle-ci n’est jamais ressenti et donc n’a pas cet aspect imminant. Comme pour l’histoire de l’épée, cet élément scénaristique vise à embellir le caractère héroïque d’Himmel qui a choisi lui-même de partir s’opposer à l’adversité. La force du récit du présent est quant à lui d’allier une certaine mélancolie avec la joie de la découverte. A noter que la mélancolie est principalement ressentie par le spectateur. Frieren demeurant à son habitude la plupart du temps impassible, avec l’air de voir les choses sans regrets (si on excepte l’épisode 1). Elle ne quitte pas les gens qu’elle rencontre pour la deuxième fois sur son parcours avec mélancolie (tant bien même ce serait un adieu). C’est dû à sa vision du temps et sa longévité mais aussi aux enseignements d’Himmel qui disait ne pas vouloir un adieu solennel qui viendrait casser l’ambiance de la péripétie. La joie de la découverte est bien sûr plus permise par les points de vue de Stark et Fern.
Comme dans la majorité des œuvres de fantaisie, la quête principale cache d’autres quêtes "secondaires". Déjà des quêtes secondaires personnelles. Frieren veut revoir l’âme d’Himmel, Fern veut rester avec Frieren et devenir meilleure en magie, Stark veut devenir un héros avant de revoir son maître, Sein veut retrouver son ami perdu et rencontrer une femme âgée. Les plus importantes restent cependant les quêtes secondaires géographiques. Ce sont celles sur lesquels l’œuvre porte le plus d’attention et offre une réflexion là-dessus. En effet, juste regarder des gens marcher pendant 10 ans serait vite ennuyeux. C’est pourquoi la fantaisie est connue pour créer des petites péripéties parallèles qui font évoluer nos personnages. Cette progression narrative donne à l’objectif final un air d’épreuve de validation des acquis comme le serait une évaluation à l’école. L’œuvre embrasse ce schéma de narration tout en jouant avec les codes. Déjà dans son exécution. Toutes les petites aventures rejoignent la quête d’Himmel, mais seul 2 moments rejoignent l’objectif du roi démon (dont on ne connait même pas le visage) : la fin des flash-backs (ou on annonce à Frieren son importance dans le combat contre le mal) et le combat contre Aura (dans une moindre mesure celui contre Qual). Toutes les quêtes ne sont pas d’ailleurs qualifiables d’épiques (nettoyer une plage, chercher une fleur…). Elles trouvent cependant toutes un intérêt, soit un apprentissage pour Fern, Stark ou un personnage secondaire (l’importance d’avoir une passion dans l’épisode 2, l’importance de la figure du héros dans l’épisode 6…), soit en rappelant à Frieren un événement qui aurait dû lui apprendre quelque chose. Ce sont aussi des quêtes portées par les particularités d’une zone, jouant notamment sur la gastronomie et dans une moindre mesure sur la culture (la signification du bijou offert à Fern par Stark). C’est un véritable parti pris de Keiichirō Saitō qui appuie sur ses moments de calme autant que sur les moments difficiles, rendant des petits moments du manga très populaire comme le bal d’Orden qui approfondit la relation entre Fern et Stark mais aussi le passé de ce dernier et sa relation avec son père (scène amplifiée lors de l’adaptation mais on y reviendra plus tard). Grâce à la justesse d’écriture des personnages et de leurs imperfections apparentes, les spectateurs pardonnent à Frieren son manque de dynamisme par moment, car l’évolution du groupe est rendue plus important que l’évolution de l’histoire. De plus, le rythme relativement calme de l’œuvre porte ses ambitions temporelles. Comme Frieren on finit par avoir du mal à percevoir son écoulement. Le sujet des quêtes secondaires est enfin traité par Himmel via différents flash-backs. Sur les habitants d’abord. Frieren dit, à la fin de la saison que « ce sont ces petites attentions qui ont changé le monde », mettant sur un pied d’égalité sa victoire sur le roi démon (bravoure) et son soutien aux habitants des régions qu’il a traversé (bonté). Ce flash-back permet à Himmel d’embrasser encore un peu plus l’archétype du héros. Sur la quête ensuite, avec l’idée du donjon. Cette aventure étant l’œuvre de sa vie, il veut savourer chaque petits instants, chaque salle de chaque donjon. Ce comportement est presque plus proche d’un joueur de Donjons et Dragons. C’est un peu un paradoxe de Frieren, de traiter l’œuvre de manière beaucoup plus sérieusement que le font ses personnages. Cela permet d’apporter de la légèreté à l’œuvre sans pour autant détruire son propos. Cette vision de la quête va à contrecourant avec l’attitude détachée de Frieren au début de l’œuvre, mais elle finira par l’embrasser (Donjon de l’épreuve) par la suite. A sa manière, la blague récurrente des mimics va dans ce sens, car il démontre que Frieren ne souhaite manquer aucun coffre (même si ce n’est pas présenté ainsi dans l’œuvre). Il est aussi amusant de voir que l’approche de Frieren vis-à-vis de la magie est de moins en moins universitaire et de plus en plus "par passion".
la quête en elle-même compte davantage que son accomplissement, le voyage plus que la destination et la recherche plus que la possession de l'objet recherché.
Florian Besson, « Des héros forgés par leur quête »
3. Les monstres
Ne sera pas ici considéré comme monstres les sociétés humanoïdes (Démons, nains, elfes…) qui seront traités dans la partie II : Construction d’un monde imaginaire. Contrairement à la majorité des œuvres de fantaisie, Frieren ne va pas (trop) jouer avec la faune et la flore locale, préférant se concentrer sur les interactions entre "Humanoïdes". Les monstres n’occupent pas une place fondamentale et ne constituent qu’une petite partie des péripéties qu'affrontent la troupe de Frieren. Les monstres sont certes rares dans l’œuvres, mais servent tous un intérêt narratif. C’est le cas du fantôme qui rappelle Heiter à Fern peut après sa mort, du monstre volant qui permet à l’histoire de se concentrer sur la bague donnée à Frieren par Himmel, ou du Spiegel qui est l’occasion pour Fern d’affronter son maître sans que ce soit un réel affrontement. La plupart des monstres servant un but, ils sont tous relativement peu commun, à l’instar de la Stille qui ressemble au Vif d'or d’Harry Potter qu’un réel monstre de fantaisie.
Les seuls monstres qui fassent très fantaisie reste le dragon que combat Stark au début de l’œuvre et les différents mimics croisés au cours de l’œuvre. L’image du mimic, que nous occidentaux connaissons surtout via Dark Souls, demande aux joueurs de faire preuve de prudence. Faire tomber Frieren dans tous les mimics est à la fois un ressort comique et un énième moyen de casser l’image trop détaché de son personnage principal. Mais il devient aussi, au fil de l’histoire un prolongement de la philosophie d’Himmel qui consiste à tout vivre quitte à tomber sur certaines embûches. Pour le dragon, ça n’a pas été nécessaire de créer un autre monstre dans ce cas car l’idée était d’associer l’image de Stark à celle d’un héros traçant un dragon, pour nuancer son personnage. Encore une fois, Florian Besson dans son article « Des héros forgés par leur quête » écrit : « le monstre n'est qu'un faire-valoir du héros, qui prouvera sa prouesse en l’abattant, ou, à la limite, en le domestiquant, répétant le geste des nombreux saints médiévaux qui tuent ou domptent les dragons ». Dans tous les cas, le monstre ne jouit quasiment jamais d’une approche mythologique, mais scientifique, limite de la manière d’un Cuvier essayant de décrire une espèce qu’il ne comprend qu’à moitié. C’est cette approche par la connaissance qui caractérise le rapport des personnages à leur monde.
II. La construction d'un monde imaginaire
Les contes de fées ne révèlent pas aux enfants que les dragons existent. Les enfants le savent déjà. Les contes de fées révèlent aux enfants qu'on peut tuer les dragons.
Gilbert Keith Chesterton
1. Un monde imaginaire qui rayonne au milieu des autres
Les récits de fantasy se caractérisent souvent par la profusion de détails sur les mondes dans lesquels ils se déroulent. Des mondes qui développent l’imaginaire des lecteurs.
Anne Besson dans « Un monde imaginaire à inventer »
La construction du monde dans la fantaisie est tellement centrale qu’il est limite étonnant de n’en parler qu’au bout de 3250 mots. C’est dû au fait que j’aborde l’œuvre par le prisme du site Bnf en respectant l’ordre mis en place par le site, mais aussi parce que cet ordre fonctionne très bien avec l’œuvre Sousou no Frieren. En effet à l’instar des monstres, le monde sert plus ici de scène à nos personnages que de réels moteurs de merveilleux comme il est souvent mis en place dans les œuvres du genre. Cela démarque l’œuvre, contrairement aux seigneurs des anneaux qui rappelle tout de suite la terre du milieu, Frieren nous rappelle avant tout ses thématiques et ses protagonistes. Si bien qu’il n’est pas finalement si étrange de commencer à traiter l’œuvre par ses personnages. Ce n’est pas pour autant que le monde de Frieren n’est pas intéressant à analyser.
La première chose que l’on peut dire du monde est qu’il ne s’inscrit pas dans la ligné nippone de la fantaisie. Sousou no Frieren lorgne en réalité plus sur la fantaisie arthurienne et occidentale en général. Elle le montre notamment en s’opposant sans cesse aux codes établis par le plus grand sous genre de fantaisie de l’archipel : l’Isekai. Ça se voit très bien avec son rythme très posé (le seigneur démon n’est qu’une ombre souvent peu perceptible) qui calme un pseudo héroïsme né d’une urgence capitale. Ses thématiques également, qui sont rares et en opposition avec le sous genre, comme la valeur du temps là où celui des Isekai semble figé ou encore l’indifférence de Frieren face à l’implication centrale du héros dans son monde. Il est d’ailleurs amusant de voir que les personnages caractéristiques de l’Isekai comme Linie qui est une fille toute frêle qui tient une hache 40 fois trop grande ou Aura qui flirt avec le lolicon soit des démons que Frieren combat. Ça ne veut pas pour autant dire que Frieren s’est complètement détaché de l’emprise de sa culture sur l’œuvre. Par exemple, par la vision fantasmée de l’Europe centrale que l’on voit très bien avec l’architecture ou la vision de l’aristocratie durant le bal. La présentation des donjons fait également très jeu vidéo (avec sa carte, ses étages, ses pièces secrètes…) et donc les codes de l’Isekai. Mon influence de l’œuvre préférée, plus discrète et intéressant, reste la phrase éponyme de l’épisode 28: « Nos retrouvailles en deviendraient gênantes » qui est en réalité une vision du monde plutôt d’Asie de l’Est et Centrale qu’on retrouve notamment dans la série de manga « Bride Story ». Anne Besson dans son article « Un monde imaginaire à inventer » pour BnF parlait également de l’écrivain Umberto Eco qui a théorisé dans Lector in Fabula (écrit en 1979 mais publié en 1985) que « l’accès à la fiction avait recours à "l’encyclopédie" du lecteur (l’ensemble des connaissances qu’il pourra solliciter pour remplir les blancs du texte). Mais dans les genres de l’imaginaire, cette encyclopédie d’un autre monde est en partie à construire ». J’ajouterai que dans la fantaisie cette encyclopédie est construite également par d’autres œuvres du même genre, et Sousou no Frieren ne se cache de s’inspirer de l’imaginaire de Tolkien et de George R.R. Martin pour expliquer moins de choses et donc être moins verbeux. L’œuvre s’inscrit également dans un genre occidental par sa pudeur (très peu voire pas de fan service). Je ne dis pas qu’en occident on n’aime pas mettre des personnes (et surtout des femmes) dénudées mais les grandes œuvres de fantaisie occidentale comme les légendes arthuriennes ou les récits de Tolkien (Le dragon combattu par Stark joue beaucoup avec l’image de Smaug) dont s’inspire Frieren sont relativement chastes. L’œuvre a bien fait attention à n’ajouter aucun élément qui ferait rappeler le japon ou l’Asie en général à son histoire comme une arme (avec notamment le katana), l’architecture (les pagodes et autres temples) ou la religion (Bouddhisme et Shintoïsme). Le shintoïsme se ressent cependant dans les valeurs de l’œuvre, notamment dans l’acceptation de l’incompréhension et un émerveillement quant à la beauté, surtout naturel. Sousou no Frieren s’appuie aussi sur la langue allemande pour nommer ses personnages et ainsi leur donner une aura beaucoup plus européenne.
2. Un lexique mystérieux mais abordable
Il existe donc toute une partie de la compréhension du monde de Frieren qui est cachée aux non germanophones. Nous allons ici la révéler par un petit exercice linguistique. Je suis cependant conscient que cela puisse sembler lourd et invite celles et ceux qui lisent cette critique ne voulant pas s’y intéresser à simplement sauter le paragraphe. De toute façon personne ne lira jamais ce texte, je pourrai finir ce paragraphe en dressant la liste des présidents de la troisième république durant le 20eme siècle que personne ne me le ferait remarquer. Le point qui ressort le plus souvent c’est la traduction des noms des personnages. Par exemple les noms qui ramènent de manière terre à terre à un de ses traits. Comme le comportement d’un personnage avec Fern se traduit par éloigner, Heiter enjouer (rappelant son alcoolisme), Denken réflexion (sans doute le mage le plus stratège), Ubel fléau/mauvais, Edel Raffiné/chic (La mage avec le comportement le plus aristocrate), Wirbel Agitation, Genau parfaitement (pour son côté académique) et Sense faux car elle est à l’inverse compliqué à cerner. Le nom du personnage peu également trahir sa fonction ou son pouvoir comme avec Stark (=force), car malgré son comportement c’est sa qualité de guerrier qui prédomine, Linie (=tracé) et Draht (=fil de fer) qui sont des traductions de leur pouvoir, Hesen (=fer) collant au stéréotype du nain, Falsh (=injuste) pour rappeler que Serie lui a volé son épreuve mais aussi qu’il ne pourra pas rester auprès d’elle indéfiniment, Lernen (=apprentissage) car il n’est pas défini autrement que comme l’apprenti de Serie, Land (=terrestre), Methode (=méthode) pour son choix original de ne pas se spécialiser dans une forme de magie, Aura (=Aura) pour son pouvoir mais aussi son ombre qui se fait ressentir sur tout l’arc avant sa présence et pour finir Lügner (=imposteur/menteur) qui offre aux spectateurs germanophones un Forshadowing de sa trahison future. Je me suis bien gardé pour la fin les noms à usage plus poétiques. A commencé par Qual (=tourment/torture/supplice) qui reflète à la fois la difficulté à le battre mais l’ironie funeste de son sort, Sein (=se trouver/agir) dont la traduction résume parfaitement sa quête personnelle de partir à l’aventure pour retrouver son ami et en même temps sa raison d’être profonde, Voll (=complet, entier) qui de part le maintien de sa promesse et malgré l’oubli de sa femme reste lui-même grâce à la promesse tenue qu’il lui a faite, Serie (=succession/série) dont l’âge quasi infini (étant une elfe comme Frieren) l’empêche d’avoir de successeurs malgré ses nombreux disciples mais qui a poussé après la mort de Flamme à faire rentrer le monde dans l’ère des humains par son enseignement, Frieren (=froid/congeler) pour son caractère naturellement détaché du monde, mais aussi opposé à sa maître Flamme (=feu) qui lui a donné une forme de passion (feu intérieur) et pour finir bien évidemment Himmel qui veut dire paradis qui renvoi à sa bonté naturel et son rôle de héros légendaire mais qui lui donne également ce caractère inaccessible vis-à-vis de Frieren. Mais les noms des personnages ne sont pas les seuls termes tirés de l’allemand. C’est tout le monde créé par Kanehito Yamada. Les monstres par exemple (je ne dresserai pas une liste aussi longue que pour les noms je vous rassure) avec Stilles (Silencieux, tranquille) qui dépasse pourtant le mur du son quand apeuré, Spiegel (=miroir) qui rappelle son pouvoir ou Einsam (=solitude) qui joue sur celle-ci pour piéger les voyageurs. On peut utiliser ce prisme pour les sorts mais on y reviendra dans une partie ultérieure. On citera juste le sort d’Aura Auserlesen qui signifie « bien choisir » car dans le cas de ce sort se tromper sur le mana de l’adversaire conduit à la mort de l’utilisateur. La langue allemande façonne l’univers et l’imaginaire de l’œuvre. Même des termes inventés comme Zoltraak trouve des consonnances germaniques (les sons « t », « r » et « k » plus durs sont utilisés pour présenter la violence du sort). C’est le cas également des lieux géographiques du monde de Frieren que nous verrons dans une partie suivante.
3. Un travail de construction d’univers cohérent
Même si Sousou no Frieren se repose très peu sur son monde pour dérouler son histoire, celui-ci n’a pas été pour autant pensé de manière incohérente, inintéressante ou en opposition avec les messages de l’œuvres. Tout comme l’histoire de Frieren, celle du monde se déroule sur un axe temporelle vaste. Cet axe s’y divise d’ailleurs en sous axes, appelés des « ères ». Si Sousou no Frieren s’inspire grandement de Tolkien en parlant de la fin de l’ère des elfes et du début de celle des hommes, elle joue aussi beaucoup sur une vision réaliste du processus de légende et de l’oubli. Pour l’instant dans la série, c’est le personnage de Wirbel qui en parle de mieux lors de son dialogue avec Frieren sur l’oubli progressif de la légende d’Himmel dans son village qui a continué à vaquer à ses occupations, parlant de moins en moins de l’exploit du héros. Frieren est elle-même est écrit dans ce processus. Elle a beau avoir au grand grand minimum 10 000 ans, la narration de l’œuvre nous donne l’impression que ses souvenirs sont parcellaires avant la rencontre avec le groupe d’Himmel et quasi inexistant avant celui avec Flamme. Armand Fallières, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Millerand, Gaston Doumergue, Paul Doumer, Albert Lebrun. Bien que cela ne soit pas réellement le cas, la thématique de la temporalité étant surtout traité via les souvenirs de Frieren poussant l’œuvre à petit à petit révéler des brides de son passé, le rapport de Frieren à l’oubli est pourtant bien existant. Wirbel lui dira même : « la mort n’est pas le seul au revoir dans cette vie ». Cela joue aussi avec le fait que Frieren est montrée comme quelqu’un restant assez dans son coin et à l’écart de la vie du pays. Parenthèse cette indifférence relative lui permette aussi de s’écarter encore un peu plus au rôle de héros de ce monde. Un défaut de l’œuvre aurait été d’avoir fait, en tout cas pour les plus vieux flash-back (ceux avec Flamme et Serie), des visions trop claires, ce qui cassent l’idée d’oubli mis en place par d’autres éléments. Le parcours de l’oubli se voit également dans les ères décrites dans Frieren. Les deux plus anciennes ères : l’ère Mystique et celle de la dynastie unifiée sont par exemple séparées par sans doute le plus ancien évènement encore connu par la population : l’avènement de l’empire qui pour la première fois ont unifiées les peuples humains. Ce qui est aussi intéressant c’est qu’il n’y a pas vraiment d’axe chronologique propre à l’univers. Cet axe a été réalisé par les fans au vu de ce que nous montre l’œuvre. Les 3 dernières ères stipulées par les fans sont d’ailleurs intrinsèques aux personnages vus dans l’œuvre (l’ère de la grande mage Flamme, l’ère des Hommes et l’ère de la paix) et aucune d’entre elle n’est réellement bien présentée dans Sousou no Frieren. Serie et Frieren parlent d’ailleurs de l’ère des Hommes pour parler de ce que les fans appellent le milieu de l’ère de la grande mage Flamme mais également pour parler de l’ère de la paix (rencontre en Fern et Serie). Le seul point vraiment marqué dans le marbre est la sous ère de la post-mort d’Himmel qui sert de compteur temporel à l’histoire. Et encore, tout comme des ères présentées cet indicateur est flou, et perd presque plus le spectateur qu’autre chose. A l’instar d’un Kubrick dans Shining le compteur est ici autant présent pour nous montrer que le temps avance que pour empêcher de fixer une temporalité claire si tous les éléments ne sont pas placés un à un sur une frise construite pour l’occasion. Frieren se détache des œuvres du même genre en appuyant son jeu temporel avant celui de la géographie pour nourrir son propos. Il y a à la fois une leçon d’humilité et de puissance lié au temps de la part du specteur, l’impression d’avoir vu une vie qu’aucun autre ne vivra mais également celle de n’avoir vu qu’un fragment de la vie des gens rencontrés sur le chemin. Et c’est tout à l’honneur de Frieren, car il est rare d’aussi bien créer un monde qui n’est pas aussi intéressant que les rencontres qu’on y fait.
Comme dans toute les œuvres du genre, Le monde fictionnel de Sousou no Frieren est incomplet. Seules les parties décrites durant le récit de l’histoire nous sont accessibles aux lecteurs et spectateur. L’objectif d’une œuvre créant un monde de fiction est donc de jongler entre des explications cohérentes entre elles en étant le moins possible verbeuse et un non-dit inconnu mais vaguement imaginable, corréler avec les quelques explications données par l’œuvre. L’injection du merveilleux ne peut pas se faire sans la création d’une suspension consenti d’incrédulité sans failles. « Au contraire, les genres de l’imaginaire et notamment la fantasy, vont pousser très loin l’illusion d’un monde complet. Il va nous sembler si réel, en dépit des merveilles qu’il recèle, que nous pouvons nous imaginer y "marcher" : c’est C.S. Lewis qui formule cet éloge, à propos de la Terre du Milieu de son ami J.R.R. Tolkien. » explique Anne Besson dans « Un monde imaginaire à inventer ». Le sentiment de cohérence et de vraisemblance dans Sousou no Frieren est, sur le plan géographique, permis par une large échelle de temps. On nous offre 3 images du monde : un sans réel royaume, un avec un royaume quasiment uni, un dernier avec ce qui semble être une fédération de différents états qui constituaient l’ancien royaume. Différents points viennent rendre ces visions du monde cohérentes. Par exemple, l’empire qui unifie les terres et démarre l’âge des hommes selon Frieren (concordance temporelle et géographique) ne s’étend pas sur toute la carte. Il s’arrête notamment au nord et n’empiète pas sur le terrain appartenant au seigneur démon qui existait déjà à ce moment. Les différents états du royaume sont pour la plupart séparés par des montagnes, des frontières naturelles qui expliquent la présence de scissions. De plus, l’œuvre utilise des pieds de levier de son genre pour faciliter la cohérence de son royaume sans nom, qui se donne des airs du Westeros de George R.R. Martin. Notamment le fait que la grande surface du royaume créé un pouvoir local supérieur au pouvoir central, créant des petites communautés assez isolées. Les cartes et la chronologie sont cependant beaucoup plus utilisées par les fans que par l’œuvre elle-même. Frieren ne se basent que peu sur les étapes importantes de la construction de son monde comme les langues imaginaires, les citations de récits ou de mythes internes au monde fictionnel. Et c’est toute la force de l’œuvre qui prend la construction du monde de fantaisie en contrepieds, avec très peu d’informations extérieures et beaucoup de zones de flous. La carte n’est d’ailleurs pas donnée d’emblée (tout comme le mythe de la création) à l’inverse de la plupart des œuvres du genre, laissant sur ce point un véritable voile de mystère et de merveilleux, tout en développant l’imaginaire du spectateur et lecteur quant à la tâche accomplie par le groupe d’Himmel. Cela permet à l’œuvre de se focaliser sur les personnages, les liens qui les unissent et leurs états d’esprits, l’objectif étant de créer une chute émotionnelle de la mort d’Himmel dramatique même si inévitable. C’est un vent frais chez la fantaisie et surtout la fantaisie nippone dont la tendance à se perdre dans des informations ne concernant pas nos personnages est fort. Au lieu de simplement raconter une histoire, ils retranscrivent (souvent de manière verbeuse) les données du monde sous une forme encyclopédique. Grace à différents sites communautaires la quête de Frieren peut être suivit sur la carte à l’instar des jeux de rôle sur table ou sur ordinateur sans jamais que l’œuvre ne narre l’histoire par ses biais. C’est d’ailleurs presque amusant de voir une œuvre comme Frieren qui a tendance à casser son merveilleux au profit de la science de l’œuvre de ne pas tomber dans cette tentation piégeuse. On peut même trouver triste que le parti pris ne soit pas complètement assumé avec par moment des cartes en intra-diégétique là où on aurait aimé les voir uniquement accrochées à un mur ou dans les mains de nos personnages. C’est extrêmement rare de voir un processus de création du monde où la "forme" du monde est limite libre de son contenu. Cette pudeur vis-à-vis du monde permettrait d’ailleurs à l’auteur Kanehito Yamada et son illustrateur Tsukasa Abe de créer un autre récit dans ce monde sans nom en rapport ou non avec Frieren (on pense notamment aux terres du sud dont on ne sait rien) si l’envie leur prend de retravailler ensemble sur le même univers (sachant que la partie de création et de cohérence du monde a déjà été mis en place par Sousou no Frieren et qu’il leur suffira de reprendre ces points).
Frieren se place dans une position limite oxymorique de son genre où elle ne crée pas une cohérence géographique par sa narration mais par son « worldbuilding » (l’attention portée à sa création d’univers). Il est étrange, par la façon dont elles sont montrées, de nous montrer une mer qu’on ne traverse pas, de nous exposer des montagnes au loin qui ne sont jamais gravit. Cela s’exporte même à l’œuvre toute entière, Sousou no Frieren ne récupère jamais les « Fusil de Tchekhov » qu’elle expose au spectateurs/lecteurs. Sans non plus être au niveau d’Elaina qui quitte la ville avant l’invasion des monstres dans Majo no Tabitabi, le groupe de Frieren ne reste pas toute la durée d’un arc au même endroit à l’instar d’un Luffy dans One Piece. Il y a donc certains passages de l’œuvre qui n’apportent pas (directement) quelque chose à l’œuvre. C’est notamment le cas de la chasse aux fleurs pour la statue d’Himmel (qui trouve une signification supérieure au fil de l’œuvre notamment avec le flash-back du jeune homme perdu dans la forêt) ou du nettoyage des côtes qui nous introduits à Flamme via ce faux livre (le spectateur considèrera surtout que c’est beaucoup de temps pour rien). L’attention n’est pas à la découverte mais au ressenti de nos personnages ou le comportement de Frieren qui évolue par rapport au premier voyage (chose qu’on observe à travers les flash-backs du groupe d’Himmel). D’autres passages ont l’air d’être d’une grande importance comme le passage secret dans la tombe du roi, mais rapidement passé outre par nos personnages car ces passages de lores ne concernent pas leur histoire personnelle. Le parallèle avec des jeux vidéo RPG existe avec souvent une première partie où le joueur survole l’histoire et l’univers avant de s’y pencher un peu plus si l’envie lui prend de relancer une partie, avec ses phrases cachées, ses passages secrets et ses souvenirs essentiels de personnages oubliés. Mais arrêtons de tourner autour du pot et regardons plus en détails les lieux proposés par Sousou no Frieren lors du voyage de nos protagonistes.
4. Les lieux traversés
J’ai l’impression de beaucoup me répéter dans cette critique, mais je vais quand même reprécisez que le monde de Frieren est connu et qu’il ressemble à ça. https://frieren.fandom.com/wiki/Locations? Avant de parler de géographie, je tends à faire un petit rappel de la situation temporelle de l’aventure de Frieren. Actuellement, on se situe 29 ans après la mort d’Himmel dans la saison 1, 31 ans dans le manga. Stark et Fern ont tout deux ~20 ans dans le manga. Au niveau du manga, il s’est passé plus ou moins 3 ans depuis qu’Eisen a demandé à Frieren de retourner combattre le roi démon soit moins d’un tiers du voyage sans compter la déviation réalisée à Äußerst dont l’impact est incertain aux vues de la capacité du groupe d’Himmel à faire des déviations, ce qui fausse le repère des 10 ans nécessaires pour parvenir au roi démon.
Le voyage de Frieren est ascendant, autant sur le plan géographique (nord vers le sud, même si parler d’ascendance dans ce cas n’est pas correct dans le contexte géographique désolé) que topologiquement avec une sensation d’élévation de l’altitude avec un climat de plus en plus froid et montagneux. Pour cette raison, la partie sud du continent sans nom de notre histoire (sobrement nommé les terres du sud) est complétement absent des enjeux de l’histoire, limite absente même des cartes qui préfèrent se zoomer à échelle plus locale les rares fois où elle apparait. Pour dire, il faudra attendre presque quatre ans après la sortie du premier tome avec le dernier épisode de la série (épisode 25) pour juste apprendre la localisation de deux villes jamais mentionnées lors d’une réactualisation de la carte du monde. Les villes Morgenrot Boden (Respectivement « Aube » et « Sol » en allemand) ne trouveront pas leur signification tout de suite.
Cette critique ne tient malheureusement pas dans l’espace de caractères prévu par SensCritique. Vous pouvez retrouver la partie 2 ici et la partie 3 là.