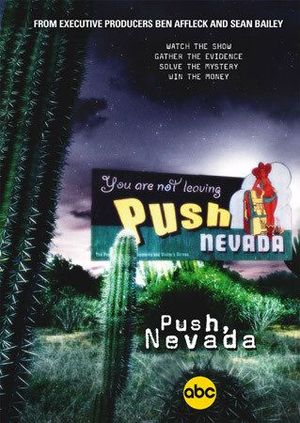Ce qui frappe dans Push, Nevada, c’est à quel point la narration semble vouloir être plus maline que son spectateur. L’intrigue s’agence comme une série de poupées russes : chaque révélation en dissimule une autre, chaque réponse génère deux nouvelles questions. C’est un choix audacieux, qui fonctionne très bien… jusqu’à ce que l’ensemble devienne trop touffu pour rester clair.
Le problème ne vient pas seulement de la complexité — certaines œuvres en font un moteur fascinant — mais de la façon dont cette complexité est gérée. La série multiplie les pistes, les indices cryptiques, les personnages aux intentions floues, sans toujours offrir de repères solides pour suivre le fil rouge. Le spectateur n’est pas simplement invité à enquêter : il est parfois laissé sans boussole dans un labyrinthe où même les murs changent de place.
Ajoutons à cela la volonté de faire interagir le public via des énigmes réelles à décrypter, et l’on comprend vite que Push, Nevada jongle avec beaucoup de balles en même temps. Trop, sans doute. Ce qui aurait pu être un jeu stimulant finit par ressembler à un brouillard scénaristique, où la tension cède la place à la confusion.
Ce sentiment est renforcé par un rythme irrégulier : certains épisodes avancent à tâtons, semblant perdre de vue l’intrigue principale, quand d’autres précipitent les événements sans réelle progression narrative. Le spectateur a alors du mal à établir une hiérarchie dans les informations : que faut-il retenir ? Qu’est-ce qui relève du détail trompeur ou du vrai indice ? L’énigme devient un millefeuille d’ambiguïtés.
Cela ne veut pas dire que l’écriture est mauvaise, loin de là : certains dialogues sont brillamment ambigus, et la mise en place initiale intrigue avec efficacité. Mais l’accumulation non résolue finit par diluer l’impact dramatique. À trop vouloir perdre son public pour mieux le surprendre, la série finit par l’égarer tout court.