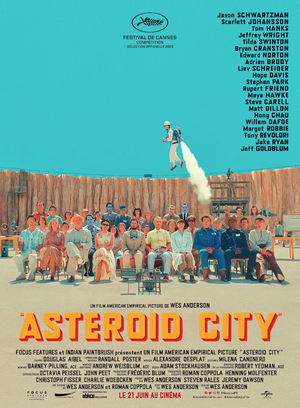Wes Anderson poursuit avec Asteroid City un mouvement amorcé depuis The Grand Budapest Hotel : celui d’un cinéma qui ne se contente plus d’exhiber ses récurrences mais qui les érige. Ici, plus que jamais, la forme est à la fois le sujet et le problème du film.
Le dispositif est triple : une émission télévisée des années 50 raconte la création d’une pièce de théâtre fictive, laquelle est rejouée en couleurs dans un décor de western nucléaire, par l'intermédiaire d'une voix off métafictionnelle.
La structure du film mime la structure du traumatisme. La perte du personnage d’Augie Steenbeck — veuf incapable d’annoncer la mort de sa femme à ses enfants — n’est jamais représentée de front. Elle est traversée, diffractée par le théâtre, par le jeu, par des objets qui signalent plus qu’ils ne figurent. Le moteur narratif n’est donc pas psychologique, mais compositionnel : il s’agit de construire des surfaces qui organisent l’affect.
Chaque plan est un tableau figé, encadré, maîtrisé, où le décor ne simule jamais un réel, mais produit un espace mental. Le désert américain — terrain d’essais nucléaires, décor de SF vintage, théâtre de conquête — devient chez Anderson un espace clos.
Ce qui frappe ici, c’est le contraste violent entre la rigueur géométrique de la mise en scène et la désintégration ontologique des récits. Chaque travelling latéral, chaque champ-contrechamp sur le modèle du théâtre filmé, renforce le paradoxe central du film : plus l’image est stable, plus le sens vacille. Anderson construit des cages pour contenir ce qui échappe — le deuil, le vide, l’incompréhensible.
La rigueur mathématique des cadres produit un sentiment d’artificialité absolue, mais cette artificialité devient expressive. Elle dit l’impossibilité de coïncider avec soi-même, de dire ce que l’on ressent, de jouer le rôle qu’on nous assigne. Le théâtre dans le théâtre fonctionne comme un révélateur : aucun personnage ne sait plus ce qu’il joue. L'acteur qui interprète Augie interrompt la pièce pour dire son doute : “I still don’t understand the play.” Cette phrase, loin d’être anodine, condense toute la visée du film : Asteroid City ne cherche pas à être compris, il cherche à montrer ce qu’est le non-compréhensible.
La bande-son d’Alexandre Desplat ne vient pas combler les vides, mais les dessiner. Elle opère en contrepoint de la narration visuelle, accentuant la segmentation des séquences, les ruptures de ton, les effets de collage.
Le montage lui-même agit en scansion : ni fluide, ni classiquement alterné, il juxtapose des blocs hermétiques. Une séquence ne répond jamais à la précédente, elle la relance ailleurs. Le film avance non pas par causalité, mais par translation.
“You can’t wake up if you don’t fall asleep.” La formule, répétée comme une ritournelle, fonctionne comme un axiome du film : l’éveil ne peut advenir que par immersion dans l’artifice. Le rêve — ici le théâtre, le cinéma, la fable scientifique — n’est plus le contraire du réel, mais la seule voie d’accès à ce qui nous affecte.
Si The French Dispatch semblait déjà mettre en abyme le pouvoir (et les limites) du récit journalistique, Asteroid City pousse cette logique jusqu’à son point de rupture.
Mais chez Anderson, cette modernité est douce, chromatique, ludique. Elle emprunte au langage de l’enfance (marionnettes, maquettes, théâtre de poche) pour dire la perte de l’innocence.
L’Amérique y est vue à travers le prisme de ses fictions mortes : westerns de pacotille, science-fiction rétro, familles dysfonctionnelles sorties d’un manuel de sociologie. La mise en scène ne sauve rien, elle encadre. Elle ne donne pas du sens, elle en propose la persistance formelle.