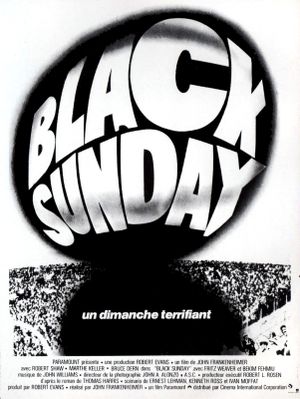Tagline de l’affiche américaine
Support: Bluray
En adaptant le roman de Thomas Harris (Le Silence des Agneaux), John Frankenheimer s’attaquait à un morceau qu’il ne fallait pas louper tant le sujet était délicat. Car faire s’attacher le spectateur à des terroristes tout en répudiant leurs actions n’est pas chose aisée. Car traiter conjointement du conflit israelo-palestinien et du trauma du Vietnam ne relève pas de l’évidence. Mais c’était sans compter sur le talent de tous les œuvrants qui ont livré un film aussi efficace en tant que thriller sous tension, que clairvoyant dans sa vision géopolitique de son époque et de l’avenir. Le tout porté par un trio d’acteurs parfaits: Robert Shaw implacable, Bruce Dern au bord du gouffre, Marthe Keller humainement fourvoyée.
Le plan s'échafaude peu à peu et laisse pressentir la terreur à venir, faisant monter la pression alors que le calendrier s’effeuille. Au diapason de cela, on révèle le passé, et donc les motivations, de chacun des acteurs de ce massacre en devenir, créant un lien troublant entre l’audience et les cabaleurs. Les deux terroristes deviennent alors humains et justifiés dans leur objectif revendicatif. D’un côté le vétéran abandonné par son pays, trahi par sa famille, qui ne souhaite que mourir en emportant ses tourmenteurs indifférents dans sa chute, illusionné que cela mettra fin à l’apathie généralisée. De l’autre la femme chassée de chez elle, ballottée entre les camps de réfugiés, et désormais apatride, qui veut que cesse l’aide occidentale à la colonisation de ses terres. Mais il faudra quelques séquences glaçantes comme celle de Miami, qui rappelle efficacement ce qu’induit le recours au terrorisme, une boucherie indiscriminée dont personne ne ressort gagnant.
Entre ses Israéliens pas tendres et ses Palestiniens résolus, Black Sunday reste neutre sur le parti à prendre dans ces enjeux géopolitiques. La morale passe alors par la simple cruauté à l’image des exécutions sommaires perpétrées par les terroristes, mais qui sont encore une fois contrebalancées par les techniques brutales du Mossad. La ligne de Frankenheimer est ténue, et seule la préconception du spectateur des conséquences d’attaques sur des civils permet de faire la distinction entre le bien et le mal, ne justifiant pas pour autant les méthodes employées dans la lutte pour les arrêter. On est à un doigt de supporter l’opération, de souhaiter qu’elle aboutisse en une réussite explosive. Est-ce si saugrenu? La cause est juste, les soldats de Septembre Noir sources d’empathie, les “gentils” vraiment vilains, et les victimes détestables et perpétuant par la suite leurs exactions, mettant Reagan, Bush ou Trump au pouvoir dans les décennies qui suivent.
Loin de moi faire l’apologie du terrorisme, qui n’est en aucun cas une solution envisageable pour faire valoir une cause, et que l’Histoire a prouvé au mieux inefficace, au pire contre-productif. Non, je tiens simplement à souligner la justesse de l'ambiguïté dans le traitement d’un sujet si nébuleux qui mêle habilement le conflit israelo-palestinien aux répercussions tonitruantes du Vietnam sur la psychée d’une génération, et à l’anxiogénéité des attaques à venir sur le sol américain. Rien n’est simple, rien n’est manichéen.
Et si Harris et Frankenheimer se sont inspirés de la vague de terrorisme qui secouait l’Europe (Bader, OAS, Munich, Entebbe…) et l’international (la présence de co-conspirateurs nippons faisant écho à l’essor de la Japanese Red Army), l’incursion de telles actions dans la patrie impérialiste semble alors inédite et ouverte au champs des possibles. Comment l’américain de 1977, détaché par la loi du nombre de mort-kilomètre des crimes commis au-delà les océans, ne peut-il pas frissonner alors que la possibilité d’agents dormants sur le territoire national est émise. Son caractère intouchable pourrait être mis à mal, son sentiment de sécurité ébranlé.
Mais il faudrait alors une première démonstration de l’impossible pour que les mesures soient établies sérieusement, on laissera donc se dérouler le Super Bowl comme on ne fermera pas les plages d’Amity. Bel orgueil que les ombres de 2001 auront vite étouffé, Black Sunday n’étant aujourd’hui quasiment jamais diffusé à la télévision, rappelant des meurtrissures trop vives.
Tout juste pourra-t-on reprocher au film de s’achever trop brusquement, après une dernière demi-heure sans répit, perfusée par l’incroyable bande-son de John Williams. Mais cela ne suffit pas à esquinter une œuvre rythmée au cordeau, à l’intelligence prophétique qui ne fait que gagner en proportions avec le fil de l’actualité qui s’égrène depuis, et aux interprétations aussi touchantes qu’elles effraient.