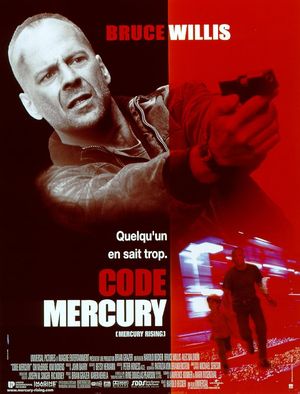Mal reçu au moment de sa sortie parce que mal compris, Mercury Rising n’est en rien un film sur l’autisme mais seulement – et c’est déjà beaucoup – un thriller dans lequel l’autisme sert de métaphore à la condition de paria du protagoniste, agent du FBI solitaire et dépourvu de famille qui s’efforce de remédier au déficit affectif qu’il endure et observe autour de lui. L’interprétation taciturne de Bruce Willis justifie en cela cette posture d’observateur des hommes, explicitée par l’image de l’hélicoptère qui encadre le récit, posture à laquelle il finit par renoncer en se révoltant contre un système perverti.
Art Jeffries ne cesse d’évoluer dans des milieux contenant une famille, thématique chère au cinéma de Harold Becker – la jeune victime de City Hall (1996) qui met en péril la famille municipale, le couple éprouvé de Malice (1993), la famille militaire de Taps (1981), la famille policière de The Onion Fields (1979) – : la prise d’otages initiale rassemble un père aliéné et ses fils, la maison dans laquelle il doit se rendre est celle de parents et de leur enfant, son meilleur ami et collègue de travail vit avec son épouse et son garçon. Il n’est pas anodin de le voir solliciter une jeune femme pour surveiller, dans un café, Simon Lynch pendant qu’il retrouve un contact : il tente avec elle de fonder un foyer de substitution, va jusqu’à investir son appartement dans la perspective, hypothétique et peu crédible – elle n’adviendra d’ailleurs pas – d’y rester plus longtemps.
L’apprentissage réciproque de l’adulte et de l’enfant dessine les contours d’une parentalité qui s’accomplit dans la violence, d’où l’autisme comme rapport hypersensible au monde ; il bénéficie d’une mise en scène fluide et rigoureuse, très précise dans le choix de ses cadrages. La partition musicale de John Barry articule bien le thème intimiste de Simon aux séquences de tension rappelant ses ambiances conçues pour James Bond. Une belle réussite.