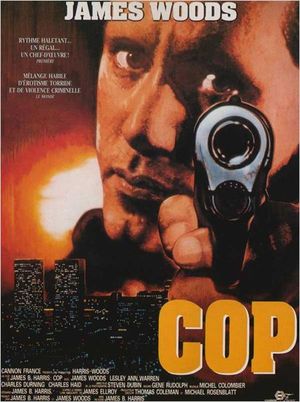S’il convoque tous les codes du genre, Cop se saisit du polar pour approfondir la relation entre les hommes et les femmes, plutôt leur incompatibilité tant philosophique qu’amoureuse : eux représentent un danger permanent pour leur entourage, comme le dit bien l’épouse avant de fuir le domicile conjugal avec l’enfant, elles pansent leurs blessures au moyen de tissus chimériques, qu’il s’agisse des contes de fées ou des poèmes reçus, année après année, par un mystérieux gentleman… Aussi le film aborde-t-il intelligemment la perte de l’innocence sous l’angle d’une double nécessité, à savoir du point de vue du flic démystifiant les trajectoires individuelles avec froideur et distance, et du point de vue de l’engagement féministe, second versant d’une même médaille moraliste. Il s’agit, en somme, de lutter contre toute forme de croyance, en témoigne la séquence dans le bureau du chef durant laquelle Lloyd Hopkins renonce aux artifices d’une parole faussement religieuse pour exposer son plan – notons d’ailleurs que la croix ornant l’un des murs du même bureau se retrouve accrochée autour du cou de Kathleen McCarthy, signe de sa foi en une fiction qui l’aveugle.
La mise en scène, très précise, circule librement dans les espaces, scrute les différents objets du quotidien, glisse depuis l’étreinte des amants d’un jour aux accessoires de cuisine suivant une indifférence mimétique du regard désabusé du protagoniste ; de même, la partition atmosphérique de Michel Colombier intègre à ses influences jazz chères au genre une mélancolie qui retranscrit les pulsations de celui-ci, de la même façon que la petite fille sent à sa fébrilité qu’une affaire tracasse son père. Une belle réussite.