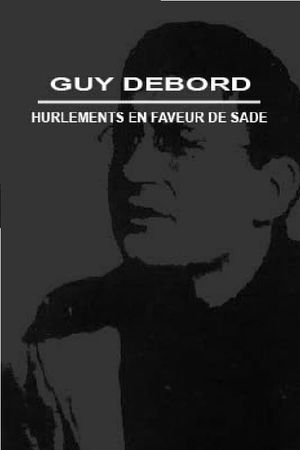Évidemment, comme film, c’est nul au sens premier du terme. On pourrait s’amuser à recenser les innombrables paradoxes de ces Hurlements en faveur de Sade qui sont du cinéma sans en être, à en faire la singulière fiche technique ou à se demander s’il s’agit d’un ensemble de plans noirs et muets sur fond blanc et bavard (1), ou le contraire.
Il y a quand même des choses à en dire.
En 1952 Debord a vingt ans, et il ne recommencera plus. Je ne dis cela ni pour crier à une prétendue précocité du génie dont cette grosse heure de cinéma serait le fruit, ni pour dévaluer ces Hurlements en leur donnant le statut d’une erreur de jeunesse ou d’une blague de potache (2). Et si le lien avec un Marcel Duchamp peut tenir la route, il faut souligner que Debord n’a strictement rien à voir avec l’ensemble de ces artistes contemporains dont la carrière n’est qu’une déclinaison, sur une durée que leur mort seule interrompt, autour de l’idée de la mort de l’art.
Hurlements en faveur de Sade n’est ni plus ni moins radical en 1952 qu’en 2017, parce qu’il méprise également les spectateurs des deux époques (en gros, ciné-club et DVD). Il faut imaginer les réactions, devant leur écran, du type vaguement libertin qui se trouve là sur la foi du titre (3), de l’amateur de films indépendants qui s’est dit qu’il devait étoffer sa culture cinéma, ou même du gentil fumeur de joints qui avait entendu parler d’un film anti-système. Anti-système, ce film l’est, mais il est anti-tout (« Contre le cinéma »).
Pour finir, ces Hurlements sont cohérents : ce collage d’articles du Code pénal (mais pas n’importe lesquels), d’un fait divers (mais pas n’importe lequel) et de déclarations au goût de manifeste plus ou moins prononcé, en tant que programme sonore ou même simplement en tant que texte, se tient largement autant que certaines productions surréalistes ou issues du cut-up.
(1) Oui, puisqu’il y a le cinéma muet et le cinéma parlant, pourquoi pas le cinéma bavard ?
(2) Toutes proportions gardées, et dans un autre domaine, c’est la lecture que certains font d’Ubu roi, par exemple, en occultant sciemment ou non le reste de l’œuvre théâtrale et littéraire de Jarry. Je reste d’ailleurs persuadé qu’il y aurait plus d’un parallèle à dresser entre ces deux fantastiques glandeurs que furent l’auteur des Almanachs du Père Ubu et le rédacteur en chef de Potlatch.
(3) Là encore, une lecture « magritienne » du film me paraît biaisée. Hurlements en faveur de Sade n’est peut-être pas un film, mais il ne s’intitule pas « Ceci n’est pas un film » ; la question du lien entre le réel et sa représentation ne s’y pose pas. – À la rigueur, ce titre est sans doute ce qui s’y trouve de plus daté : en 1952, Sade est toujours censuré, Pauvert en chie pour le rééditer, et ses œuvres n’ont pas encore bénéficié de la deuxième jeunesse que leur donneront le structuralisme et la levée d’une partie des tabous sexuels après 1968. Son nom est un signal ; en 2017, le film de Debord pourrait s’appeler « Baise-moi, j’ai six ans » ou « gtrhgiuehyh ».