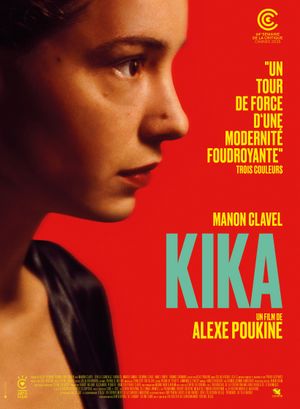Avec "Kika" , la réalisatrice choisit de déplacer le regard là où le cinéma s’aventure rarement : dans ces zones où le désir, la détresse et le soin s’entremêlent jusqu’à devenir indistincts. Le film suit une assistante sociale qui, en répondant aux fantasmes de ses clients, découvre qu’elle ne trahit pas sa vocation première : elle la déplace. Et c’est précisément dans cette bifurcation, entre travail du sexe, improvisation théâtrale et écoute active, que Kika devient un film plutôt subversif.
Ce qui frappe d’abord, c’est la manière dont le film refuse la facilité du spectaculaire ou de la violence. Au lieu de s’attarder sur la transgression, il s’attache à l’humain, à ses recoins de honte, à ses fragilités, à ce besoin d’affection qui circule, déguisé, sous mille formes. La mise en scène, presque documentaire par endroits, plonge dans le quotidien de dominatrices professionnelles, leurs rituels, leurs respirations, leurs gestes précis, accompagnée de ces cris de jouissance qui résonnent à travers les murs d’un hôtel de passe en activité réelle. Cette porosité entre fiction et réalité donne au film une texture rare, presque clandestine.
Le récit glisse régulièrement vers le cocasse, comme pour rappeler que la misère sociale et l’épuisement professionnel cohabitent souvent avec une absurdité qui permet de tenir. Ainsi cette scène, presque burlesque, où Kika découvre qu’une jeune femme en attente d’un logement complète ses revenus en vendant ses culottes sales, sous couvert d’être une performeuse érotique. Le film capte ces dissonances du réel avec une douceur qui n’exclut jamais un sourire.
Il y a aussi, dans la trajectoire de Kika apprentie dominatrice, une forme de théâtre du soin : apprendre un rôle, répéter, moduler sa voix ou son autorité jusqu’à atteindre la tension juste, celle qui offre au client le sentiment d’être vu, entendu, reconnu.
"Kika" est au fond un film sur la circulation du pouvoir et de la tendresse, sur la manière dont les gestes professionnels, qu’ils soient sociaux ou érotiques, peuvent partager une même grammaire : celle de l’attention à l’autre. En refusant tout jugement moral, en préférant l’observation patiente à la démonstration, la réalisatrice signe une œuvre à la fois déroutante et profondément humaniste. La force du film réside dans le choix de l'humour, de l'incongruité, le regard plutôt nouveau et subtil que la réalisatrice porte sur les hommes. Une fiction qui ose dire que le soin peut surgir dans des lieux inattendus, et que parfois, oui, l’on guérit autant par la parole que par la mise en scène de nos propres failles.