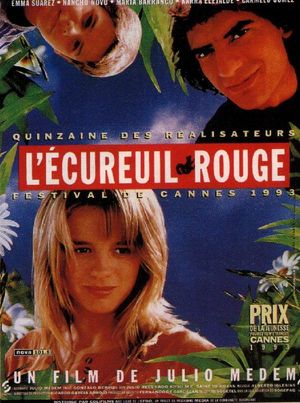Julio Medem filme la mémoire comme on filme une mer jamais tranquille : houleuse, imprévisible, prête à tout engloutir. La première image nous prend déjà à la gorge : Jota, musicien brisé, s’avance vers le vide, comme attiré par le néant. Mais une moto s’écrase, un hasard brutal, et tout bascule. Sous le casque, une jeune femme. Elle s’appelle Lisa. Elle a tout oublié. Elle ne sait même plus la couleur de ses yeux. Alors Jota invente, il comble le blanc. Et de ce mensonge naît une histoire qui ressemble à de l’amour.
L’Écureuil rouge n’est pas un simple drame sentimental. C’est une fable inquiète, presque venimeuse. Les regards durent trop longtemps, les silences pèsent, et la lumière d’Espagne semble assommer la vérité. On se demande sans cesse : faut-il inventer un récit pour aimer, ou affronter les souvenirs, même s’ils font mal ?
Medem orchestre ce vertige avec des symboles obsédants : la mer, vaste tombe et refuge ; la musique, qui suinte comme une cicatrice ; les couleurs vives, trop vives, comme si elles voulaient cacher la noirceur. On ne sait plus si on est dans un thriller, un mélodrame, ou dans un rêve dangereux. Mais on sait qu’on ne sort pas indemne.
L’Écureuil rouge est de ces films qui dérangent par leur étrangeté et qui séduisent par leur fièvre. Une parabole en équilibre instable, qui parle d’amour et de mémoire, mais surtout de la manière dont on se raconte soi-même pour survivre. Et quand le film s’achève, il reste ce goût étrange, presque amer, celui d’une vérité qu’on a peut-être préférée oublier.
🔴 Me retrouver sur https://www.youtube.com/@Cin%C3%A9masansfard