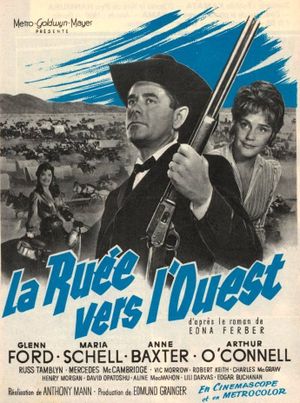Cimarron a l’intelligence de représenter la conquête de l’Ouest et l’esprit pionnier par le prisme d’un personnage éternellement insatisfait, qui tire de cette passion dévorante pour l’inconnu un élan tour à tour conquérant et destructeur. D’entrée de jeu et deux heures durant, Yancey Cravat échappe à toute tentative d’étreinte, fidèle en cela au surnom qui donne son titre au long métrage : l’adjectif « cimarrón » renvoie à la sauvagerie entendue comme antonyme de civilisation ; là réside son paradoxe, à savoir une existence vouée au développement d’une société juste et égalitaire tout en demeurant dans son ombre. Son caractère insaisissable devient peu à peu garantie d’une incorruptibilité face aux manœuvres politiques et économiques qui conduisent certains à confondre richesse matérielle et valeurs morales, à réclamer les titres de propriété d’une terre sous laquelle se concentre l’or noir au détriment des Indiens Osages qui y vivent.
Aussi Anthony Mann pose-t-il les bases, aidé de son prédécesseur Wesley Ruggles – il réalisa la première version du film, sortie en 1931 – de ce qui deviendra Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese, 2023), prolonge un humanisme et un éloge du métissage des cultures chers à son cinéma. Les nombreuses ellipses permettent au récit d’embrasser une temporalité étendue, de 1889 à la fin de la Grande Guerre, et de traiter par le biais d’épisodes les vices constitutifs de l’Histoire américaine : racisme, cupidité et soif de pouvoir. Cette structure a priori déstructurée traduit narrativement les impatiences d’un visionnaire qui ne s’attachera à une terre que par l’intermédiaire d’une statue post mortem ; ses absences contribuent à brosser un ingénieux portrait de femme qui s’accomplit et s’affranchit dans l’espoir que son époux reviendra. Elle se révèle être une pionnière au même titre que Yancey.
Magnifiquement réalisé et interprété, en dépit des difficultés inhérentes à sa production, Cimarron est une œuvre subtile et bouleversante qui mérite aujourd’hui reconsidération.