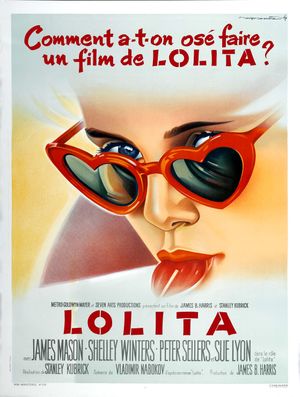C'est drôle de voir comme l'ampleur du roman de Nabokov, publié en 1955, semble ne connaître aucune limite : accueilli dès sa publication comme un scandale (im)moral, sujet de maints débats booléens durant des années, il est encore aujourd'hui au centre de l'attention. Si bien que les critiques, bonnes ou mauvaises, ne peuvent s'empêcher de faire le parallèle entre l'œuvre du premier art et l'adaptation kubrickienne du septième. Jamais avons nous connu un traitement aussi comparatif parmi les classiques, de Blade Runner à The Shining, en passant par Fight Club ou Le Parrain, de La Planète des Singes jusqu'aux Évadés et, à vrai dire, avec à peu près tous les autres...
Bon, je ne vais pas agrémenter ce débat car je n'ai pas lu le livre, et cette œuvre a le droit, comme ses camarades, d'être visionnée telle une composition propre (surtout quand on sait que Kubrick a refusé le script de Nabokov), malgré le traitement spécial qui est évidemment lié à son sujet ambigu.
En tout cas, ce qui ressort de passionnant dans ce film est le portrait incommode de la société et des intellectuels, avec l'excellent duo Humbert-Quilty qui semble toujours flotter dans les tergiversations les plus sinueuses. Kubrick sort de ses habitudes pour s'attaquer au composite social d'un collectif pas si hétéroclite (je crois n'avoir jamais vu un ton, une attitude et un vocable aussi immuable entre tant de personnages différents), qui ne semble pas vraiment partager la préoccupation de l'œuvre de fiction à laquelle il appartient (du moins, c'est toujours très vague).
Vient alors ce qui me dérange avec cette œuvre (cinématographique, je le rappelle) : la carence d'interaction poussant à la réflexion entre le couple officieux et le monde extérieur. La morale ne vit que par son universalité, par sa qualité d'idée approuvée conjointement au sein d'un corps social. Or, à moins d'avoir deux êtres respectivement capables de résister à la tentation de la Pomme, un duo ne peut foncièrement convenir à un axiome moral. Mais dans Lolita, on ne voit jamais réellement d'intervention extérieure, de mise en garde dissuasive (sur le couple en tant qu'unité, pas seulement Humbert et sa dépendance) ou d'événements explicites. Certains diront que c'est pour combiner leur relation à la retenue filmique imposée au réalisateur, ce qui a en soi du sens, mais cela ne me satisfait pas pour autant.
Ce que je pourrais reprocher de plus au film du maître anglais (et là, c'est un ressenti bien personnel), c'est l'accointance de l'œuvre à l'académisme hollywoodien, dont il était déjà le colporteur avec Killer's Kiss et Fear and Desire (et même L'ultime Razzia, dans une certaine mesure). Académisme dans la mise en scène (les décors principalement, même s'il est vrai qu'on y respire correctement, l'appropriation de l'espace y est quelque peu guindée), la narration (la grande ellipse n'en fait pas pour autant un film authentique) ou encore l'utilisation du noir et blanc, à laquelle je ne parviens à trouver d'autre explication que sa référence aux mélos de la décennie antérieure.
C'était mon dernier manquant de la filmographie de Kubrick et ce fut sûrement mon erreur de le laisser attendre autant de temps au fond du placard, dans ce rôle de catalyseur. Mes attentes se reposaient sur une conviction rare, le genre de conviction qui, face à la grandeur de l'artiste, délaisse le raisonnement proportionné pour la certitude impulsive.