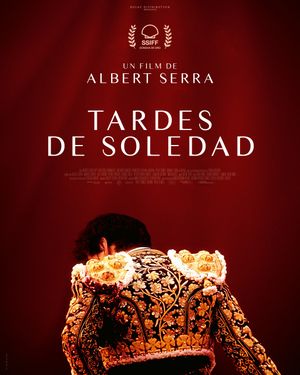Envisagée comme un monde clos, autarcique et fermé sur lui-même, la corrida prend, dans Tardes de Soledad, la forme d’un cercle. C’est d’abord celui de l’arène où sont enfermés, pendant les trois quarts du documentaire, les silhouettes de Andrés Roca Rey, torrero péruvien, et des différents taureaux qu’il tuera à la chaîne. C’est ensuite la forme du miroir qui, pour la première fois dans le film, révèle les préparatifs du spectacle et le corps d’Adonis du personnage principal. C’est enfin, et surtout, ce que dessinent les mouvements du toréador et de l’animal lorsque s’enclenche le face-à-face qui oppose la victime et son bourreau : sorte de tango où l’un des deux danseurs doit mourir, la corrida prend la forme d’un mouvement perpétuel et centrifuge cristallisant le « moment de vérité » où se révèle la fragilité de l’existence. Cette logique de face-à-face entre le taureau et le torero est soulignée dès l’ouverture où plusieurs longs plans captent l’errance de l’animal dans l’arène, avant que ce dernier ne regarde l’objectif, initiant un raccord sur le visage de Roca Rey, face caméra et en gros plan. Entre la bête et son tueur, le film dessine par petites touches une logique de gémellité : ainsi de la langue pendante de l’animal après les banderillas (évoquant celle du toréador dans son mini-van après avoir été encorné) ou de ses testicules noires, dont la forme est rejouée sur les chapeaux que portent la cuadrilla. L’ambivalence du projet de Serra est patente à cet endroit : au sein du folklore mortuaire de la corrida, le taureau semble avant tout être une idée, celle d’une bestialité brutale face à laquelle l’humanité redevient « sauvage ».
Le film reste toutefois rétif aux interprétations idéologique : en donnant à entendre en permanence les propos parfois insupportables des spectateurs ou des toreros à l’encontre de l’animal (désigné comme un « fils de pute » tout au long du film), Serra ménage une certaine distance avec l’imaginaire héroïque de la corrida, en dévoilant son caractère dérisoire et ridicule. Sans être les plus réussies du film, les scènes de débriefings dans le van, qui interrompent les corridas, témoignent d’abord de l’autosatisfaction de Roca Rey et de son équipe, semblant en permanence s’autocongratuler face à la grandeur supposée du rituel qu'ils perpétuent. En maintenant dans toutes les scènes un cadre serré qui laisse la majorité des informations hors-champ, le film place le spectateur dans une position intermédiaire de scrutateur lointain, qui ne coïncide pas tout à fait avec celle des toreros et du public. Incapable de « juger » des qualités intrinsèques du cérémonial, le regard se déplace ainsi vers l’expérience de la douleur et de la violence, notamment à l’occasion de deux scènes d’encornement particulièrement spectaculaires. Reprenant la logique de la scène de la vague dans Pacifiction, elles ménagent une surprise et un effroi qui prime sur l’admiration ou le dégoût. À cet endroit, Serra semble toucher du doigt ce qu’il recherche : retrouver un sentiment de terreur sublime par l'entremise d'images-limite. Le risque encouru reste toutefois le même que dans son précédent long-métrage : passée la surprise initiale de cet instant terrorisant, la scène fera-t-elle toujours le même effet ?
Cette problématique de l’habituation du regard à l’horreur constitue justement le cœur de Tardes de Soledad. En explorant, à force de répétitions, le dispositif de la corrida, Serra désensibilise progressivement le regard du spectateur à l’effroi de la mise à mort du taureau. Saisissante au début du film, l’exécution de l’animal devient un jalon comme un autre qui permet de situer temporellement la progression de la corrida. En ce sens, le film ne chercche pas véritablement à restituer par la mise en scène le point de vue de l’animal (c’est l’affaire d’un seul plan, presque gaguesque et manifestement factice, où Roca Rey toise le spectateur en contreplongée dans un ascenseur), mais plutôt à placer le spectateur dans une posture distanciée et interrogatrice face au fonctionnement de son propre regard et à son accoutumance progressive au spectacle de la mort. Expérience réflexive, Tardes de Soledad postulez in fine que l’œil du taureau agonisant est avant tout le miroir de notre esprit.