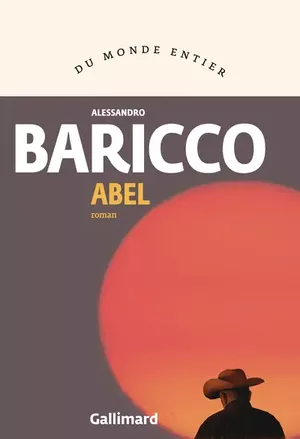Abel est le dernier bouquin de Baricco depuis environ sept ans. L'auteur italien, qui a pu s'imposer auprès d'un certain public introduit mais pas trop dans la littérature comme une espèce d'oxymorique figure d'avant-gardiste accessible, s'attaque ici au western (genre qu'il avait effleuré dans City) pour livrer une aventure poétique et fragmentée pas inintéressante mais un peu naïve lorsqu'elle s'essaie à vulgariser une sorte de phénoménologie.
Sous-titré « western métaphyisque », le roman met en scène un tireur de génie, Abel, qui raconte dans le désordre les événements marquants de sa (jeune) existence l'ayant conduit à abandonner ses armes pour cheminer vers un lointain sud afin d'y disparaître. Il aura l'occasion dans ces fragments, dont le titre est constitué de la première phrase dans une tradition empruntée au poème non nommé, de confronter différents personnages de mystiques qui auront tous plus ou moins fonction de lui faire interroger la causalité et la spatialisation des phénomènes qui surviennent dans une vie.
Abel n'est pas un mauvais roman mais il ne fait guère évoluer ce qui finit bien par ressembler à une formule ronronnante chez Baricco, avec ses superposition d'évocations du cul et de scènes dans le désordre dont les liants (chrono)logiques sont volontairement rompus, le tout sous une peinture pastiche de genre qu'il a déjà utilisée et qui peine de plus en plus à montrer sa pertinence dans la construction. L'utilisation des codes du western ne sert par exemple ici pas à grand chose, et ils pourraient paraître avoir été choisis simplement pour légitimer une réflexion mathématique sur les trajectoires de tir qui inspirait l'auteur, et qui pourrait se retrouver telle quelle dans un personnage de tueur ou de soldat (en écrivant la phrase, le souvenir de l'ouverture du Killer de Fincher avec Fassbender me revient subitement) ; de la la même manière que le rapport à l'espace qui occupe périphériquement les questionnements du roman ne tire à peu près aucune richesse du fait qu'il prenne place dans un western, un genre pourtant défini jusque dans son nom même par cette préoccupation.
En-dehors de ça, les différents initiateurs que rencontre le personnage d'Abel, censé être un beauf mal dégrossi avec lequel s'accorde donc très mal le niveau de langue descriptif et sinueux de Baricco, et qui sont pensés pour l'introduire à des méditations sur les limites de la conscience pour habiter le monde, trébuchent assez fréquemment dans le cliché de stoner (on a droit à l'aveugle itinérant fan de théologie médiévale, à trois pseudo-sorcières pseudo-devineresses dont deux demi-amérindiennes, au fou extralucide etc), et la leçon qu'ils ont à livrer ne convainc de toute façon absolument pas puisqu'elle se contente de pauvrement gloser de la vulgarisation de base de Hume et des Grecs.
Reste que le boxon demeure relativement bien écrit, puisque Baricco a au fil du temps su développer une patte assez sympathique, dont le caractère suggestif et un peu rêveur qui traverse en souterrain la description a su faire des emprunts pertinents au réalisme magique sémiologisant. Le point d'orgue du roman consiste d'ailleurs en la description d'une selle qui semble tout droit tirée d'un bouquin de Calvino ou de Borges.
Je vais m'en tenir là parce que j'ai déjà viré deux ou trois points d'appréciation au bouquin en devant revenir dessus pour écrire cette petite notice, me rendant donc compte que plus j'en parle moins je l'estime. C'est pas mal en somme mais il se branlote, Baricco. Et qu'il aille se tirer la tige avant de rédiger ses romans, je suis épuisé de me taper ces livres bien trop nombreux où une meuf est mise sur un piédestal pour sa beauté et sa finesse alors qu'on la représente énamourachée (oui) d'un héros débile qui se tape des putes à côté s'il peut tandis qu'elle lui est fidèle avec scrupule, faisant par là preuve de son indépendance et de sa force de caractère (!!!). C'est une logique de porno et de salopard.